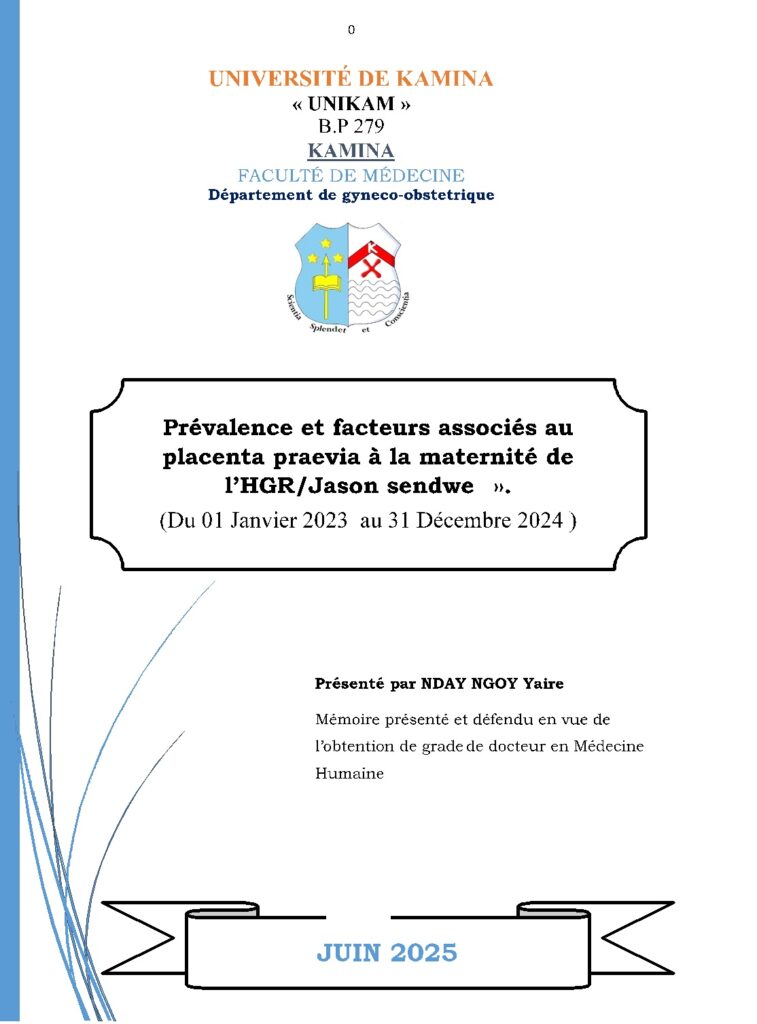
TABLE DES MATIÈRES
IN MÉMORIUM ………………………………………………………………………………………………………. IV
DÉDICACE ………………………………………………………………………………………………………………. V
REMERCIEMENTS …………………………………………………………………………………………………. VI
LISTE DES ABRÉVIATIONS ………………………………………………………………………………….. VII
LISTE DES TABLEAUX ………………………………………………………………………………………….. IX
1. État de la question …………………………………………………………………………………………….. 1
- Objectifs ………………………………………………………………………………………………………….. 2
- Général ……………………………………………………………………………………………………… 2
- Spécifiques ………………………………………………………………………………………………… 3
- Justification de l’étude ………………………………………………………………………………………. 3
- Délimitation spatio-temporelle ……………………………………………………………………………. 3
Subdivision du mémoire …………………………………………………………………………………………… 3
Chapitre premier ………………………………………………………………………………………………………… 5
RAPPEL SUR LE PLACENTA ET LE SEGMENT INFÉRIEUR ……………………………………. 5
2.1. Définition …………………………………………………………………………………………………………. 9
- Facteurs étiologiques ……………………………………………………………………………………. 11
- . Physiopathologie ……………………………………………………………………………………….. 11
- Mécanisme de l’hémorragie ………………………………………………………………………… 11
- Origine de l’hémorragie ……………………………………………………………………………… 12
- Diagnostic …………………………………………………………………………………………………… 12
- Complications ……………………………………………………………………………………………… 15
- Diagnostic différentiel ………………………………………………………………………………….. 15
- Prise en charge …………………………………………………………………………………………. 16
- . Physiopathologie ……………………………………………………………………………………….. 11
Chapitre Deuxième ……………………………………………………………………………………………………. 19
PRÉSENTATION DU CADRE DE RECHERCHE ………………………………………………………. 19
- Situation géographique …………………………………………………………………………………….. 19
- Historique ………………………………………………………………………………………………………. 19
- La structure administrative ……………………………………………………………………………….. 20
- La structure médicale ……………………………………………………………………………………….. 20
- La capacité d’accueil ……………………………………………………………………………………….. 20
Troisième Chapitre ……………………………………………………………………………………………………. 21
MATERIELS ET METHODES ………………………………………………………………………………….. 21
- 1. Type et période d’étude ………………………………………………………………………………….. 21
3.2. Population d’étude …………………………………………………………………………………………… 21
- 3. Échantillonnage ……………………………………………………………………………………………… 21
3.3.1. Technique d’échantillonnage ………………………………………………………………………. 21
3.3.2. Taille de l’échantillon ………………………………………………………………………………… 21
- Critère de sélection ………………………………………………………………………………………….. 21
- Technique des collectes des données ………………………………………………………………….. 22
- Variables retenues ……………………………………………………………………………………………. 22
- Difficultés rencontrées ……………………………………………………………………………………… 22
- Considérations éthiques ……………………………………………………………………………………. 23
Chapitre Quatrième …………………………………………………………………………………………………… 24
PRÉSENTATIONS DES RESULTATS ……………………………………………………………………… 24
Chapitre Cinquième ………………………………………………………………………………………………….. 38
DISCUSSION ………………………………………………………………………………………………………….. 38
CONCLUSION ET SUGGESTIONS ………………………………………………………………………….. 42
RÉFÉRENCE …………………………………………………………………………………………………………… 44
ANNEXE ………………………………………………………………………………………………………………… 46
ÉPIGRAPHE
« Le placenta prævia n’est pas une fatalité, mais un défis à relever par la connaissance,
l’anticipation et la vigilance »
(Michel sureau, 1997)
IN MÉMORIUM
À la mémoire de ma feue mère KAZADI NGOY WILELANGA qui nous a quitté avec un cœur brisé. Son souvenir reste vivant dans nos cœurs, comme une lumière qui ne s’éteint pas. Je sais à quoi dire de plus.
Requiescat in pace !!!
DÉDICACE
À mon père NKULU MBUYA Kaloa, homme de droiture, de sagesse et d’encouragement, dont la force tranquille a toujours été mon repère. Homme de principes, sagesses et de constance, qui m’ont transmis les valeurs de l’effort, du respect et de la dignité. Votre soutien moral, vos sacrifices silencieux, vos prières inlassables et votre foi en moi ont été les fondations sur lesquelles s’est bâtie ma réussite. Ce mémoire vous appartient autant qu’à moi
À ma mère TWITE MALALE, femme de foi, de courage et d’amour, dont les prières silencieuses et les sacrifices constants ont éclairés mon chemin. Exemple vivant d’amour, de patience et de dévouement maternel,
Je vous dédie ce mémoire, fruit de vos efforts, de votre patience et de votre amour inconditionnel.
NDAY NGOY Yaire
REMERCIEMENTS
L’aboutissement de ce mémoire n’aurait pas été possible sans l’aide, soutien et
les encouragements de nombreuses personnes auxquelles je tiens à exprimer ma plus profonde gratitude. Avant toute chose, je rends grâce à Jéhovah Dieu Tout-puissant, source de toute sagesse, de toute force et de toute grâce. C’est par sa main invisible que j’ai pu franchir chaque étape de ce parcours avec espoir et persévérance
. Je rends hommage respectueux aux autorités académiques de la faculté de
médecine de Kamina, pour la qualité de la formation dispensée, leur engagement envers l’excellence et leur encadrement permanant
Je tiens à exprimer ma sincère reconnaissance au directeur de ce mémoire Professeur KINENKINDA KALUME Xavier, pour sa disponibilité, sa rigueur intellectuelle et ses conseils judicieux, qui ont enrichi ce mémoire et guidé ma réflexion. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude au Docteur Justin BIAYI MUKENDI, mon co-directeur, pour son encadrement précieux, ses conseils avisés sa disponibilité tout au long de l’élaboration de ce travail. Son expertise et son soutien ont grandement contribué à la qualité de ce mémoire. Malgré mes hésitations et mes imperfections, il a su faire preuve de compréhension et de bienveillance, ce dont je lui suis profondément reconnaissant.
Je tiens également à exprimer toute ma reconnaissance à mon oncle Makyr KUMWIMBA et sa femme MALINDA Mado, pour leur affection constante, leur soutien matériel et moral, et leur présence bienveillante, leur foyer a été pour moi un appui sûr dans les moments décisifs. À mes frères et sœur : Cédrick KASONGO, Kennedy KUMWIMBA, Érasme ILUNGA, Henchel KILOLO et Zipora KAZADI, Paul MITONGA, Erick , vous m’avez accompagné avec affection, tendresse et encouragement ou par des simples mots de réconfort : que chacun reçoive ici l’expression de ma gratitude sincère.
Merci à mes camarades de promotion et amis fidèle : OMARI Sanders, Héloime MWEPU, Delphin NGOY, Hercule MUNGOMBA, Tabita KYUNGU, pour votre
solidarité, l’esprit d’entraide et les moments de partage, parfois difficile, mais toujours enrichissant. À toutes celles et tous ceux dont le nom ne figure pas ici mais qui ont d’une manière ou d’une autre contribué à ce mémoire : que ce remerciement vous parvienne comme hommage sincère.
NDAY NGOY Yaire
LISTE DES ABRÉVIATIONS
BCF : battement du cœur fœtal
CIVD : coagulation intravasculaire disséminée cl : clore
CPN : consultation prénatale
HGR : hôpital général de référence
K : potassium
Na+ : sodium
NFS : numération formule sanguine
OMS : organisation mondiale de la santé
SA : semaine d’aménorrhée
TA : tension artérielle
TCA : temps de la céphaline activé
TP : temps de prothrombine
TV : toucher vaginal
IX
LISTE DES TABLEAUX ET FIGURES
a) Figures
Figure 1. Prévalence du placenta prævia à la maternité de l’HGR/Jason Sendwe
Figure 2. Répartition des cas selon l’État civil
Figure 3. Répartition des cas selon les antécédents d’avortements
Figure 4. Répartition des cas selon les antécédents de césarienne
Figure 5. Répartition des cas selon la parité
Figure 6. Répartition des cas selon l’âge de la grossesse
Figure 7. Répartition des cas selon le suivi des consultations prénatales
Figure 8. Répartition des cas selon la réalisation de l’échographie au 2ème trimestre
Figure 9. Répartition des cas selon le type de grossesse
Figure 10. Répartition des cas selon l’état général
Figure 11. Répartition des cas selon la présence de l’état de choc
Figure 12. Répartition des cas selon la présence de BCF
Figure 13. Répartition des cas selon la prise en charge symptomatique
Figure 14. Répartition des cas selon l’issus maternel
b) Tableaux
Tableau I. Répartition des cas selon la tranche d’âge
Tableau II. Répartition des cas selon le niveau d’étude
Tableau III. Répartition des cas selon la commune de provenance
Tableau IV. Répartition des cas selon la profession
Tableau V. Répartition des cas selon le mode d’admission
Tableau VI. Répartition des cas selon les motifs de consultation
Tableau VII. Répartition des cas selon la présentation fœtale à l’échographie
Tableau VIII. Répartition des cas selon le régime contractile
Tableau IX. Répartition des cas selon le diagnostic échographique
Tableau X. Répartition des cas selon le taux d’hémoglobine à l’admission
Tableau XI. Répartition des cas selon l’obtention de l’accouchement
Tableau XII. Relations entre l’antécédent d’avortement et la survenue du placenta prævia
Tableau XIII. Relation entre la survenue du placenta prævia sur un utérus cicatriciel
Tableau XIV. Relation entre la parité et la survenue du placenta prævia
X
RÉSUMÉ
Introduction Le placenta prævia est l’insertion du placenta en partie ou en totalité sur le segment inférieur de l’utérus compliqué d’hémorragie. Il constitue une urgence obstétricale et met en jeu le pronostic vital materno-fœtal. Cette étude vise à déterminer la prévalence du placenta prævia, les caractéristiques sociodémographiques et cliniques ainsi que les facteurs associés.
Méthodologie : Une étude analytique transversale rétrospective a été menée à la maternité de l’HGR/Jason Sendwe du 1Janvier 2023 au 31 Décembre 2024. Elle a inclus de façon exhaustive 65 cas de placenta prævia sur 1221 accouchements. Les données ont été collectés à partir des dossiers médicaux et analysés à l’aide du logiciels Excel et EPI info version 7.2.2.6. L’analyse bi variée a permis d’évaluer les associations entre le placenta prævia et certaines variables à l’aide de l’Odd ratio (OR) avec un intervalle de confiance à 95% et un seuil de signification de p<0,05.
Résultats : La prévalence du placenta prævia a été de 5,32%. Les femmes étaient âgée de 19 à 34 ans (61,53%), de niveau secondaire (49,23%), multipares (87,69%) provenant généralement de la commune annexe (41,54%) dans un contexte d’évacuation (56,92%). Aux antécédents de césarienne et avortements. L’analyse bi variée a mis évidence plusieurs facteurs associés : antécédent d’avortement [OR=6,83, p=0,001], la multiparité exposait les femmes à risque accru [OR=3,90, p=0,003], l’antécédent de césarienne présentait un risque accru non significatif [OR=2,4, p=0,07].
Conclusion Le placenta prævia est une pathologie fréquente et préoccupante à la maternité de l’HGR/Jason Sendwe. La multiparité et les antécédents d’avortements ressortent comme les principaux facteurs de risque significatif. L’absence de suivi prénatal et de diagnostic précoce constitue un obstacle majeur à la prévention des complications. Il est essentiel de renforcer les CPN, de systématiser les échographies obstétricales et de sensibiliser les femmes à la surveillance des grossesses à haut risque.
Mots clés : placenta prævia, prévalence, facteurs de risque
INTRODUCTION
1. État de la question
Le placenta prævia est l’insertion du placenta en partie ou en totalité sur le
segment inférieur de l’utérus compliqué d’hémorragie. Il constitue une urgence obstétricale et met en jeu le pronostic vital materno-fœtal de ce fait, il nécessite un diagnostic précoce, une prise en charge adéquate (Shreya A., 2024)
En Europe, le placenta prævia se complique de 0,3% à 0,5% des accouchements, 0,3% à 0,62% des accouchements en Amérique et de 0,5% à 0,9% des accouchements en Asie. Les fréquences les plus élevées sont rapportées en Afrique où le diagnostic est encore essentiellement clinique avec des taux variant entre 0,5% et 3,6% des accouchements (Stéphanie R, 2022)
Pathologie obstétricale redoutable où l’on préconisait l’interruption
systématique de la grossesse pour sauvetage maternel, le placenta prævia bénéficie actuellement de moyens diagnostiques et thérapeutiques modernes. L’utilisation de l’échographie dans le diagnostic du placenta prævia a permis une réduction considérable de la mortalité maternelle qui est passée de plus de 10 % dans les années 1940 à moins de 1 % actuellement. Proportionnellement, la mortalité périnatale a également baissé de plus de 70 % dans les années 1940 à 4-8 % de nos jours (Seon U, 2024).
Au Maroc, la fréquence de placenta prævia était de 0, 7%, 45,7% de cas
d’antécédents d’avortements, 17,1% de cas d’utérus cicatriciel. 42,7% des placentas restés bas insérés à terme ; Les types fréquents sont les types I (45,7%) et II (31,4%) avec comme anomalies : l’épaisseur excessive du placenta (2,4%) ; La sénescence précoce du placenta (1,8%) ; l’hématome retro placentaire (1%). Selon la forme clinique, le placenta prævia hémorragique représentaient une forte proportion par rapport à la forme asymptomatique (Hinde M,2023).
Au Mali, une étude avait démontré 504 cas sur 30323 au cours de 10 ans soit une
fréquence de de 1,7% des cas. les facteurs des risques identifiés incluent l’âge maternel avancé, la multiparité et les antécédents de césarienne. Le pronostic maternel était généralement bon tandis que le pronostic périnatal était dominé par la prématurité et une mortalité périnatale élevée. dans cette étude, l’association placenta prævia et l’hématome retro placentaire était significative (p<0,001). pour sauvetage maternelle, la césarienne était la voie principale d’accouchement avec 71,02% des cas (Diakalia K,2023).
En côte d’ivoire, une étude rétrospective avait analysé 340 cas de placenta
prævia sur une période de 5 ans et avait mis en évidence une fréquence de 1,12% des accouchement avec des complications maternelles et périnatales significatives la mortalité fœtale était de 39 % et 45,50% pour la prématurité (K. N’Guessan,2017).
Quant au Sénégal, une étude rétrospective menée dans quatre structures
sanitaires de référence à Dakar avait analyse le cas de placenta prævia sur une période de 2 ans. dans cette étude, 73,8% des cas, le placenta prævia était découvert au moment de l’accouchement, avec l’hémorragie comme principal symptômes (Abou B, 2024).
Une étude rétrospective menée dans quatre hôpitaux de la ville de Lubumbashi
en République Démocratique du Congo avait prouvé une fréquence d 1,25% des cas sur un total de 11076 accouchement. dans cette étude, l’âge moyen de patient était de 32,5 ans avec une prédominance des multipares. les principaux facteurs associés étaient les antécédents de césarienne et les grossesses multiples. la césarienne était pratiqué dans 91% des cas. la mortalité périnatale était élevée et lié principalement à la prématurité et les complications néonatales(Olivier M, 2021)
Jusqu’à l’heure actuelle, le placenta prævia reste considéré la cause principale
de décès maternel par hémorragie après la rupture utérine, l’hémorragie de la délivrance et l’hématome rétro-placentaire avec des fréquences allant de 0,9 à 1,78 % . Dans les pays en voie de développement, l’issue des grossesses compliquées de placenta prævia est encore défavorable dans la plupart des cas à cause de l’insuffisance des infrastructures et du sous équipement de nos centres de santé. la République démocratique du Congo notamment la ville de Lubumbashi n’est pas épargnée à cette situation préoccupante.
2. Question de recherche
- Quelle est la prévalence du placenta prævia à la maternité de l’HGR/Jason sendwe ?
- Quels sont les facteurs associés à la survenue du placenta prævia ?
3. Objectifs
3.1. Général
L’objectif général de cette étude est de contribuer à la prise en charge du couple
mère enfant en déterminant la prévalence et les facteurs associés aux placenta prævia dans la ville de Lubumbashi spécialement à l’HGR/Jason Sendwe.
3.2. Spécifiques
- Déterminer la prévalence des placenta prævia ;
- Décrire les caractéristiques sociodémographiques et obstétricales des gestantes concernées ;
- Décrire les modalités de prise en charge en cas de placenta prævia ;
- Déterminer les différents facteurs qui sont associés à la survenu du placenta prævia.
4. Justification de l’étude
Le placenta prævia comme anomalie d’implantation constitue une situation
préoccupante à l’obstétricien surtout à ce qui concerne la modalité de prise en charge, ainsi qu’à la gestion des perturbations materno-fœtales liées à cette vice d’insertion placentaire. Cette anomalie d’insertion placentaire constitue l’équivoque de consultation et aussi de référence à l’HGR/JASON SENDWE. C’est dans ce contexte que nous avons choisi ce sujet dans le but de déterminer sa prévalence et d’en décrire les différents facteurs qui sont à associés à cette anomalie d’insertion placentaire.
5. Délimitation spatio-temporelle
Pour de raison géographique et du temps, notre étude se limite de la manière
suivante :
- Dans le temps : cette étude couvre la période allant du 01 janvier 2023 au 31 décembre 2024
- Dans l’espace : c’est une étude menée et République Démocratique du Congo, dans la province du Haut-Katanga, ville de Lubumbashi spécialement à l’HGAR/Jason sendwe.
Subdivision du mémoire
Hormis l’introduction, conclusion et les suggestions, notre mémoire se subdivise
de la manière suivante :
- La première partie est réservée à la théorie et englobe les rappels sur le placenta et formation du segment inférieur ainsi que et les généralités sur le placenta prævia.
- La deuxième partie est pratique et elle est constitué des différents chapitres suivants :
présentation de l’HGR/SENDWE, méthodologies, résultats et en fin la discussion.
PREMIÈRE PARTIE : CONSIDÉRATIONS THÉORIQUES
Chapitre premier
RAPPEL SUR LE PLACENTA ET LE SEGMENT INFÉRIEUR
1.1.Placenta
Il est l’organe d’échange entre la mère et le fœtus. C’est un organe né en même
temps que l’embryon .Mais de son étude nous verrons :
1.1.1. Formation du placenta
Le trophoblaste qui va constituer le placenta apparaît dès le cinquième jour de
la fécondation. C’est la couche la plus superficielle du blastocyste. À partir du 5ème mois le placenta conserve la structure générale qu’il a désormais acquise. Son volume continue à s’accroître, les villosités se multiplient mais sans modification structurale.
1.1.2. Structure du placenta
- La plaque choriale : c’est la partie de l’enveloppe de l’œuf (chorion) où est resté un nombre de villosités.
- Les villosités choriales : elles se divisent en branches divergentes, les unes prenant contact avec la muqueuse utérine et s’y ancrant solidement (villosités crampons), les autres restent libres et baignant dans les lacs sanguins. La villosité est l’organe élémentaire du placenta. Elle est formée d’un axe vasculaire (artérioles et veines) et d’un revêtement qui se modifie avec l’âge de la grossesse.
- La caduque basale : dès la nidation la muqueuse utérine s’est transformée en caduque caractérisée par la présence des cellules déciduales, très grosses cellules à protoplasmes spumeux, spécifiques de la grossesse (Demissie K., 1999).
1.1.3. Aspect du placenta (anatomie macroscopique)
Examiné après la délivrance le placenta à terme est une masse charnue, discoïde
ou elliptique. Il mesure 16 à 20 cm de diamètre, son épaisseur est de 2 à 3cm au centre, 4 à 6 mm sur les bords. Son poids, au moment de la délivrance et à terme, est en moyenne de 500 à
600 gr, soit le 1/6 du poids du fœtus. Le placenta inséré dans l’utérus est beaucoup plus mince plus étalé que le placenta après son expulsion. Il est constitué de deux faces, fœtale et maternelle.
1.1.4. La circulation placentaire
La circulation placentaire s’établit dès le 9ème jour post conceptionnel. Il se
produit un échange continuel de substances entre le sang maternel et fœtal.
1.1.5. Membranes de l’œuf
On décrit à l’œuf trois membranes : le chorion, l’amnios et la caduque.
- chorion : partie située entre la caduque et amnios, est fibreuse et transparente. Elle est résistante .Dans le placenta elle devient la plaque choriale d’où émanent les villosités choriales. À l’orifice interne du col, le chorion est directement en rapport avec le bouchon du mucus qui obture le canal cervical. À la fin du 3ème mois, l’amnios et le chorion fusionnent.
- L’amnios : est une membrane mince, transparente, très résistante qui circonscrit en dedans la cavité amniotique. Membrane interne, il tapisse la face interne du placenta, engraine le cordon et rejoint à l’ombilic la peau du fœtus (Demissie K., 1999)..
1.2. Segment inférieur
C’est la couche basse, amincie de l’utérus gravide, située entre le corps et le col.
Il n’existe que pendant la grossesse et n’acquiert son plan de développement que dans les trois derniers mois.
- Forme : il a une forme d’une calotte évasée, ouverte en haut.
- Situation : il occupe au-dessus du col le tiers inférieur de l’utérus.
- Caractère : Son caractère essentiel est sa minceur de 2-4mm, qui s’oppose à l’épaisseur du corps.
- Limites: la limite inférieure correspond à l’orifice interne du col, la limite supérieure est marquée par le changement de l’épaisseur de la paroi qui augmente.
- Origine et formation : le segment inférieur se développe au dépend de l’isthme utérin.
Mais il n’acquière son ampleur qu’après le 6ème mois. Pendant le travail le col effacé et dilaté se confond avec le segment inférieur pour constituer le canal cervicosegmentaire.
- Rapports : en avant : le segment inférieur est recouvert par le péritoine viscéral solide et facilement décollable, alors qu’il adhérait au corps. Latéralement : la gaine hypogastrique contient les vaisseaux utérins croisés par l’uretère. En arrière : le profond cul-de-sac de Douglas sépare le segment inférieur du rectum et du promontoire.
- Structure : le segment inférieur est constitué essentiellement de fibres conjonctives et élastiques en rapport avec son extensibilité. La muqueuse se transforme en mauvaise caduque, impropre à assurer parfaitement la placentation.
- Les dimensions : le segment inférieur mesure 10cm de hauteur] 9-12 cm de largeur et 3-5 mm d’épaisseur. Les dimensions varient selon la présentation et le degré d’engagement (Demissie K., 1999).
- . Physiologie : l’importance du segment inférieur est considérable au triple point de vue à savoir :
- Point de vue clinique : l’étude clinique montrera la valeur pronostique capitale qui s’attache à sa bonne formation, à sa minceur, au contact intime qui prend avec la présentation.
- Point de vue physiologique : c’est une zone de transmission, mais aussi d’accommodation d’effacement qui, après avoir conduit à la contractilité du corps vers le col, laissera aisément le passage au fœtus. Il reste au contraire flasque, épais et distend dans la dystocie.o Point de vue pathologique : il régit deux des plus importantes complications de l’obstétrique. C’est sur lui que s’insère le placenta prævia, c’est lui qui est intéressé dans presque toutes les ruptures utérines.
DEUXIÈME PARTIE : CONSIDÉRATIONS PRATIQUES
Chapitre Deuxième
GÉNÉRALITÉS SUR LE PLACENTA PRÆVIA
2.1. Définition
On dit qu’il y a placenta prævia lorsqu’un placenta s’insère sur tout ou une partie
du segment inférieur de l’utérus. Normalement le placenta s’insère sur le fond et sur l’une des faces du corps de l’utérus (Boog G, 1983).
2.2. Epidémiologie
- La prévalence mondiale du placenta prævia est estimée entre 0,3% et 0,5% des grossesses. Dans certains contextes à haut risque ou en milieu tertiaire, elle peut atteindre 1%
- Les études Africaines ou en milieu à ressources limitées rapportent une prévalence variable, entre 0,2% et 1,5%.
2.3. Classification
Considérant l’insertion basse du placenta, nous avons plusieurs classifications, notamment :
- la classification anatomique
- la classification clinique
- classification échographique(BESSIS)
2.3.1. Classification anatomique
- Pendant la grossesse, (distingue 4 stades par rapport à l’orifice interne du col. Le repère est l’orifice interne du col.
- Stade 1 : pp latéral ; le placenta s’insère sur le segment inférieur et reste à distance de l’orifice interne du col.
- Stade 2 : pp marginal ; le placenta affleure l’orifice interne du col. o Stade 3 : pp partiel ; le placenta recouvre seulement une partie du col. o Stade 4 : pp centra ou total ; le site d’implantation recouvre en totalité l’orifice interne du col.
- Pendant le travail o Placenta prævia non recouvrant : le bord placentaire ne déborde jamais l’orifice interne du col c’est l’équivalent au cours de la grossesse du placenta prævia latéral ou marginal.
o Placenta prævia recouvrant : une partie plus ou moins importante du placenta recouvre l’orifice interne du col et apparaît dans l’aire de dilatation du col. Les membranes ne sont pas accessibles.
2.3.2. Classification échographique
2.3.2.1. BESSIS
- Placenta prævia antérieur : le repère est la vessie o Type 1 : le bord inférieur du placenta recouvre le tiers supérieur de la vessie. o Type 2 : le bord inférieur du placenta recouvre les 2 tiers supérieurs de la vessie. o Type3 : le bord inférieur du placenta affleure l’orifice cervical interne. o Type 4 : le bord inférieur du placenta recouvre complètement l’orifice interne du col.
- Placenta prævia postérieur : le repère est l’orifice interne du col o Type 1 : limite inferieure est moins de 4 cm de l’orifice interne du col o Type 2 : affleure l’OC o Type 3, 4 : recouvrant (Bessis R., 1976)
2.3.2.2. DENHEZ o Groupe 1 : placenta fundique ; la limite supérieur du placenta atteint ou dépasse le fond utérin
- Groupe 2 : la limite supérieure du placenta est dans la moitié sup de l’utérus.
- Groupe 3 : le placenta est entièrement dans la limite inférieure de l’utérus (Brenner
W., 1978)
2.4. Mécanisme d’implantation basse
- Nidation primitive du blastocyste au niveau du segment inferieur qui est due
- soit à un transfert accéléré de l’œuf
- soit à une insertion préférentielle sur muqueuse cicatricielle o soit à un trouble de l’organogénèse avec un retard de développement ovulaire
stade de blastocyte atteint au voisinage du col.
- Implantation basse secondaire : Résulte d’une extension progressive vers l’orifice cervicale d’un placenta normalement inséré au début de la grossesse (grossesses multiples).
2.5. Facteurs étiologiques
- Parité
- L’âge maternel sup à 35 ans ;
- Race noire ;
- Multiparité ;
- ATCDS d’avortements spontanés ou provoqués avec curetage ou toutes manœuvres endo-utérines (DA, RU) ;
- Cicatrice utérine et lésions endometriale
- ATCDS de placenta prævia ;
- Gémellité (Keita S B. 1997 )
2.6.. Physiopathologie
Le placenta inextensible inséré sur le segment inferieur qui est extensible, il en
résulte l’ouverture des sinus veineux de la caduque qui découle de la séparation mécanique des cotylédons de leur lien d’implantation lors de la formation du segment inférieur ou lors de l’effacement et de dilatation du col avec comme conséquence l’hémorragie qui est dans la plus grande partie, d’origine maternelle. La contribution fœtale de l’hémorragie est estimée à 4 % (Bagayoko S., 2002).
1.6.1. Mécanisme de l’hémorragie
Il existe deux théories qui explique l’hémorragie au cours d’un placenta prævia
notamment : la théorie de tiraillement et la théorie de glissement.
❖ Pendant la grossesse, nous avons la THEORIE DE BRAXTON HIS (tiraillement) o Dans les variétés périphériques ; les contractions physiologiques de braxton hixs et les rapports sexuels entrainent un décollement de languette placentaire ouvrant les sinus utérin qui saignent par tiraillement du petit côté des membranes. o Dans les formes recouvrantes ( théorie de PINARD) ; il existe un clivage entre le placenta et le myomètre par suite d’un asynchronisme de développement entre le segment inférieur qui poursuit son ampliation pendant les 3 derniers mois de la grossesse alors que la surface placentaire atteint son maximum dès la 36 ème semaines (Diallo A., 2008)
❖ Pendant le travail, la théorie de SCHROEDER (glissement)
Au cours de la dilatation, le segment inférieur glisse de bas en haut sur la surface de l’œuf. Cette rétraction des fibres myometriales décolle progressivement une fraction de plus en plus grande du placenta.
1.6.2. Origine de l’hémorragie
L’hémorragie extériorisé a une double origine
- Sinus maternels : lors du décollement de languette placentaire inférieure, les sinus veineux de la caduque restent béants, en fin de grossesse qu’au cours de la dilatation, car la rétraction musculaire (paleomyometre) qui assure normalement l’hémostase ne peut pas produire avant l’expulsion fœtale.
- Les capillaire sinusoïdaux fœtaux : le décollement d’un bords placentaire et le clivage en regard de la caduque déchire des villosités choriales avec issu du sang fœtale dans l’espace intervilleux et dans le sinus veineux maternels de la caduque (Guiadem F., 1990).
2.7. Diagnostic
❖ Diagnostic clinique o Signes fonctionnels : est représenté par des hémorragies sous forme de métrorragies. Les caractères de ces hémorragies sont :
- Leur moment de survenue : dans les deux derniers trimestres de la grossesse (2ème ou 3ème)
- Leur aspect : sang rouge s’écoulant à la vulve et qui coagule
- Le facteur déclenchant : sang apparaissant sans cause déclenchant survenant la nuit ou le jour en position debout ou couchée en dehors de tout effort physique.
- Apparition spontanée
- indolore
- Abondance : abondance est variable
- Évolution : très capricieuse, imprévisible de telle sorte que leur survenue en fin de grossesse impose l’hospitalisation en milieu spécialisé, elle s’arrête le plus souvent spontanément ou après repos et traitement antispasmodique mais ayant une tendance à récidiver (Miliez J. 1991).
o Signes généraux : leurs importance est en rapport avec l’importance de l’hémorragie ; pâleur, vertige, soif d’air, refroidissement des extrémités, accélération du pouls, chute de la TA.
o Signes physiques
- L’inspection : le speculum confirme l’origine endo-utérines du saignement.
- La palpation : retrouve un utérus souple sans contracture, présentation souvent irrégulière, haute, mobile, mal accommodé au détroit supérieur.
- auscultation : BCF souvent présent, mais être perdu en cas de choc hémorragique maternelle
- Le TV est dangereux, réalisé avec prudence retrouve une présentation haute et le signe du matelas placentaire. ce toucher montre souvent le col dévié attiré du côté de l’insertion placentaire, le doigt introduit dans le cul de sac vaginaux confirme que la présentation reste haute plus le signe de matelas placentaire qui est une sensation de masse spongieuse traduisant l’interposition entre le doigt et la présentation (Houessou H., 1983).
v Forme cliniques o Formes asymptomatiques : les formes muettes du placenta prævia représentent
2 à 34 % des observations. L’insertion basse peut être découverte à l’occasion d’une présentation transversale ou d’une échographie près du terme ou lors d’une césarienne pratiquée avant le début du travail en raison d’une grossesse pathologique. D’autres placentas prævia ne sont reconnus qu’à la délivrance artificielle ou à l’examen des membranes sur le produit du délivre (petit côté des membranes inférieur 10cm).
- Forme hémorragique : c’est un placenta inséré anormalement sur le segment inférieur qui provoque des hémorragies indolores, rouges vives, souvent à répétition au troisième trimestre de la grossesse lorsque le segment inférieur de l’utérus s’amincit et se dilate en fin de la grossesse conduisant au décollement du placenta (Kone F. 1989).
- Formes associées à un décollement prématuré du placenta : Il s’agit, le plus souvent, de l’hématome décidual marginal et plus rarement l’hématome décidual basal. Son tableau clinique n’est pas toujours typique mais son pronostic est grave pour la mère et elle est quatre fois plus fréquente que lors des accouchements normaux.
- Placenta accreta : est une anomalie d’insertion placentaire dans laquelle le placenta s’attache de façon anormale à la paroi utérine, voire l’envahit. C’est une cause majeure d’hémorragies obstétricales sévères, souvent associées au placenta prævia (Chattopadhyah S., 1993)
v Diagnostic para clinique (Herlyn U.,1999)
A) Imagerie o Échographie obstétricale par voie abdominale : c’est le premier examen à réaliser. Il permet de montrer un placenta bas inséré, recouvrant partiellement ou totalement l’orifice cervical interne
- Échographie transvaginale ( endovaginale) : permet de visualiser avec précision le type de placenta prævia ( marginal, partiel, total), la distance entre le bord placentaire et l’orifice interne. c’est un examen sûre et non invasif
- IRM (imagerie par résonnance magnétique nucléaire) : indiquée en cas de suscipision de placenta accreta (surtout en présence d’un placenta prævia antérieur
o Echocardiotocographie
B) Examens biologiques o NFS ( numération formule sanguine) : permet d’évaluer le taux d’hémoglobine et l’hématocrite en fin de détecter une anémie
- Groupage sanguin (ABO et rhésus) o Bilan de coagulation : taux de prothrombine (TP), Temps de céphaline activée(TCA), fibrinogène, D-dimère si CIVD suspecté. ces examens permettent de rechercher le trouble de la coagulation surtout si hémorragie massive
- Bilan de retentissement :
- Ionogramme sanguin ( Na+, K+, Cl-, bicarbonates) : permet de
d’évaluer les déséquilibres électrolytiques si l’état de choc ou troubles métaboliques
- Gaz artériel si détresse respiratoire.
2.8. Complications
Les complications peuvent survenir pendant ou après l’accouchement.
- Pendant la grossesse o Hémorragie antepartum : rouge vif, indolore souvent à répétition pouvant provoquer le choc hémorragique chez la mère et un risque accru de souffrance fœtale ou de mort fœtale in utero si hémorragie sévère
- Anémie maternelle qui résulte de la spoliation sanguine o Prématurité o Placenta accreta si placenta prævia avec utérus cicatriciel
- Complication perpartum o Hémorragie de la délivrance expliquée par une mauvaise contractilité du segment inférieur (où se situe le placenta) et l’impossibilité de la rétraction efficace des vaisseaux après expulsion placentaire
- Césarienne hémorragique : saignement important possible pendant l’incision utérine si placenta antérieur
- Lésions iatrogène : vessie ou rectum surtout en cas de placenta percreta
- Complication post-partum o Atonie utérine : difficulté de rétraction de l’utérus au niveau du segment inférieur conduisant à une hémorragie du post-partum persistante
- infection
- Trouble de la coagulation : en cas d’hémorragie massive, consommation des facteurs de coagulation avec un risque de coagulopathie de consommation ou CIVD
2.9. Diagnostic différentiel
- Décollement placentaire (Hématome retro placentaire) : saignement noirâtre, associé une douleur intense et utérus contracté (utérus de bois), tonus utérin augmenté.
Il s’agit souvent d’un saignement douloureux avec présence des signes souffrances fœtales ;
- Rupture utérine : douleur abdominale brutale, disparition des contractions après rupture. altération rapide du rythme cardiaque fœtale, hémorragie souvent interne peu visible au niveau vaginale survenant souvent chez une femme avec utérus cicatriciel ;
- Vasa prævia : l’hémorragie d’origine fœtale rapide, bradycardie fœtale du fœtus.
2.10. Prise en charge
2.10.1. But du traitement
- Dans un 1er temps, arrêter l’hémorragie ;
- Dans un 2ème temps : corriger les conséquences de l’hémorragie.
- Dans tous les cas, sauver la vie de la mère et si possible du fœtus.
En présence d’un placenta prævia hémorragique, l’attitude thérapeutique à adopter est la suivante : l’hospitalisation en milieu obstétrical. Ce centre spécialisé doit répondre à trois impératifs :
- Équipe multidisciplinaire avec un gynécologue obstétricien, un anesthésiste réanimateur et un pédiatre néonatologue, disponible 24/24 heures,
- Appareillage d’échotomographie, o Sang frais disponible en permanence
A) Avant 34SA
- Hospitalisation systématique si saignement actif ou antécédent d’hémorragie
- repos strict au lit
- surveillance materno-fœtale :
- Monitoring cardiaque fœtale
- évaluations des constantes maternelles et du taux d’hémoglobine
- Corticothérapie Bétaméthasone ou dexametasone pour accélérer la maturation pulmonaire
- Tocolyse en cas de contraction, si absence d’indication d’extraction immédiate v Transfusion sanguine si besoin.
B) Entre 34 et 36+6 jours
- Hospitalisation ou surveillance rapprochée à domicile si la patiente est stable et motivée en fin de gagner du temps pour la maturation fœtale
- l’accouchement est envisagé dès apparition de saignement important ou à partir de 36-37SA si la situation reste stable.
C) À terme
- Accouchement programmé par césarienne, même sans saignement, en cas de placenta recouvrant ou partiellement recouvrant
- Si placenta marginal : essaie d’accouchement par vaginale, sous condition très stricte, avec bloc opératoire disponible
2.10.2. Modalité d’accouchement
v La césarienne est indiquée dans le cas suivant :
- Placenta prævia recouvrant total ou partiel – Saignement actif
- Souffrance fœtale
- Placenta accreta suspecté (Danzer M., 1986 ) v Voie basse est envisageable si :
- Placenta marginal ou bas inséré
- Absence de saignement actif
- surveillance continue disponible
DEUXIÈME PARTITE : CONSIDÉRATIONS PRATIQUES
Chapitre Deuxième
PRÉSENTATION DU CADRE DE RECHERCHE
2.1. Situation géographique
L’hôpital général provincial de référence Jason Sendwe est situé dans la zone de
santé de Lubumbashi, dans la partie Est de la commune de Lubumbashi. IL est limité par:
- Au nord par l’avenue Sendwe
- Au sud par l’avenue des écoles
- À l’Est par le lycée Wema
- À l’ouest par l’avenue Likasi.
Cet hôpital d’intérêt public comprend deux grandes parties à savoir: la partie
pavillonnaire et la partie en étage dans lesquelles nous trouvons plusieurs services hospitaliers
2.2. Historique
L’hôpital général provincial de référence Jason Sendwe appelé jadis Hôpital
prince LEOPOLD fut construit en 1928. Les mobiles qui avaient poussé les autorités de l’époque à construire cet hôpital propre aux indigènes furent à la fois d’ordre social et humanitaire c’est-à dire la lutte contre les maladies endémiques dues à la poussée démographique, afin d’éviter la contagion dans l’hôpital reine ELISABETH (Hôpital pour blancs) cet Hôpital dont l’édification n’a pas été une tâche fut construit en deux phases à savoir:
- La première phase : cette phase de construction consacrée à la partie pavillonnaire fut exécutée en 1928. Elle comptait à sa construction 350 lits. Elle abrite plusieurs services hospitaliers, techniques ainsi que les services généraux.
- La seconde phase quant à elle portera sur la construction de l’édifice à étages 1958.
Toute fois une aile sera construite avant l’accession de notre pays à l’indépendance. Les travaux seront interrompus suite aux événements malheureux qui avaient suivi l’indépendance du pays.
Il fut signalé que c’est un hôpital de l’État qui sera géré jusqu’en 1962 par l’État
lui-même. En 1962, suite à l’installation du camp des réfugiés de triste mémoire entre la Ruashi où se trouvait l’hôpital universitaire de l’université officiel du Congo et La ville, les autorités de l’université seront incapables d’accomplir la formation des étudiants en médecine et se verront obliger de déménager pour s’installer à l’hôpital Sendwe. À partir de cette date une gestion bicéphale avec direction de l’état à côté de celle de l’université.
2.3. La structure administrative
Elle est dirigée par un comité de gestion composé d’un médecin directeur et d’un
administrateur gestionnaire. Le comité s’occupe de l’administration courante de l’hôpital, coordonne les différents services, engage et affecte les personnels soignants selon la formation de chacun.
2.4. La structure médicale
Elle est dirigée par un médecin directeur qui coordonne les services médicaux.
C’est un secteur très vaste qui comprend plusieurs services spécialisés à savoir:
- La médecine interne ;
- La chirurgie ;
- La gynécologie ; – La pédiatrie.
L’hôpital du jour qui comprend les dispensaires: Ophtalmologie, Otorhinolaryngologie, gynécologie, pédiatrie, médecine interne, chirurgie, les urgences et le service de protection maternelle et infantile.
2.5. La capacité d’accueil
L’hôpital général provincial de référence Jason Sendwe avec sa capacité actuelle
de 345 lits est classé en deuxième position après l’hôpital général de Kinshasa, il sert pour ainsi dire la population de toutes les communes de Lubumbashi, mais aussi celle venant de tout le reste du Katanga, de deux Kasaï et du sud Kivu. Vu son importance de 345 lits, il connaissait un pourcentage d’occupation de plus de 50%.
Troisième Chapitre
MATÉRIELS ET MÉTHODES
3.1. Type et période d’étude
Il s’agit d’une étude analytique transversale retro-prospective réalisée à la
maternité de l’hôpital général Jason Sendwe de Lubumbashi durant la période allant du 01 janvier 2023 au 31/décembre 2024 soit 2 ans.
3.2. Population d’étude
La population d’étude concerne toutes les femmes enceintes qui ont accouchée
à la maternité de l’hôpital général Jason Sendwe durant la période précitée. La taille de cette population était estimée à 1221 cas.
3. 3. Échantillonnage
3.3.1. Technique d’échantillonnage
Nous avons utilisé un échantillon exhaustif c’est-à-dire aucune technique n’a
été utilisée pour la constitution de l’échantillon, toutes les unités statistiques ont été considérées.
3.3.2. Taille de l’échantillon
La taille de l’échantillon est constituée de 65 cas des placentas prævia sur
l’ensemble de femmes enceintes qui ont accouchées à l’HGR/Jason Sendwe.
3.4. Critère de sélection
3.2.4.1. Critère d’inclusion
Étaient incluses dans cette étude, toutes les femmes enceintes dont le diagnostic
de placenta prævia a été posé avant l’accouchement ou après l’accouchement par la clinique ou encore la para clinique et dont leurs dossiers médicaux ont été retrouvé bien remplis.
3.2.4.2. Critère de non inclusion
Ont été non incluses de cette étude, toutes les femmes ne répondant pas au
critère défini ci haut.
3.5. Technique des collectes des données
Pour collecter les données, nous nous sommes servi de la technique d’analyses
documentaires à partir des fiches d’admissions, fiches d’hospitalisations, et le cahier des registres des femmes qui ont accouchées à la maternité de l’HGR/Jason Sendwe.
3.6. Variables retenues
- Variables sociodémographiques : âge, état-civil, niveau d’étude, profession, provenance, mode d’admission ;
- Variables obstétricales : parité, CPN, antécédent de césarienne, antécédent d’avortement, antécédent de placenta prævia, âge de la grossesse ;
- Variables cliniques : motifs de consultation, état général, état de choc, régime contractile, présentation, BCF ;
- Variables para cliniques : échographie ;
- Prise en charge : traitement symptomatique, obtention de l’accouchement, voie d’accouchement, issu.
3.7. Gestion et analyse statiques des résultats
Les données ont été gérées dans l’ordinateur et analysées à l’aide des outils informatiques comme le Microsoft Excel et EPI-info pour la présentation des résultats sous forme des tableaux et graphiques et Microsoft Word pour la saisie de données. Les paramètres d’associations utilisés sont Odd ratio et l’intervalle de confiance définie à 95%, P-value est utilisé comme test statistique avec seuil de signification de 0,05. Dans cette étude, les cas sont définis par toutes les femmes enceintes dont le diagnostic clinique ou para clinique de placenta prævia était posé et les témoins sont les femmes enceintes présentant d’autres pathologies que le placenta prævia durant la même période d’étude. Nous avons considéré dans cette étude 1 cas pour 1 témoin.
3.8. Difficultés rencontrées
Nous avons rencontré les difficultés suivantes : les coupures intempestives du courant électrique, la multiplicité de rendez-vous pour avoir accès aux documents des malades et certaines fiches ne présentaient pas toutes les données nécessaires ou incorrectement remplies.
Pour contourner à ces genres des difficultés, nous avons fait recours à l’énergie fourni par les générateurs, nous nous sommes pliés aux caprices des responsables de services de l’HGR/Jason Sendwe et nous avons déconsidéré certaines fiches mal remplies.
3.9. Considérations éthiques
Les informations médicales étant légitimes : avant la descente sur terrain, nous
avons eu à obtenir la fiche d’enquête auprès des autorités de la faculté, et sur terrain l’avis du médecin directeur. De notre part, nous avons utilisé ces données que dans le seul but scientifique.
Chapitre Quatrième
PRÉSENTATIONS DES RESULTATS
4.1. Prévalence
Dans l’intention de déterminer la prévalence et les facteurs associés aux
placentas prævia, nous avons mené une étude analytique rétrospective à la maternité de l’HGR/Jason Sendwe de Lubumbashi durant la période allant du 01/janvier 2023 au décembre 2024. Pendant cette période 1221 dossiers médicaux ont été analysés. La prévalence a été de 65 cas soit un taux de 5,32%.
Figure 1. Prévalence du placenta prævia à la maternité de l’HGR/Jason Sendwe
4.2.Caractéristiques sociodémographiques, cliniques et obstétricales 4.2.1. Age des malades
Tableau I. Répartition des cas selon la tranche d’âge
7 10,77
18-34 ans 40 61,54
≥35 ans 18 27,69
La tranche d’âge comprise entre 18-34 ans a été plus représentée par rapport à d’autres tranches d’âge avec 61,53% des cas.
4.2.2. État-civil
Les femmes mariées ont représenté une proportion élevée par rapport aux célibataires avec 75,38% des cas.
Figure 2. Répartition des cas selon l’État civil 4.2.3. Niveau d’étude des malades
Tableau II. Répartition des cas selon le niveau d’étude
| Niveau d’étude | Effectifs | Pourcentage |
| Certificat | 17 | 26,15 |
| Diplômée | 32 | 49,23 |
| Graduée | 10 | 15,39 |
| Licencié | 6 | 9,23 |
| Total | 65 | 100,00 |
Les femmes diplômées ont été plus nombreuses avec 49,23% des cas
4.2.4. Provenance des malades
Tableau III. Répartition des cas selon la commune de provenance
| Provenance | Effectifs | Pourcentage |
| Annexe | 27 | 41,54 |
| Lubumbashi | 11 | 16,92 |
| Kapemba | 7 | 10,77 |
| Katuba | 4 | 6,15 |
| Kamalondo | 9 | 13,85 |
| Kenya | 2 | 3,08 |
| Rwashi | 5 | 7,69 |
| Total | 65 | 100,00 |
La plus part des femmes venaient de la commune annexe soit 41,54% des cas 4.2.5. Profession des malades
Tableau IV. Répartition des cas selon la profession
| Profession | Effectifs | Pourcentage |
| Agents de l’état | 10 | 15,38 |
| Travailleur libre | 32 | 49,23 |
| Travailleur dans les secteurs privés | 23 | 35,38 |
| Total | 65 | 100,00 |
Les femmes des fonctions libérales ont représenté une proportion de 49,23% des cas
4.2.6. Mode d’admission des malades
Tableau V. Répartition des cas selon le mode d’admission
| Mode | Effectifs | Pourcentage |
| Référée | 21 | 32,31 |
| Évacuée | 37 | 56,92 |
| Venu d’elle-même | 7 | 10,77 |
| Total | 65 | 100,00 |
Ce tableau prouve que 56,92% des femmes ont été évacuées
4.2.7. Antécédent d’avortement
Les antécédents d’avortements ont été retrouvés chez 36 femmes soit 55,38% des cas
Figure 3. Répartition des cas selon les antécédents d’avortements
4.2.8. Antécédent de césarienne
Il ressort de cette figure que 23,08% des femmes ont été césarisée ultérieurement
Figure 4. Répartition des cas selon les antécédents de césarienne
4.2.9. Parité des malades
Les multipares ont été plus nombreux par rapport aux primipares soit 87,69% des cas
4.2.10. Age de la grossesse
L’âge de la grossesse était compris entre 38-40 SA pour la plus part des femmes soit 78,46% des cas.
Figure 6. Répartition des cas selon l’âge de la grossesse
4.2.11. Suivi de la CPN
Cette figure montre que 70,77% des femmes n’ont pas été suivi pendant la grossesse
Figure 7. Répartition des cas selon le suivi des consultations prénatales
4.2.12. Réalisation de l’échographie du deuxième trimestre
L’échographie du 2ème trimestre n’a pas été réalisée par 56 femmes soit 86,15% des cas
Figure 8. Répartition des cas selon la réalisation de l’échographie au 2ème trimestre
4.2.13. Type de grossesse
Les grossesses mono-fœtales ont été plus nombreuse soit 93,85% par rapport aux grossesses gémellaires
Figure 9. Répartition des cas selon le type de grossesse
4.2.14. Motifs de consultation
Tableau VI. Répartition des cas selon les motifs de consultation
| Motifs de consultation | Effectifs | Pourcentage |
| Saignement génital de moyenne quantité et en travail | 25 | 38,46 |
| Saignement génital de grande quantité et en travail | 34 | 52,30 |
| Saignement génital sans travail | 6 | 9,23 |
| Total | 65 | 100,00 |
Le motif de consultation a été marqué par un saignement génital de grande quantité sur le fond de travail dans 52,30% des cas contre 9,23% des cas des douleurs sans saignement.
4.2.15. État général
La proportion de femme avec un état général altéré a été plus grande soit 60,00% des cas.
Figure 10. Répartition des cas selon l’état général
4.2.16. Présence de l’état de choc
L’état de choc a été retrouvé dans 55,38% des cas
Figure 11. Répartition des cas selon la présence de l’état de choc
4.2.17. Présentation fœtale à l’échographie
Tableau VII. Répartition des cas selon la présentation fœtale à l’échographie
| Présentation | Effectifs | Pourcentage |
| Céphalique | 31 | 47,69 |
| Transverse | 25 | 38,46 |
| Siège | 9 | 13,85 |
Total 65 100,00
La présentation céphalique et transverse a été fréquemment retrouvé avec des proportions de 47,69 et 38,46% des cas
4.2.18. Régime contractile
Tableau VIII. Répartition des cas selon le régime contractile
| Régime contractile | Effectifs | Pourcentage |
| Utérus relâché | 6 | 9,23 |
| 2 contractions | 22 | 33,85 |
| ≥ 3 contractions | 37 | 59,92 |
| Total | 65 | 100,00 |
Ce tableau montre que 59,92% des femmes ont été vue en deuxième phase d’accouchement avec un régime contractile ≥ 3 contractions contre 9,23% des femmes qui n’étaient pas en
travail
4.2.19. BCF
Le BCF présent a été retrouvé chez 68,11% des fœtus et absent dans 31,88% des cas
Figure 12. Répartition des cas selon la présence de BCF
4.2.20. Diagnostic échographique en salle de naissance
Tableau IX. Répartition des cas selon le diagnostic échographique en salle de naissance
| Échographie | ||
| Antérieure | Effectifs | Pourcentage |
| BESSIS I | 3 | 4,62 |
| BESSIS II | 5 | 7,69 |
| BESSIS III | 18 | 27,69 |
| BESSIS IV | 15 | 23,08 |
| Postérieur BESSIS I | 1 | 1,54 |
| BESSIS II | 0 | 0,00 |
| BESSIS III | 14 | 21,54 |
| BESSIS IV | 9 | 13,85 |
| Total | 65 | 100,00 |
Selon le diagnostic échographique, la forme BESSIS III et IV antérieur et postérieur a été retrouvée chez la plus part des femmes avec des proportions 27,69, 23,08, 21,54 et 13,85% des cas
4.2.21. Taux d’hémoglobine à l’admission
Tableau X. Répartition des cas selon le taux d’hémoglobine à l’admission
| Taux de l’hémoglobine | Effectifs | Pourcentage |
| 9-11g/dl | 29 | 44,62 |
| 8-5g/dl | 27 | 41,54 |
| < 5g/dl | 9 | 13,85 |
| Total | 65 | 100,00 |
Le taux d’hémoglobine à l’admission était de 8-5g/dl pour 27 gestantes soit 41,54% des cas contre 9 soit 13,85 avec un taux < 5g/dl
4.2.22. Prise en charge symptomatique
La prise en charge symptomatique a été réalisée en urgence par un remplissage vasculaire au sérum physiologique et la transfusion sanguine soit 90,77% des cas
Figure 13. Répartition des cas selon la prise en charge symptomatique
4.2.23. Voie d’accouchement
Tableau XI. Répartition des cas selon l’obtention de l’accouchement
| Accouchement | Effectifs N=65 | Pourcentage | |
| Oui | 55 | 84,62 | |
| Non | 10 | 15,38 | |
| Total | 65 | Voie N= 55 | 100,00 |
| Haute | 44 | 80,00 | |
| Basse | 11 | 20,00 | |
L’accouchement a été obtenu dans 84,62 % des cas avec comme voie principale la césarienne soit 80,00% des cas
4.2.24. Issue maternelle
La proportion de décès a été de 7,69% des cas et un taux favorable de 92,31% des cas
Figure 14. Répartition des cas selon l’issus maternel
4.3.Facteurs associés
4.3.1. Placenta prævia et l’antécédent d’avortement
Tableau XII. Relations entre l’antécédent d’avortement et la survenue du placenta prævia
| Antécédent d’avortement | Cas | Témoins | Total | OR/IC 95% | P<0,05 |
| Avec antécédent | 36 (55,4%) | 10(15,4%) | 46 | ||
| Sans antécédent | 29 (44,6%) | 55(84,6%) | 84 | 6,83[2,97-15,68] | 0,001 |
| Total | 65 | 65 | 130 |
L’antécédent d’avortement est un facteur de risque significatif du placenta prævia (OR 6,83[2,97-15,68], p=0,001
4.3.2. Placenta prævia et utérus cicatriciel
Tableau XIII. Relation entre la survenue du placenta prævia sur un utérus cicatriciel
Antécédent de Cas Témoins Total OR P<0,05 césarienne
Avec antécédent 15(23,1%) 7(10,8% 22
Sans antécédent 50(76,9% 58(89,2%) 108 2,49[0,94- 0,07
6,60]
L’antécédent de césarienne augmente le risque de placenta prævia OR 2,49[0,94-6,60], mais sans atteindre la signification (P=0,07)
4.3.3. Placenta prævia et parité
Tableau XIV. Relation entre la parité et la survenue du placenta prævia
| Parité | Avec placenta prævia | Sans placenta prævia | Total | OR/IC 95% | P<0,05 |
| Multipare | 57 (57,6%) | 42(42,4%) | 99 | ||
| Primipare | 8 (25,8%) | 23(74,2%) | 31 | 3,9[1,59-9,55] | 0,003 |
| Total | 65 | 65 | 130 |
Les femmes multipares présentaient un risque d’environ 4 fois plus élevé que les primipares (OR 3,90[1,59-9,55], p=0,003)
Chapitre Cinquième
DISCUSSION
5.1.Prévalence
La prévalence du placenta prævia retrouvée dans notre étude est de 65 cas soit
un taux de 5,32%. Comparativement à la revue littéraire, ce chiffre est élevé par rapport aux données classiques rapportées dans la littérature internationale. En effet, les études menées en Europe, en Amérique, et en Asie rapportent des prévalences variant entre 0,3% et 0,9%, tandis qu’en Afrique, le taux oscillent entre 0,5 et 3,6% (Stéphanie R, 2022). Cette importante différence observée à la maternité de l’HGR/Jason Sendwe s’expliquerait par plusieurs facteurs locaux, notamment la forte proportion des gestantes à risque caractérisé par la multiparité. Et aussi cette différence serait aussi dite à la taille de la population et le nombre d’année d’étude considérée dans chaque étude.
5.2.Données sociodémographiques 1. Age
Dans notre étude, la tranche d’âge de 18 à 34 ans a été la plus représenté avec 61,53%. Cette donnée diffère de plusieurs études citée dans la revue de la littérature où le placenta prævia est plus tôt associé l’âge maternel avancé. Au mali, l’étude de Diakalia K, 2023 avait montré que l’âge avancé est un facteur de risque important (Diakalia K,2023). De même Olivier M, 2021 avait rapporté un âge moyen de 32,5 ans à Lubumbashi (Olivier M, 2021).
Nos résultats pourraient s’expliquer par une forte fécondité dans les jeunes tranches d’âges.
2. Niveau d’étude
Les femmes de niveau secondaire ont été plus nombreuses dans notre étude avec
49,23%. il est connu que le niveau d’instruction élevé facilite l’accès aux soins prénatals, ce qui pourrait expliquer leurs surreprésentations dans les hôpitaux publics.
3. Provenance
Concernant le milieu de provenance, 41,54% des patients venaient de la
commune annexe. La proximité géographique, son étendu ainsi que l’accessibilité financière à l’HGR/Jason Sendwe expliqueraient cette fréquence.
4. Mode d’admission
Dans notre étude, 56,92% des gestantes ont été évacuées. Ce taux élevé est
comparable aux données du Sénégal (Abou B, 2024) où la placenta prævia était souvent découvert au moment de l’accouchement (73,8%), signant un manque de diagnostic prénatal et une gestion d’urgence. est cette augmentation de l’évacuation se justifie dans notre étude par le fait que bon nombre de femmes enceintes craignent de s’accoucher dans de maternité de niveau élevé et aussi retardé par le niveau périphérique avec l’espoir d’obtenir toujours un accouchement.
5.3.Données cliniques et obstétricales 5. Avortement
Les antécédents d’avortements ont été retrouvés dans 55,38% des cas.
comparativement au Maroc, Hinde M, retrouvait 45,7% d’antécédent d’avortement (Hinde
M,2023). Dans notre étude, l’antécédent d’avortement est significativement associé au placenta prævia (0R=6,8 ; p=0,001), ce qui rejoint les observations des auteurs dans les différents pays du monde élucidé dans l’état de la question. Comme constat signalé par d’autres études, ici il s’agit plus souvent des avortement avec curettage endo-utérine pouvant conduire à l’abrasion de l’endomètre qui cicatrice en format des tissus fibreux non nécessaire à l’implantation de l’œuf avec risque augmenté d’insertion basse.
6. Césarienne
Présent dans 23,08% des cas. Au mali, les antécédents de césarienne étaient
fréquent et constituaient des facteurs de risque majeurs. À Lubumbashi, Olivier M(2021) confirmait également l’association. Notre étude retrouve aussi cette tendance, même si l’association n’était pas statistiquement significative (P=0,07).
6. Données obstétricales 7. Parité
Les multipares ont représenté 87,69% des cas. Le lien entre multiparité et
placenta prævia est largement reconnu au Mali (Diakalia K,2023), en RDC (Olivier M, 2021). Dans notre analyse, être multipare augmentait significativement le risque de placenta prævia (OR=3,9 ; p= 0,003). Cette augmentation chez les femmes multipares serait dû au fait en cas de la multiparité, on observe la diminution des zones d’insertions de l’œuf étant donné que le bon lieu d’implantation était déjà occupé dernièrement ne laissant que le tissus cicatriciel avec un risque accru d’insertion basse.
8. Suivi prénatal (CPN)
Dans notre série, 70,77% des gestantes n’ont pas eu de suivi prénatal. Cela
explique pourquoi, comme au Sénégal (Abou B, 2024), la majorité des cas est découverte tardivement avec hémorragie. Le faible suivi prénatal est une constante en Afrique
Subsaharienne où l’accès aux soins est limité. Le manque de suivi de la grossesse par un personnel de santé qualifié expose toujours les femmes enceintes à des complications soit pendant l’évolution de la grossesse ou encore lors de l’accouchement.
9. Échographie du 2ème trimestre
L’échographie n’a pas été réalisée dans 86,15% des cas dans notre étude. Cela
contraste avec le pays développés où l’échographie systématique a permis de réduire la mortalité liée au placenta prævia(Seon U, 2024). La raison si on connait tôt, on peut programmer l’accouchement avant que les complications surviennent
7. Données cliniques et prise en charge 10. Motif de consultation
Le saignement de grande quantité pendant le travail a été retrouvé dans 52,30%
des cas. Ceci est conforme aux résultats du Sénégal (Abou U, 2024) où l’hémorragie était le principal symptôme révélateur. Comme décrit par d’autres études, nous jutions cette situation dans notre étude par le fait plusieurs femmes étaient juste avec les contractions c’est-à-dire pendant le travail d’accouchement.
11. Présentation fœtale
Céphalique dans 47,69% et transverse dans 38,46% des cas dans notre série. Les
présentations dystociques sont fréquentes dans les placentas prævia confirme la revue de la littérature.
12. Régime contractile
Concernant les régimes contractiles, 59,92% des gestantes avaient un travail
avancé (≥3 contractions). Cela correspond au fait que beaucoup de placenta prævia se déclarent brutalement pendant le travail. Observation faite dans les études de Lubumbashi (Olivier, 2021) et au Sénégal ( Abou U, 2024). La raison est que la réalisation de l’échographie pour certaines femmes est un défis majeur et aussi les autres ne respectent pas des séances prévues, ce qui échapperait aux personnels de santé de diagnostiqué plus précocement certaines anomalies d’insertions placentaires et planifier ainsi la prise en charge.
13. Voie d’accouchement
La césarienne a été réalisée dans 80% des cas. cette prédominance est identique
à celle rapporté au Mali (71,02%) et à Lubumbashi (91%) par ( Olivier M, 2021). Le recourt à cette voie serait idéale pour éviter les complications sévères
14. Pronostic
Décès maternel dans 7,69% des cas. Ce taux est plus faible qu’attendu pour un
hôpital de référence en Afrique, mais reste préoccupant. Cela témoignant aussi d’une équipe ainsi dynamique des obstétriciens dans cette institution publique. La mortalité périnatale est également élevée dans notre étude comme dans d’autres études publiées en Afrique
CONCLUSION ET SUGGESTIONS
a) conclusion
Le placenta prævia demeure une pathologie obstétricale fréquente et grave à la
maternité de l’HGR/Jason Sendwe avec une prévalence de 5,32%, nettement supérieur aux taux rapportés dans la littérature. Les principaux facteurs de risque associés sont la multiparité, les antécédents d’avortement et de césarienne. La prise en charge a reposé essentiellement sur la stabilisation hémodynamique et l’accouchement par césarienne. Tout fois le diagnostic souvent tardif, lié à l’insuffisance du suivi prénatal et de l’échographie systématique, expose à une morbidité et mortalité materno-fœtale encore élevées. il est alors impératif d’améliorer la prévention, le dépistage précoce et la qualité de la prise en charge pour réduire les complications liées à cette pathologies
b) Suggestions v Aux autorités politiques et sanitaires
- Renforcer la politique de santé maternelle rendant les consultations prénatales accessibles, gratuites et de qualité pour toutes les femmes enceintes
- Équiper les structures de santé en appareil d’échographie et en moyen de transfusion rapide pour améliorer le diagnostic précoce et la prise en charge des urgences hémorragiques
- Organiser des campagnes des sensibilisations communautaires sur le risque liés aux antécédents obstétricaux(avortement, césarienne) et l’importance du suivi prénatal
- Mettre en place un système performant de référence et contre-référence v HGR/Jason sendwe
- Renforcer la formation continue du personnel médical en matière de diagnostic échographique et de prise en charge des placenta prævia
- Assurer la disponibilité des produits sanguins et des équipement pour la prise en charge rapide des hémorragies obstétricales
- Mettre en œuvre un protocole de dépistage systématique du placenta prævia chez toutes les femmes à risque.
v Aux femmes enceintes
- Suivre rigoureusement les CPN dès le premier trimestre
- Accepter de réaliser les échographies recommandées
- Éviter les avortement provoqués
- Informer les personnel soignant de tout antécédent obstétrical notamment avortement, césarienne ou placenta prævia pour une meilleure prise en charge.
RÉFÉRENCE
- Seon Ui Lee (Corée du Sud) (2024) : A Multicenter, Retrospective Comparison Study of Pregnancy Outcomes According to Placental Location in Placenta Previa,
- Shreya A. Sahu (Inde) (2024) : Maternal and Perinatal Outcomes in Placenta Previa: A Comprehensive Review of Evidence
- Stéphanie Régnier-Loilier (France) (2022) : Placenta praevia : diagnostic prénatal et prise en charge obstétricale
- Martina Mueller (Allemagne)(2023: Placenta praevia und geburtshilfliche Komplikationen,
- Hinde El Mekkaou (2023): Placenta praevia : Facteurs de risque et prise en charge à Rabat,
- Lamiaa Kharbac (2024) : Etude clinique du placenta praevia au CHU de Casablanca
- Diakalia Koné (2023) : Placenta praevia au Mali : aspects épidémiologiques et cliniques
- Abou B : Placenta praevia (2024) : expérience du Centre Hospitalier National de Pikine
- K. N’Guessan (2017), Placenta praevia: maternal and fetal prognosis in University Hospital of Cocody (Abidjan-Côte d’Ivoire)
- Olivier Mukuku (2021) : Risk Factors and Outcomes of Placenta Praevia in Lubumbashi, Democratic Republic of Congo
- Seon Ui Lee (Corée du Sud) (2024) : A Multicenter, Retrospective Comparison Study of Pregnancy Outcomes According to Placental Location in Placenta Previa
- Shreya A. Sahu (Inde) (2024) : Maternal and Perinatal Outcomes in Placenta Previa: A Comprehensive Review of Evidence
- Bessis R., Brignon C., Shneiderl (1976). Localisation placentaire échographique dans les insertions basses; difficultés: le placenta migrateur. Soirée échographique Gynecolobstet ; (5) ; p 3751.
- Bagayoko S (2002). Contribution à l’étude du Placenta Praevia à l’Hôpital Gabriel Touré à propos de 62 cas. Thèse Med,Bamako,. N° 17
- Chattopadhyah S., Kharif H., Sherbeeni M (1993). Placenta praevia and acreta after previous caesarean section.Eur. J. Obstet. Gynecol. Repro Biol; (3) 52; p 151 – 156.
- Danzer M., Sloukgi J., Agnani G., Colette C. Césarienne pour placenta praevia.
Mortalité et Morbidité périnatales. Reo Fr Gynécol. Obstet 1986 ; (81)12 ; p685-691.
- Boog G. Le Placenta praevia. Encycl Med. Chir (Paris) obstétrique 1983; 5069 A10.
- Diallo A (2008). Aspects épidémiologiques et Clinique du placenta prævia hémorragique au centre de sante de référence de la commune IV du district de Bamako, à propos de 67cas thèse de médecine,.116 :p 62-96.
- Guiadem F(1990). Contribution à l’étude des hémorragies du troisième trimestre de la grossesse et de l’accouchement.Epidemiologie et thérapeutique (a propos de 301 cas colligés à la maternité du chu de cotonou). Thèse de Med : cotonou ,N°510
- Houessou H (1983). Contribution à l’étude du placenta praevia en République populaire du Bénin ( à propos de 698 cas).Thèse Med: Cotonou, Bénin .N°145.
- Keita S B (1997). Le Placenta praevia : facteurs de risque, pronosticde l’accouchment à l’hôpital du point G. Thèse de med. Bamako n°4.
- Kone F (1989). Contribution à l’étude du placenta praevia hémorragique à l’hôpital Gabriel Touré (à propos de 56 cas).Thèse de med n°48 Bamako.
- Miliez J (1991). Hémorragie du troisième trimestre de la grossesse :orientation diagnostique Rev. Praticienne ; (41)9: p 835-838.
- Herlyn U (1964). Eperimenteller Bertrag. sur Ätiologie Der p.p am decidualen Zellreaktron bei der ratte. Archiv. Gynäkol ;,199, 496-501.
- Brenner W., Edelmand A., Hendrichs C (1978). Caracteristics of patients with placenta praevia and results of«expectant management» am. J. Obstet Gynecol; 132, 180-191.
- Demissie K., Breckenridge M., Joseph L., Rhoads G (1999). Placenta praevia preponderance of sexe at brith. Am J ofEpidemioI; 149: 824-30
ANNEXE
Fiche des collectes des données
I. Caractéristiques sociodémographiques
- Tranche d’âge
- < 35 ans
- > 35 ans
- État civil
- mariée
- célibataire
- Niveau d’étude
- certificat/brevet
- diplômée
- graduée
- licencié
- commune de provenance…………………………………………….
- profession …………………………………………………………….
- Mode d’admission
II. antécédents
- Avortement
oui
- non
- Césarienne
oui
- non
- Placenta prævia
oui
- non
III. Caractéristiques obstétricales
- Parité
Primipare
- Multipare
- Âge de la grossesse……………………………………….
- Suivi de la CPN
oui
- non
- Type de grossesse
- mono-fœtale
- gémellaire
IV. Caractéristiques cliniques
- Motifs de consultation
- Saignement génital modéré
- hémorragie génital grave
- Douleur plus saignement génital
- état général à l’admission
- conservé
- altéré
- Présence de signe de choc
oui
- non
- Présentation
Céphalique
- Transverse
- Siège
- Régime contractile
utérus relâché
- moins de contraction
- plus de 2 contraction
- BCF
- Présent
- Absent
- Échographie (BESSIS)…………………………….
- Taux de l’hémoglobine…………………………………
- Complications………………………………………….
- Prise en charge……………………………………..

 Naviguez vers congovirtuel
Naviguez vers congovirtuel Naviguez vers Kinkiesse
Naviguez vers Kinkiesse