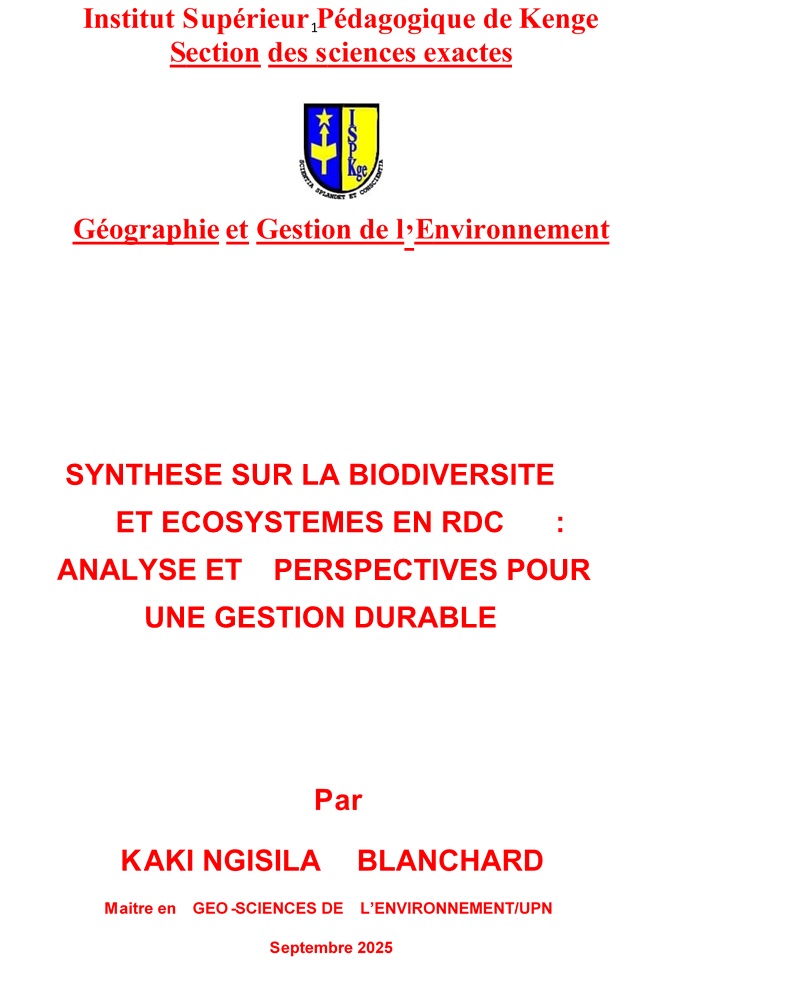
Introduction
La République Démocratique du Congo (RDC), dotée d’écosystèmes variés et d’une
riche diversité biologique spécifique et génétique, est Partie à la Convention sur la Diversité Biologique (CDB) depuis 1994. Celle-ci poursuit trois objectifs ; à savoir :
- La conservation de la biodiversité ;
- L’utilisation durable des ressources biologiques ; et,
- Le partage juste et équitable des avantages résultant de l’exploitation des ressources génétiques.
L’atteinte de ces trois objectifs est essentielle pour le développement durable et
l’amélioration des conditions de vie sur la terre, en particulier celle de l’environnement biotique et abiotique d’une nation. En son article 6, la CDB demande à chaque Partie, conformément aux conditions et capacités qui lui sont propres, notamment :
- D’élaborer ou d’adapter des stratégies et plans nationaux tendant à assurer la conservation et l’utilisation durable de la biodiversité ;
- L’intégrer la conservation et l’utilisation durable de la biodiversité dans les plans, les programmes et les politiques sectoriels ou intersectoriels pertinents. Pour mettre en application cette disposition de la CDB, la RD Congo avait élaboré sa stratégie et plan d’action nationaux de la biodiversité en1999, laquelle a été adoptée en 2001 par le gouvernement comme document de politique nationale en matière de biodiversité.
Entretemps en 2002, au niveau mondial, les Parties à la CDB se sont engagées à
parvenir, au plus tard en 2010, à une réduction significative du rythme actuel d’appauvrissement de la biodiversité aux niveaux mondial, régional et national comme contribution à l’atténuation de la pauvreté et au profit de toutes les formes de vie sur terre (WWF,2009).
Par ailleurs, au niveau national, pour le cas de la RDC un nouvel arsenal juridique a
été adopté entre 2000 et 2013 concernant la gestion des ressources naturelles, dont les codes forestier (2002), minier (2002) et agricole (2011), la loi portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l’environnement (2011) et la loin°14/003 du 11 février 2014 relative à la conservation de la nature. Au regard de ces instruments juridiques, notre SPANB (Stratégie et Plan d’Action Nationaux sur la Biodiversité),
élaborée en 1999,était devenue presqu’obsolète
Problématique
Les ressources naturelles dans le monde font face à de nombreuses pressions
anthropiques, avec comme impact le déclin de la biodiversité et des effets négatifs divers (Dorst, 2012). Plusieurs pays à travers le monde selon le rapport de PNUD (2011) révèle que la biodiversité est largement menacée par les activités anthropiques et les écosystèmes ne sont pas laissés en reste.
La République Démocratique du Congo est comptée parmi les 16 pays du monde
qualifié de méga biodiversité (taux élevé d’endémisme). Cette situation est liée aussi bien par l’immensité de son territoire (234,5 millions d’hectares) que par la variété des conditions physiques et climatiques influant sur la richesse biologique (MIN.ENV.DD, 2020).
Selon ce même rapport, sur plus de 50.000 espèces végétales connues en Afrique,
la RDC occupe la première place en espèces floristiques locales. La flore nationale, d’une originalité remarquable, compte environ 10.531 espèces, tous les grands groupes confondus dont notamment les algues : 249 espèces, les champignons (Basidiomycètes : 582 espèces, les Bryophytes : 154 espèces, les Ptéridophytes : 383 espèces, les Spermatophytes : 9142 espèces avec
275 exotiques). Le taux d’endémisme spécifique de cette flore, très élevé, fait ressortir plus de 952 Phanérogames endémiques, 10 Ptéridophytes, 28 Bryophytes, 1 Lichen, 386 Champignons endémiques, soit 1.377 espèces endémiques pour l’ensemble de la flore.
La faune y est aussi abondante et surtout très variée compte tenu de la variabilité de
l’habitat. La RDC recèle d’importantes réserves du monde en espèces fauniques et comprend des animaux les plus rares que l’on ne trouve nulle part ailleurs au monde (Gorille de montagne, Gorille de plaine, Bonobo ou chimpanzé nain, Okapi, Rhinocéros blanc du Nord, Paon congolais, Girafe, etc.). On estime à 409 le nombre d’espèces de mammifères en RDC, soit 54,1 % des espèces répertoriés en Afrique. Le pays compte également environ 1.086 espèces d’oiseaux, 216 espèces de batraciens, 352 espèces de reptiles.
La distribution de ces espèces à travers le pays est cependant inégale suivant les
différentes régions écologiques. On note par exemple un nombre relativement élevé d’espèces endémiques dans la forêt ombrophile de la région guinéo-congolaise (cuvette centrale), dû au faible degré de perturbation et à l’homogénéité écologique de cet habitat. Par contre, dans la forêt du Mayumbe, il a été observé une raréfaction ou disparition de certaines espèces fauniques (Eléphant de forêt, Buffle, Gorille de plaine, Athérure, Pangolin géant, Céphalophe à dos jaune, etc.) suite aux conséquences mesurables de la dégradation de cette forêt. La faune ichtyologique de la RDC compte une quarantaine de familles regroupant environ 1.000 espèces, dont environ 80 % vivent dans le système fluvial et le reste dans les lacs de l’Est. Le taux d’endémisme des espèces de poissons d’eau douce dans les lacs et cours d’eau du pays est estimé à 70 %.
Cependant, depuis un certain temps plusieurs études et observations confirment une
raréfaction de la biodiversité et une dégradation des écosystèmes sur tous les territoires en RDC, entraînant plusieurs méfaits sur la population, et impactant la sécurité économique et les habitudes alimentaires.
Au regard de ce qui précède, cette étude résume la problématique en deux
questions :
- Quelles sont les causes et conséquences de la disparition de la biodiversité et des écosystèmes en RDC ?
- Comment améliorer la situation de la biodiversité et des écosystèmes en RDC dans le contexte de développement durable ;
De façon anticipative, cette étude présuppose qu’ils existeraient de diverses causes
et conséquences sur la disparition de la biodiversité et des écosystèmes en RDC. Cependant plusieurs stratégies pourraient améliorer durablement la situation de la biodiversité et des écosystèmes en RDC.
Approche méthodologique
Cette étude a utilisé une méthodologie mixte qui sous-entend l’utilisation de
plusieurs outils, méthodes et techniques.
Structure du travail
Cette analyse est présentée en 5 sections.
- La première s’attèle sur la définition des concepts et quelques généralités ;
- La deuxième présente la biodiversité et les écosystèmes en RDC ;
- La troisième section présente les principales menaces sur la biodiversité et leurs causes,
- La quatrième section présente les conséquences de l’appauvrissement de la biodiversité ;
- La cinquième section donne les perspectives de gestion durable de la biodiversité et les écosystèmes en RDC
Section 1 : Définition des concepts et généralités sur la biodiversité Section 1.1 Définition des concepts
1. Bbiodiversité
Etymologique elle désigne la variété des formes de vie sur la Terre. Ce terme est
composé du préfixe bio (du grec βίος / bíos, « vie ») et du mot « diversité ». Elle s’apprécie en considérant la diversité des écosystèmes, des espèces et des gènes dans l’espace et dans le temps, ainsi que les interactions au sein de ces niveaux d’organisation et entre eux.
Le terme de biodiversité a été lancé au cours des années 1980 (Musenga, 2023). Contraction de biologique et de diversité, il représente la diversité des êtres vivants et des écosystèmes : la faune, la flore, les bactéries, les milieux mais aussi les races, les gènes et les variétés domestiques (Musibono, 2020). Le terme vise à caractériser l’érosion du monde vivant résultant des activités humaines, ainsi que les activités de protection et de conservation, qu’elles se manifestent par la création d’aires protégées ou par des modifications des comportements en matière de développement (concept de développement durable). On utilise assez indistinctement le terme de diversité biologique et de biodiversité. Robert Barbault a défini la biodiversité comme « le tissu vivant de la planète » afin de mettre en évidence que l’intérêt de la diversité vient du réseau des interactions.
Au sens large, la biodiversité, ou diversité biologique, désigne la variété et la
variabilité du monde vivant sous toutes ses formes. Elle est définie plus précisément dans l’article 2 de la Convention sur la diversité biologique comme la « variabilité des organismes vivants de toute origine y compris, entre autres, les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques et les complexes écologiques dont ils font partie ; cela comprend la diversité au sein des espèces et entre espèces ainsi que celle des écosystèmes ».
Selon Robert Barbault, cité par Mashini (2020) le concept de biodiversité renvoie
également à la présence de l’Homme : « l’homme qui la menace, l’homme qui la convoite, l’homme qui en dépend pour un développement durable de ses sociétés ».
La biodiversité existe à différents niveaux d’organisation interdépendants qui
s’emboîtent. Les scientifiques considèrent généralement ces niveaux au nombre de trois : la diversité génétique, la diversité des espèces et la diversité des écosystèmes. À cela s’ajoutent la diversité des interactions à l’intérieur des trois autres niveaux et entre eux, la diversité fonctionnelle, c’est-à-dire la diversité des caractéristiques fonctionnelles des organismes, indépendamment des espèces auxquelles ils appartiennent, ainsi que la diversité phylogénétique. La biodiversité ne se limite donc pas à la somme des espèces, mais représente l’ensemble des interactions entre les êtres vivants, ainsi qu’avec leur environnement physico-chimique, sur plusieurs niveaux.
- La diversité génétique, ou diversité intraspécifique, se définit par la variabilité des gènes au sein d’une même espèce, que ce soit entre les individus ou les populations. La diversité génétique au sein d’une même espèce est essentielle pour lui permettre de s’adapter aux modifications de son environnement par le biais de l’évolution9.
- La diversité spécifique, ou diversité interspécifique, est la plus connue car la plus visible. Elle correspond à la diversité des espèces vivantes, unité de base de la systématique, par leur nombre, leur nature et leur abondance ;
- La diversité écosystémique correspond à la diversité des écosystèmes présents sur Terre qui forment la biosphère. C’est au niveau des écosystèmes que se situe la diversité des interactions des populations naturelles entre elles et avec leur environnement. Cette diversité des interactions peut être considérée comme un quatrième niveau en soi. Les trois premiers dépendant étroitement de ce quatrième.
Face aux menaces que constituent les activités de l’espèce humaine sur les autres
formes de vie, la préservation de la biodiversité constitue aujourd’hui un enjeu majeur. C’est pourquoi, après les conférences de Stockholm (1972) et de Rio de Janeiro (1992), ont été définis des objectifs de protection des milieux naturels et des espèces qu’ils abritent tout en prenant en compte l’intérêt des populations locales.
Pour cela, il est nécessaire de respecter les trois objectifs de la stratégie mondiale de
la conservation :
- Maintien des processus écologiques essentiels ;
- Préservation de la diversité génétique ;
- Utilisation durable des espèces et des écosystèmes.
Causes de la disparition de la biodiversité
Les causes à l’origine de la perte de la biodiversité sont nombreuses mais peuvent être ramenées à quatre principales :
- Les causes naturelles dominées par la sécheresse (cause renforcée par les activités humaines) et ses corollaires ainsi que par l’érosion éolienne et hydrique ;
- Les causes anthropiques plus nombreuses et plus variées. Elles intègrent les éléments suivants :
- Les défrichements excessifs et incontrôlés pour les terres de culture ;
- L’exploitation forestière excessive et incontrôlée ;
- Le braconnage ;
- Manque de culture écologique ;
- La surexploitation et la mauvaise exploitation des ressources halieutiques ;
- Mauvaise gouvernance, sinon l’incompétence écologique ;
C) Les causes liées au cadre juridique et institutionnel dues à plusieurs facteurs isolés ou associés, tels que :
- Une réglementation inexistante ou inadaptée ;
- Une réglementation non appliquée ou mal appliquée ;
- Une réglementation incohérente à cause de la multiplicité de textes parfois contradictoires. Il est tellement difficile de persuader la collectivité de sauvegarder la biodiversité pour ce qu’elle est que certains spécialistes n’ont pas hésité à rechercher un autre type d’argumentation, fondé sur son importance économique.
D) Manque de planification écologique et suivi des espèces.
En effet, la biodiversité a, en elle-même, une valeur économique certaine, en fonction des valeurs d’usage qui s’appliquent à l’utilisation et à la commercialisation.
La biodiversité n’est pas uniformément répartie sur Terre : elle tend à augmenter des
pôles vers l’équateur et à diminuer avec l’altitude, alors qu’elle diminue avec la profondeur en mer. Des ONG et des institutions scientifiques ont cartographié les lieux où la biodiversité possède une particularité, justifiant une protection prioritaire. Cette vision n’est pas partagée par tous les biologistes, certains craignant que se focaliser sur ces points chauds amène à négliger les autres régions du monde où la biodiversité est également en danger.
Depuis 1988, Norman Myers et l’association Conservation International s’appuient
sur ce concept de point chaud de biodiversité pour identifier les régions où la biodiversité est considérée comme la plus riche et la plus menacée. Deux critères principaux sont : abriter au moins 1 500 espèces de plantes vasculaires endémiques, et avoir perdu au moins 70 % de l’habitat initial. Au total, 34 points chauds de biodiversité ont été identifiés, dont 20 se situent au niveau des tropiques. Sur seulement 11,8 % de la surface des terres émergées, ces points chauds abritent 44 % des espèces de plantes et 35 % des vertébrés terrestres.
Pour la biodiversité marine, il s’agit des récifs coralliens souvent assimilés à des « forêts tropicales de la mer ». par contre, pour la biodiversité terrestre, les forêts tropicales abritent la biodiversité la plus élevée ; mieux conservée dans les régions où le dérangement et la fragmentation due à l’activité humaine est moindre (le dérangement peut doubler la perte de biodiversité liée à la déforestation tropicale.
2. Ecosystème
En écologie, selon Matand (2014) il s’agit d’un ensemble formé par une
communauté d’êtres vivants en interaction avec leur environnement. Les composants de l’écosystème développent un dense réseau de dépendances, d’échanges d’énergie, d’information et de matière permettant le maintien et le développement de la vie. Système formé par un environnement (biotope) et par l’ensemble des espèces (biocénose) qui y vivent, s’y nourrissent et s’y reproduisent.
François Ramade (2017) définit l’écosystème comme « un ensemble dynamique
de coévolutions des espèces et de leur biotope, qui assure les conditions nécessaires à l’évolution biologique à long terme ». Cette définition souligne l’interdépendance des êtres vivants (biocénose) et de leur environnement physique (biotope), ainsi que la nature changeante et évolutive de ces systèmes écologiques.
Cependant, le terme « écosystème » a été inventé par le botaniste
britannique Arthur Tansley en 1935 pour désigner l’unité fondamentale de l’écologie, formée par l’ensemble des êtres vivants (la biocénose) et leur environnement physique (le biotope) en interaction constante.
Section 2 : Biodiversité et les écosystèmes en RDC
Depuis le sommet de la Terre de Rio de Janeiro en 1992, la préservation de la
biodiversité est considérée comme un des enjeux essentiels du développement durable. L’adoption de la Convention sur la diversité biologique (CDB) au cours de ce sommet engage les pays signataires à protéger et restaurer la diversité du vivant1. Au-delà des raisons éthiques, la biodiversité est essentielle aux sociétés humaines qui en sont entièrement dépendantes à travers les services écosystémiques.
2010 a été l’année internationale de la biodiversité, conclue par la Conférence de Nagoya sur la biodiversité, qui a reconnu l’échec de l’objectif international de stopper la régression de la biodiversité avant 2010, et proposé de nouveaux objectifs (protocole de Nagoya).
En 2012, la Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la
biodiversité et les services écosystémiques (IPBES), un groupe d’experts intergouvernemental sur le modèle du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), a été lancée par le programme des Nations unies pour l’environnement pour conseiller les gouvernements sur cette thématique.
En 2019, le nombre d’espèces menacées d’extinction est évalué à un million. Cette
importante richesse biologique jouit d’une relative protection dans le contexte des aires protégées dont le réseau existant couvre environ 9,6 % de l’étendue du territoire, réparti entre huit parcs (8) nationaux, cinquante sept (57) réserves et domaine de chasse, trois (3) réserves de biosphère, cent dix-sept (117) réserves forestières, trois (3) jardins zoologiques et trois (3) jardins botaniques. Conformément au nouveau code forestier (2002), l’objectif national étant de porter progressivement cette superficie à 15 % pour inclure l’ensemble des écosystèmes naturels rencontrés dans le pays.
L’application effective de cette vision nationale pourrait permettre d’optimiser les
efforts nécessaires de conservation de la biodiversité et des ressources naturelles dans des sites. Ainsi, plusieurs espèces rares de la faune sauvage dont l’okapi, le Rhinocéros blanc du nord, le Bonobo, le Paon congolais, les gorilles de montagne, sont protégés à travers ce réseau. Cependant, les écosystèmes naturels en RDC ne sont pas seulement pourvoyeuses de la matière première et habitats pour la faune sauvage. De par leurs rôles et fonctions variés, ils subissent des sollicitations diverses de la part de l’homme, dont certaines conduisent à des modifications et des dégradations irréversibles.
En effet, plus de 70 % de la population nationale y recourent directement pour leur
subsistance et pour la satisfaction de leurs besoins élémentaires de survie. Ils deviennent ainsi des lieux où se côtoient différentes personnes, aux intérêts souvent divergents qu’il importe de concilier. D’où la pertinence d’une approche intégrée et d’une vision systémique dans la gestion des ressources qui prennent en compte autant les différentes structures de gestion intéressées que l’impérieuse nécessité d’harmoniser la législation.
Par ailleurs, la notion de biens communs, généralement comprise comme bien sans
maître, constitue une entrave sérieuse à une gestion concertée et durable des ressources naturelles.
Ainsi, l’accès aux ressources n’étant généralement pas réglementé ou encore, compte tenu du laxisme dans le suivi de la mise en œuvre de diverses réglementations sectorielles existantes et de leur manque de coordination et d’harmonisation par rapport aux traités et conventions internationaux, les pressions sur ces ressources vont grandissantes au risque de compromettre à plus ou moins long terme, les conditions d’existence même des générations à venir.
En effet, le degré de dépendance de la population vis-à-vis des ressources naturelles
reste principalement lié au niveau de pauvreté qui touche plus de 80% de la population, sur les 100 millions estimée en 2020 (INS,2019) ce qui représente une menace, notamment par (i) la pratique extensive d’agriculture itinérante sur brûlis en zones forestières, la récolte de bois de feu aux alentours de principaux centres de peuplement, l’exploitation minière artisanale et industrielle, l’exploitation pétrolière, l’exploitation de bois d’œuvre, la récolte des produits autres que le bois, la chasse commerciale, les pratiques non durables de pêche ; (ii) l’introduction incontrôlée des espèces exotiques dont certaines deviennent envahissantes et nuisibles ; (iii) la pollution par le rejet dans l’environnement des déchets d’exploitation.
Les trois quarts vivant sous le seuil de pauvreté en RDC, ceci est l’un de causes
primordiales de menace permanente de la biodiversité et la sécurité des écosystèmes. À l’instar de la plupart des pays d’Afrique centrale, la population de la RDC est fortement dépendante des ressources de la biodiversité pour sa survie, avec pour conséquence la dégradation des sols et de la végétation naturelle, mais aussi la fragmentation des habitats et la déforestation.
2.1 Valeur de la biodiversité et des services rendus par les écosystèmes
1. Richesse de la biodiversité : écosystèmes, habitats et espèces
La R.D. Congo est dotée d’une variété d’écosystèmes et d’habitats naturels
possédant une diversité biologique exceptionnelle qui fait d’elle un des 10 pays de la mégabiodiversité au monde. Avec une couverture forestière de plus 155 millions d’hectares, la RDC représente environ de 10% des forêts mondiales et plus de 47% de celles de l’Afrique. Sa biodiversité, importante, est représentée par un complexe végétal imposant et de faciès variés, allant du type forestier dense jusqu’aux savanes plus ou moins boisées ou herbeuses et forêts claires. Ces types de végétation constituent des habitats d’une faune également diversifiée, constituée des genres endémiques, rares ou uniques au monde. Trois genres de quatre grands singes se retrouvent en RDCongo, c’est-à-dire le gorille, le chimpanzé et le bonobo dont deux espèces endémiques (le gorille de plaine de l’Est et le bonobo)
La R.D.Congo détient l’une des principales réserves de la biodiversité faunique du
monde, constituée d’environ 352 espèces de reptiles, 216 espèces de batraciens; 1086 espèces d’oiseaux ; 421 espèces de mammifères, environ 5220 espèces des papillons[1], 1596 espèces d’invertébrés aquatiques dont 1423 d’eau douce et 183 marines; et 544 espèces d’invertébrés terrestres. Sa faune ichtyologique compte une quarantaine de familles représentant plus de 1000 espèces, dont environ 80 % vivent dans le système fluvial et le reste dans les lacs de l’Est. Les taux d’endémisme des espèces de poissons d’eau douce dans les lacs et cours d’eau du pays sont estimés à 70 %. La RD Congo abrite par ailleurs plus de genres de primates que tous les pays du monde. Trois genres de 4 grands singes se retrouvent en RDCongo, c’est-à-dire le gorille, le chimpanzé et le bonobo. Il sied de signaler la découverte récente en RD Congo d’une espèce de singe dans la zone forestière de Tshuapa-Lomami-Lualaba dénommé «
Cercopithecuslomamiensis », connu sous le nom vernaculaire de « Lesula ». Cette espèce ressemble à un cercopithèque à tête de hibou, ou cercopithèque d’Hamlyn, mais sa couleur reste très différente.
Sur plus de 50.000 espèces végétales connues en Afrique, la RDCongo occupe la
première place en espèces floristiques locales. La flore nationale, d’une originalité remarquable, compte environ 10.531 espèces, tous les grands groupes confondus dont notamment les algues : 249 espèces, les champignons (basidiomycètes) : 582 espèces, les bryophytes : 154 espèces, les ptéridophytes : 383 espèces, les spermatophytes : 9142 espèces avec 275 exotiques. Le taux d’endémisme spécifique de cette flore, très élevé, fait ressortir plus de 952 Phanérogames endémiques, 10 Ptéridophytes, 28 Bryophytes, 1 Lichen, 386 Champignons endémiques, soit 1.377 espèces endémiques pour l’ensemble de la flore.
(http://www.congogreencitizen.org/index.php/biodiversite, consulté le 12 juin 2025).
Cette biodiversité, tant végétale qu’animale, est répartie sur un relief varié (carte 1), allant de 0m d’altitude de la zone côtière Atlantique à 5.113m du Pic Marguerite au Mont Ruwenzori, ainsi que de nombreux refuges datant des périodes glaciaires avec plusieurs zones d’endémisme poussé qui confèrent au pays une biodiversité et une gamme de biotopes et d’habitats naturels exceptionnels.
Suivant le relief et la proximité de la cuvette centrale, quatre régions floristiques se démarquent nettement. Il s’agit de:
- un massif de forêts guinéo-congolaises couvrant la cuvette centrale ;
- une bande étroite de savane boisée et herbeuse au nord, reliant la zone guinéo-congolaise de la cuvette centrale à la zone soudanienne;
- une bande de savane boisée et herbeuse qui joint la région guinéo-congolaise à la zone zambézienne au sud;
- une région forestière montagneuse de l’est du pays, située dans le Graben africain et entrecoupée par une série de grands lacs.
A ces quatre principales régions floristiques susmentionnées, correspondent et/ou
s’intègrent une série d’habitats naturels qui représentent des variantes en termes édaphiques, pédoclimatiques et de composition phyto-sociologique particulière. On en dénombre au total 19 variantes regroupées en quatre grands ensembles qui, à leur tour, se différencient à l’intérieur même du faciès principal dépendamment de leur composition en espèces de faune et de flore.
Le premier ensemble physionomique est constitué des écosystèmes forestiers
comprenant 11 types d’habitats ou de formations forestières (forêts marécageuses, forêts denses ombrophiles, forêt ombrophile de transition, forêt afro-montagnarde (avec trois variantes), forêt sèche zambézienne (Muhulu), forêt claire zambézienne (Miombo), forêt claire soudanienne, forêt sclérophylle littorale, mangroves). Les écosystèmes forestiers couvrent environ 52% du territoire national. Ces formations sont incluses dans les aires protégées à l’exception de la bambousaie à Oxytenantheraabysinica. Cette dernière ainsi que les mangroves à palétuviers sont deux écosystèmes uniques et moins représentatifs du pays. Dans l’ensemble, la diversité spécifique y est élevée avec la présence de plusieurs espèces endémiques et/ou menacées de disparition. A titre indicatif il y a parmi les végétaux: Encephalarctosseptentrionalis, Diospyrosgrex, Eremospathahaullevilleana, Pericopsiselata, Sclerospermamannii, Gnetum africanum, Millettialaurentii et Juniperusprocera. Chez les animaux, on rencontre dans ces forêts le bonobo (Pan paniscus), le paon congolais (Afropavocongensis), le gorille de montagne et de plaines (Gorillagorilla), l’okapi (Okapiajohnstoni) et le lamantin aquatique
(Trichechussenegalensis)dans les eaux saumâtres des mangroves.
Le deuxième ensemble est constitué des écosystèmes savanicoles et autres
apparentés, se retrouvant en bordure nord et sud de la cuvette centrale. Cet ensemble savanicole est réparti dans trois types de formation végétale représentant plus ou moins 40 % du territoire national, à savoir : les savanes arbustives, boisées et herbeuses. Ces savanes ainsi que leur biodiversité floristique et faunique sont spectaculaires et arborent parfois encore de grands troupeaux d’herbivores dont l’éléphant des savanes (Loxondontaafricanaafricana), le rhinocéros blanc du Nord (Cerathotheriumsimumcotoni) et les antilopes des savanes (Tragelaphusscriptus, Kobus kob, Kobusdefassa, Damaliscuskorrigum, etc.). Cependant, ces savanes et leur faune sont fortement menacés par les feux de brousse, les pratiques de l’agriculture itinérante sur brûlis, le braconnage et la chasse traditionnelle et commerciale.
Figure 1: Carte de la Richesse spécifique (toutes les espèces) en République Démocratique du Congo
Un troisième ensemble est constitué du faciès afro-montagnard allant de la dorsale
du Kivu et de la chaine des monts Mitumba, aux chaines des Virunga et au Mont Ruwenzori dans l’est du pays. A l’ouest du pays, il y a le Mont Crystal qui traverse le Mayumbe. Cet ensemble afro-montagnard couvre plus ou moins 4,5% du territoire national.La végétation varie suivant que l’altitude croît. Les essences typiques de la partie basse (1700 à 2200m) de la forêt afromontagnarde sont: Albiziagummifera, Carapagrandiflora, Celtissp, Clausenaanisata, Fagaramildbraedii, Millettia dura, Newtoniabuchananii, Parinariholstii, Prunus
africana, Sapiumellipticum(Lebrun, 1935). Entre 2200 m à 2600 m d’altitude,
on retrouve la forêt de hautemontagne à
Podocarpusmilanjianus, Afrocraniavolkensii, Ilexmitis,Myricasalicifolia, Prunus africana, Scheffleragoetzenii, Syzygiumparvifolium. Sur leMontKahuzi, des peuplements quasi purs et denses de Bambous (Sinarundinariaalpina)se rencontrent entre 2400 m et 2600 m d’altitude, là où un certaincaractère de sécheresse se manifeste. Au-dessus de l’horizon à Bambous ,on rencontre entre 2600 m et 3000 m, des peuplements à Hageniaabyssinica, parfois associé à Hypericumrevolutum. Sur les hauts sommets, on trouve, en alternance, selon les conditions du milieu, une végétation herbacée ouligneuse à Dendroseneciosp.,Helichrysumsp., Lobeliasp.,
Poaceae, Vacciniumsp.. De 2800 m à 3200 m, les formations à Ericaceae s’enrichissent en Lobélies et Séneçons. De 3200 m à 3310 m, le sommet du Mont Kahuzi est couvert des formations afro-alpines,faites d’un mélange de végétation herbacée et arborée de diverses Ericaceae, Alchemillakivuensis, Dendroseneciojohnstonii, Helichrysumformosissimum, Helichrysummildbraedii, Hyperziasaururus, Lobelia stuhlmanii,Lycopodiumclavatum, Seneciosabinjoensis.
L’éléphant, le gorille de basse altitude ou de montagne, le chimpanzé commun,
beaucoup d’espèces de singes, antilopes de forêts, etc. sont fréquents dans ces forets afromontagnardes.Le taux d’endémicité est très élevé dans ce facies.
Enfin, le 4ièmeensemble est constitué des écosystèmes aquatiques, représentés par
des lacs, des rivières, des fleuves, des glaciers sur les hautes montagnes de l’est et les biefs maritimes. Ils abritent entre autres des reptiles, des mammifères aquatiques fortement menacés et de fortes concentrations de poissons et d’oiseaux, dont des oiseaux migrateurs. Le plan d’eau intérieur occupe environ 3.5 % de l’étendue du territoire national et son potentiel représente plus de 50% d’eau douce du continent. En plus de constituer une source immense d’eau de boisson, il abrite une faune ichtyologique riche et variée, un medium pour la navigation intérieure et représente dans nombreux de ses biefs non navigables des rapides pittoresques, une source potentielle d’énergie hydro-électrique et d’écotourisme.
2.Valeur de la biodiversité et des services écosystémiques pour le pays et sa contribution au bien être humain
La valeur de la biodiversité congolaise est principalement liée à la conservation intrinsèque
des écosystèmes, des espèces et des gènes. Elle est aussi liée à leur utilisation qui est souhaitée devenir durable et équitable.
La forêt fournit notamment le bois-énergie, l’habitat, la culture et les ressources pour la
survie des populations humaines. Il ya une forte dépendance de l’économie rurale à l’utilisation des produits forestiers non-ligneux comme les plantes médicinales, alimentaires et cosmétiques et le gibier. Il y a aussi la valeur de la forêt dans les équilibres climatiques mondiaux et locaux, le cycle de l’eau, le puits de carbone. Toutes ces valeurs sont liées au potentiel novateur de paiement des services écosystémiques (PSE). Ces valeurs sont présentées et discutées brièvement ci-dessous.
3. Valeur de la biodiversité et des services écosystémiques pour le pays et sa contribution au bien être humain
La valeur de la biodiversité congolaise est principalement liée à la conservation
intrinsèque des écosystèmes, des espèces et des gènes. Elle est aussi liée à leur utilisation qui est souhaitée devenir durable et équitable.
La forêt fournit notamment le bois-énergie, l’habitat, la culture et les ressources
pour la survie des populations humaines. Il ya une forte dépendance de l’économie rurale à l’utilisation des produits forestiers non-ligneux comme les plantes médicinales, alimentaires et cosmétiques et le gibier. Il y a aussi la valeur de la forêt dans les équilibres climatiques mondiaux et locaux, le cycle de l’eau, le puits de carbone. Toutes ces valeurs sont liées au potentiel novateur de paiement des services écosystémiques (PSE). Ces valeurs sont présentées et discutées brièvement ci-dessous.
4. Biodiversité et conservation de la nature
Dans le cadre de la préservation de ces habitats et de leurs composantes fauniques
et floristiques, la R.D. Congo a mis en place un réseau d’aires protégées qui couvre présentement plus ou moins 312 139 km[2] soit 13,3 % du territoire national (Carte 2) et projette d’en créer d’autres pour atteindre une couverture d’au moins 15%. Ce réseau, qui protège la plupart des écosystèmes du pays, est constitué de plusieurs aires protégées dontsept parcs nationaux dont quatre (Salonga, Virunga, KahuziBiega et Garamba) et une Réserve (celle de Faune à Okapi dans la Forêt de l’Ituri) sont inscrits sur la liste des sites du patrimoine mondial de l’UNESCO. A ceuxlà, il faut ajouter des réserves et domaines de chasse (57), de réserves de la biosphère (3) et des réserves forestières (117) mais aussi des jardins zoologiques (3) et botaniques (3).
Ce réseau constitue un atout potentiel d’éco-tourisme dans le pays et une fois bien
géré il peut constituer une réserve génétique naturelle des espèces endémiques. Aujourd’hui, la communauté internationale mobilise au moins 32 millions de dollars par an pour la gestion de quelques aires protégées de ce réseau, surtout celles de l’est du pays (ADG Cosma, communication personnelle, décembre 2015). Nombreuses des réserves forestières établies en période coloniale n’existent plus que de nom. Elles sont quasiment abandonnées et envahies par les populations environnantes.
Quant aux domaines et réserves de chasse, quelques efforts timides sont déployés
pour les maintenir en fonction et notamment à l’est du pays. De trois réserves de biosphère reconnues, seule celle de Luki dans le Mayumbe (forêt dense ombrophile de transition), bénéficie encore d’une certaine attention de la part des partenaires internationaux (Union Européenne, Banque Africaine de Développement (BAD), WWF/Belgique, MRAC/Tervuren, etc.). Une expérience de valorisation des ressources végétales, coordonnée par la Fondation BDA2 sur financement de la BAD, est projetée dans la réserve de la Biosphère de la Luki avec une production bioorganique et commercialisation des produits cosmétiques, nutritionnels et biopharmaceutiques et un conditionnement de plantes médicinales.
Les activités dans la réserve de Yangambi(forêt dense ombrophile) viennent de
reprendre grâce à un projet coordonné et financé respectivement par le Fonds mondial pour la nature (WWF/Belgique) et la Coopération Belge au Développement et un autre par l’Union mondiale pour la nature (UICN) sur financement du Gouvernement Autrichien au travers du Life Web. Quant à la réserve de la Lufira (forêt claire zambézienne), les activités sont quasiment à l’abandon par manque de suivi et d’apports financiers.
Figure 2 : Carte des différentes Aires Protégées de la RDC
En ce qui concerne l’extension du réseau d’aires protégées,il est recommandé que
le choix des sites soit opéré sur base des critères objectifs, notamment la représentativité en termes d’écorégions, les zones d’importance pour les oiseaux et les sites identifiés par l’Alliance pour l’extinction zéro.
a) Approche par écorégions
La RD Congo compte 19 écorégions terrestres (Carte 3) et 1 écorégion marine. De
toutes ses écorégions terrestres, celle de la mosaïque foret-savane du Sud est potentielle pour plus de protection étant donné que sa protection à travers le monde représente moins de 3%. Plus de 89% de cette écorégion se trouve en RD Congo et représente 21,85% du territoire national. Sa protection en RD Congo est moins de 10%.
Les autres sites potentiels pour la protection sont la mosaïque forêt-savane de
l’ouest du Congo, l’écorégion des Miombo angolaises ainsi que l’écorégion des lacs dont le pourcentage de couverture dans le pays n’est pas significatif. En outre, la région écologique mosaïque forêt-savane de l’ouest du Congo qui occupe 3,66% du territoire national constitue un site potentiel pour la protection. A ce jour, le taux de protection de cette écorégion est seulement de 20%. Au sujet de la zone écologique marine, seule l’écorégion du Golfe du sud de Guinée est présente en RD Congo. Elle constitue aussi un site potentiel pour plus de protection étant donné que sa protection est évaluée à moins de 10%. Le tableau 1ci-après donne les noms et le pourcentage de la superficie des écorégions qui se trouvent en RDCongo, le pourcentage de l’écorégion qui est sous protection au niveau national et le pourcentage de toute l’écorégion qui est sous protection à travers le monde.
Pour étendre le réseau d’aires protégées, il faudrait au préalable décider des zones
à ériger sous protection et assurer une bonne représentativité des régions écologiques. Les données reprises à la colonne 4 du tableau 1 s’avèrent, à cet effet, capitales. Pour ce faire, l’idéal serait d’augmenter la superficie de l’aire protégée chaque fois que le pourcentage de l’écorégion sous protection est inférieur à 10% (écorégion n°1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16 et 17)
Pour les régions écologiques dont 30 et 100% de leur couverture se situent en RD Congo (écorégion n° 19 et 20), augmenter leur superficie sous protection serait une responsabilité du pays d’agir pour le bien du monde entier avec tout ce que cela pourrait comporter comme conséquence en termes d’assistance financière et/ou technique.
TABLEAU 1: Ecorégions présentes en RD Congo
| N° | Nom de l’écorégion | % de la superficie dans le pays | % sous protection dans le pays | % sous protection à travers le monde |
| 1. | Mosaïque forêt-savane congolaise du Sud | 89.68 | 3.27 | 2.94 |
| 2. | Forêts de plaine Congolaise du Nord | 94.20 | 9.68 | 11.31 |
| 3. | Forêts congolaises du centre | 100.00 | 19.35 | 19.35 |
| 4. | Miombo Zambezienne du Centre | 34.77 | 7.70 | 22.10 |
| 5. | Mosaïque forêt-savane congolaise du Nord | 18.62 | 43.78 | 14.46 |
| 6. | Forêts marécageuses congolaises de l’Est | 100.00 | 21.74 | 21.74 |
| 7. | Mosaïque forêt-savane congolaise de l’Ouest | 20.72 | 5.01 | 6.42 |
| 8. | Forêts de montagne du Rift Albertin | 62.11 | 8.60 | 11.81 |
| 9. | Forêts marécageuses congolaises de l’Ouest | 43.07 | 2.84 | 35.69 |
| 10. | Terres boisées de miombo angolaises | 4.38 | 0.00 | 5.29 |
| 11. | Lac | 1.73 | 0.88 | 7.75 |
| 12. | Forêts côtières de l’Atlantique Equatoriale | 4.75 | 1.73 | 21.62 |
| 13. | Mosaïque forêt-savane du Bassin de Victoria | 2.66 | 84.77 | 14.15 |
| 14. | Prairies inondées zambeziennes | 1.52 | 2.62 | 63.22 |
| 15. | Savane Est soudanaise | 0.23 | 0.23 | 23.15 |
| 16. | Forêts de plaine congolaises du Nord- Ouest | 0.31 | 0.00 | 18.72 |
| 17. | Golfe de Guinée du Sud | 1.72 | 4.95 | 4.13 |
| 18. | Mangroves d’Afrique Centrale | 2.39 | 60.12 | 21.72 |
| 19. | Rwenzori-Virunga landes de montagne | 27.53 | 75.88 | 66.96 |
| 20. | Itigi-Sumbutaillis | 5.85 | 12.96 | 40.89 |
Figure 3:Carte des Ecorégions terrestres du WWF en RDC
b) Zones d’importance pour les oiseaux
La RD Congo compte 19 zones d’importance pour les oiseaux. Parmi celles-ci, 5
sont sans protection, 10 ont une protection partielle, et 4 sont protégées complètement. Les 5 zones non protégées constituent des sites potentiels pour être érigées en aires protégées ;tandis que la superficie des zones sous protection partielle est susceptible d’être augmentée. Le Tableau n°2 donne plus de détails concernant les zones d’importance pour les oiseaux.
Tableau 2: Zones d’importance pour les oiseaux présents en RD Congo
| N° | Noms des sites | Superficie (en Km2 ) | % sous protection | Statut de la protection |
| 1. | Reserve forestière de Luki | 644.43 | 48.23 | Partiel |
| 2. | Reserve de Bombo-Lumene | 3374.12 | 64.71 | Partiel |
| 3. | Ngiri | 20288.55 | 6.38 | Partiel |
| 4. | Parc national de la Salonga | 34732.94 | 99.21 | Complet |
| 5. | Lomako – Yekokola | 2452.31 | 85.12 | Partiel |
| 6. | Parc national de la Garamba | 5009.87 | 99.78 | Complet |
| 7. | Plateau de Lendu | 4132.31 | 0.08 | Sans |
| 8. | Reserve du Mont Hoyo | 588.30 | 0.00 | Sans |
| 9. | Reserve de faune à Okapi | 13970.79 | 96.98 | Partiel |
| 10. | Parc national de Virunga | 6026.12 | 83.08 | Partiel |
| 11. | Parc national de Maiko | 10556.56 | 88.60 | Partiel |
| 12. | Forêts de l’Ouest du Lac Edouard | 1766.26 | 10.82 | Partiel |
| 13. | Parc national Kahuzi-Biega | 5655.59 | 83.32 | Partiel |
| 14. | Montagnes d’Itombwe | 8262.87 | 0.14 | Sans |
| 15. | LaLuama – Katanga – Mont Kabobo | 2561.08 | 0.00 | Sans |
| 16. | Marungu highlands | 9774.71 | 0.00 | Sans |
| 17. | Parc national de l’Upemba | 13526.86 | 100.00 | Complet |
| 18. | Parc National de Kundelungu | 8092.27 | 100.00 | Complet |
| 19. | Vallée de la Lufira | 584.06 | 13.09 | Partiel |
b) Sites identifiés par l’Alliance pour l’extinction zéro[3].
En RD Congo, 3 sites ont été identifiés comme faisant partie de l’Alliance pour l’extinction zéro. De ces 3 sites, 2 sont non protégées et 1 est protégée partiellement. Ainsi, les 2 sites non protégées constituent des sites potentiels pour la protection.
Tableau 3:Sites de l’Alliance pour l’extinction zéro présents en RD Congo
| N° | Noms des Sites | Superficie (km2 ) | % sous protection | Statut de la protection |
| 1. | Montagnesd’Itombwe | 10104.91 | 0.00 | Sans |
| 2. | Parc national de Kahuzi-Biega | 5655.59 | 83.32 | Partiel |
| 3. | Kokolopori | 1370.72 | 0.00 | Sans |
5. Richesse en essences forestières
Sur les 86 essences tropicales exploitables selon le Centre Technique Forestier Tropical (CTFT), 78 sont présentes dans les forêts congolaises, soit 90,7%. Cependant, environ 30 essences seulement font actuellement l’objet d’une exploitation plus ou moins régulière. Parmi ces essences, neuf sont surexploitées. Il s’agit de: Afzeliabipendensis, Diospyroscanaliculata, Diospyroscrassiflora, Diospyrosgrex, Entandrophragmaangolense, Entandrophragma utile, Millettialaurentii, Pericopsiselata, et Swartziafistuloides. L’exploitation forestière reste faible et fortement sélective avec une extraction de l’ordre de 12 à 22 m3/ha. Cette extraction du bois ne dépasse guère les 500 000 m3 par an.
Les forêts susceptibles d’être allouées à une exploitation industrielle de bois
d’œuvre couvrent une superficie de l’ordre de 87 millions d’hectares principalement circonscrits à l’intérieur de la cuvette centrale. Jusqu’en 2008, environ un quart de cette superficie productive (±20 millions d’ha) était sous allocation pour la production industrielle de bois, mais qui se résume aujourd’hui à une simple exportation de grumes brutes sans plus-value. Avec la revue des titres d’exploitation forestière opérée entre 2005 et 2008, cette superficie a été réduite de moitié et ne représenterait plus que près de 10 millions d’hectares actuellement concédées par l’Etat à des entreprises privées. Des plantations forestières existent, mais à faibles étendues (Yangambi, Luki, Mampu, Basankusu, Kisangani, etc.).
6. Importance du secteur forestier dans l’économie nationale
D’après la Fédération des exploitants industriels de bois (FIB), suite à la crise qu’a
connue le pays entre les années 1990 et 2000, le nombre d’emplois du secteur forestier est passé de 20 000 en 1988 à 15 000 travailleurs en 2006. Plus de 30% de ces effectifs sont affectés dans les chantiers et 70% dans les usines et services administratifs. Cependant, jusqu’ici, l’industrie forestière contribue faiblement au secteur économique du pays.
Les droits à l’exportation se sont chiffrés à près d’US $500 000 en 2006 et la valeur
des exportations du secteur à plus d’US $42 millions pour un volume total de bois exportés de l’ordre de 144 000 m3, alors qu’au cours de l’année 1998, la valeur des exportations du secteur se chiffrait à US $54 millions. En moyenne, ces exportations étaient constituées de bois rond industriel pour 60%, de sciage pour 35% et de panneaux à base de bois pour 5%, alors que la loi n’autorise qu’une exportation de 30% de bois en grumes. Il est évident que cette situation ne favorise pas la création d’emplois et la production de produits à grande valeur ajoutée.
En ouvrant des routes forestières, le secteur forestier favorise la mobilité et la vente
des produits agricoles par les populations locales, d’une part, et d’autre part, il contribue à l’amélioration des conditions de vie des populations rurales par la mise en place de services médicaux, d’écoles, de magasins, etc. En effet, jusqu’en 2006, le secteur a construit dans le pays 1 913 km de routes forestières, 101 écoles avec 618 salles de classe, 34 centres de santé, 3 hôpitaux, 1 879 maisons pour les travailleurs. Il a par ailleurs créé plus de 15 000 emplois, ce qui représentait une prise en charge de plus de 150 000 membres de familles. Aujourd’hui, ce secteur utilise seulement ± 6.000 emplois directs avec une masse salariale estimée à ± 10 millions $US/an (AGEDUFOR, 2015).
Au regard des potentialités forestières, l’industrie forestière ne contribue jusqu’ici
que très faiblement à la constitution du PIB national, soit à peine 1% en moyenne. Les raisons majeures de cette situation sont notamment le très faible niveau actuel de production observé qui oscille autour de 500 000 m³ par an et au faible niveau de développement des infrastructures de base. De plus, les équipements de l’industrie du bois sont devenus vétustes, ce qui rend ce secteur moins compétitif et le coût très élevé de ces équipements ainsi que le moratoire pris depuis le 14 mai 2002 portant suspension de l’octroi des allocations forestières qui n’attirent presque pas d’investissements privés. A cela s’ajoute l’enclavement des massifs forestiers économiquement exploitables, et la faible couverture du territoire national en énergie, ce qui n’est pas de nature à faciliter l’implantation de nouvelles industries dans les zones forestières pour créer une valeur ajoutée à partir des produits forestiers exploités.
7. Pêche
La RDCongo possède un réseau hydrographique très dense. Les plans d’eau,
représentés par l’immense réseau fluvial, les plaines inondées et les lacs couvrent environ 86.080 km² (3,5 % de la superficie du pays). Ceux-ci peuvent être subdivisés en 3 types d’écosystèmes naturels :
- Les écosystèmes lacustres, représentés par les lacs de l’Est, ceux de la cuvette centrale et quelques lacs de dépression ;
- Les écosystèmes fluviaux, comprenant le fleuve Congo, ses affluents principaux et secondaires ; et,
- Les écosystèmes marins représentés par le bief maritime du Sud – Ouest et la côte atlantique.
Le potentiel halieutique national est évalué à quelques 707.000 T maximum dont
environ 63 % seraient dans les eaux des grands lacs de l’Est (Tanganyika, Albert, Edouard et Kivu), 28 % dans le système fluvial, 8 % dans les lacs de dépression et ceux de retenue du Katanga, 1 % dans les eaux maritimes de la côte atlantique. La pêche est principalement concentrée sur quelques espèces de poissons qui représentent un pourcentage important du poids total de la capture. Plus de 90 % de la production sont l’œuvre des pêcheurs artisanaux qui récoltent les poissons sans respect des normes requises. Un projet de loi relative à la pêche a été préparé et n’attend plus que son examen par le Parlement.
8. Bois-énergie et habitat
La population de la RDCongo consomme annuellement en moyenne 45
millions de mètres cubes de bois sous forme d’énergie domestique. Cela équivaut à environ 12 millions de tonne équivalent de Pétrole (TEP). Le bois de chauffe et le charbon de bois représentent ainsi plus de 85% de la production et de la consommation comme source d’énergie domestique. Les exploitants artisanaux produisent la plupart du bois vendu sur le marché local (Debroux 2007). Ce secteur constitue l’une des causes majeures de la déforestation et de la dégradation des forêts à côté de l’agriculture itinérante sur brûlis. En effet, pour la quantité moyenne considérée, les besoins en énergie – bois impliquent l’exploitation d’environ 2,6 millions d’hectares de forêts, alors que l’exploitation forestière commerciale de bois d’œuvre ne concerne que moins de 100 000 hectares de forêts pour une production d’environ 500 000 m3. En tant que source d’énergie, la forêt est très sollicitée dans les environs des grands centres urbains jusqu’à un rayon de 150 à 200 km dans certains cas. Les essences les plus utilisées pour le charbonnage sont: Aidiaonchrolea, Arundinariaalpina, Blighiawelwitschii, Caloncobawelwitschii, Cola nitida, Corynanthepaniculata, Croton haumanianus, Dialiumpachyphyllum, Hylodendrongabuenense, Hymenocardiaacida, Macaranga spp.,Musangacercropioides, Xylopiaspp., etc.
Comme souligné ci-haut, les forêts sont essentielles pour la survie de la population congolaise surtout pour les communautés locales et les peuples autochtones comme les pygmées. L’importance sociale et culturelle des forêts pour les populations qui y habitent est incommensurable. La plupart de leurs habitats (environ 64% de maisons des ménages ruraux) sont en pisés et construits en matériaux locaux, notamment en pailles ou en chaumes fabriqués localement en faisant usage aux folioles à Raphia sp. ou aux feuilles des Marantaceae ou des Poaceae, les sticks, etc.
9. Produits forestiers non ligneux
Les produits forestiers non ligneux (PFNL) sont nombreux y compris les plantes
médicinales, alimentaires et cosmétiques ainsi que le gibier. Ils échappent le plus souvent aux statistiques nationales et contribuent dans une large mesure au commerce illicite transfrontalier. Par exemple, les graines du poivre noir, Piper guineense, font l’objet d’un commerce national et transfrontalier intense sans que l’on trouve les statistiques de leur production dans les rapports officiels. Ceci est également valable pour certaines plantes médicinales telles que les écorces de
Rauwolfia dont toute la production n’est pas déclarée. La consommation locale des feuilles de Gnetum africanum a fait que cette espèce est devenue rare dans les zones proches de Kinshasa, grand centre de consommation de ce légume très prisé par la population. Actuellement, l’approvisionnement de la capitale se fait à partir des provinces éloignées sans précaution pour garantir la durabilité de l’exploitation. Aussi le rotin est intensément exploité par la population qui l’utilise comme matériel de construction, de fabrication de meubles, etc.
Les PFNL constituent de ce fait une source importante de subsistance et de revenus,
contribuant ainsi à la sécurité alimentaire. Une partie de ces produits sert à l’autoconsommation et une autre est destinée à la vente sur les marchés locaux, urbains, voire internationaux apportant ainsi des revenus financiers appréciables qui permettent de résoudre certains problèmes pertinents liés à l’amélioration des conditions de vie (Toirambe, 2007).
Au sujet de la contribution des PFNL à l’économie des ménages et à la sécurité
alimentaire, Biloso et Lejoly (2006) notent que dans les communes urbano-rurales de Kinshasa, la contribution du commerce des feuilles de Gnetum africanum au revenu mensuel du ménage demeure le leader incontestable avec une recette moyenne de 275 dollars EU, suivie desfrondes de Pteridiumcentrali-africanum avec 166,70 dollars EU par mois et par ménage, desfeuilles de Dracaena camerooniana avec 75,55 dollars EU par mois et par ménage, des tuberculesde Dioscoreapraehensilis avec 71 dollars EU/mois/ménage et des feuilles de Psophocarpusscandens avec 58,75 dollars EU/mois/ménage.
Dans les deux marchés de Mbandaka (Central et WendjiSecli), Ndoye et Awono (2005) avaientévalué, pendant douze mois, la vente des feuilles de Gnetum sp. pour un volume de 47.200 kg à21.904 dollars ; le commerce de 145.015 kg de feuilles de Maranthaceae pour une valeur de
3.446dollars ; et la vente de 105.554 litres de vin de palme pour un chiffre d’affaire de 13.054 dollars.
Les plantes médicinales constituent un produit essentiel pour la population
congolaise, mais il existe peu d’information d’ensemble sur ce sujet. La population congolaise utilise traditionnellement plusieurs centaines d’espèces de plantes alimentaires et médicinales. Presque toutes les populations congolaises, tant urbaines que rurales, recourent aux plantes médicinales. (Nyakabwa et Gapusi 1990; Chifundera 2001; Terashima 2001; Yamagiwa 2003). Les écorces de Prunus africanus, de Cinconaedulis (quinquina), d’Hymenocardiaacidasont utilisées dans l’industrie pharmaceutique.Il y a aussi des unités pharmaceutiques et des petites usines, qui fabriquent des médicaments à partir des plantes médicinales en RDCongo. Plusieurs tradipraticiens et des sages-femmes utilisent abondamment des plantes médicinales pour soigner leurs malades en milieu rural comme urbain. Dans les marchés, il y a toujours des stands réservés aux plantes médicinales. Cependant, à part quelques plantations de quinquina et de Rauwolfia, les plantes médicinales ne sont pas cultivées en RDCongo, la pharmacopée nationale, les marchés et l’industrie pharmaceutique sont approvisionnées par la cueillette spontanée en forêts et savanes naturelles.
D’autres PFNL médicinaux trouvés en RDC par contre sont exclusivement utilisés
en médicine tant traditionnelle que moderne. C’est le cas notamment des écorces de Hymenocardiaacida (décocté contre l’amibiase), de Rauwolfia vomitoria (macéré contre les maladies sexuellement transmises) et de Prunus africana(syn. Pygeumafricanum) dont le décocté des écorces du tronc est utilisé en lavement (un irrigateur par jour) pour lutter contre les douleurs lombaires et les fatigues généralisées. En médecine moderne, les études pharmacologiques et les expérimentations cliniques ont mis en évidence les propriétés thérapeutiques de principe actif tiré des écorces de ces plantes. C’est le cas par exemple du complexe lipido-stérolique extrait des écorces de tronc de Prunus africana que l’industrie pharmaceutique produit des médicaments utilisés dans le traitement des troubles mictionnels de l’adénome prostatique chez l’homme (Kabala et Toirambe,1996).
Conformément aux dispositions pertinentes de la Loi relative à la conservation de
la nature, un projet de Décret est en cours de préparation pour réglementer l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation. Une stratégie y afférente est aussi en cours de préparation.
En ce qui concerne les PFNL d’origine animale, selon Fa et al. (2003) et Wilkie et Carpenter (1999),la consommation de gibier peut s’estimer à 1,4 millions de tonnes par an pour un chiffre d’affaire pouvant être évaluée à 1,4 milliards de dollars américains, en considérant le prix moyen de 3,5dollars/kg. Les singes, les céphalophes, les potamochères, les rongeurs constituent la plus grande part de ce gibier, mais les gens préfèrent également la viande des buffles, de l’éléphant, de l’hippopotame, des reptiles et des oiseaux, ainsi que de grandes quantités de chenilles, de sauterelles, de criquets, de termites, etc. Dans le marché central de Kikwit (Bandundu), Ndoye et Awono (2005) ont pu évaluer la vente de 14,194 tonnes de chenilles pendant huit mois pour une valeur marchande de 17.939 dollars. Dans la Réserve de Biosphère de Luki, Toirambe (2002) avait confirmé l’existence d’une véritable entreprise cynégétique dans cette réserve et ses environs avec 16 points de vente de gibier comptant un effectif de 83 vendeurs
(tous des hommes) dont l’âge varie de 20 à 45 ans. Le revenu moyen par vendeur et par semaine était évalué à 16,14 dollars, soit 64,56 dollars/mois/vendeur.
Depuis 2013, la RD Congo participe au projet sous régional « Gestion durable de la
faune sauvage et du secteur de la viande de brousse en Afrique Centrale » financé par le Fonds pour l’Environnement Mondial (FEM). Ledit projet a pour objectif de démontrer que la gestion participative de la faune sauvage peut être une option fiable pour : (i) la conservation de la biodiversité, (ii) permettre aux écosystèmes forestiers de continuer à jouer leurs fonctions écologiques, et (iii) contribuer à l’amélioration des moyens d’existence des communautés locales.
Ce projet est mis en œuvre par la FAO en collaboration avec notamment la Commission des Forêts d’Afrique Centrale (COMIFAC) et le Réseau d’Aires Protégées d’Afrique Centrale (RAPAC). La République du Congo, le Gabon et la République Centrafricaine participent aussi à ce projet.
10. Paiement des services ecosystemiques et bien être humain
La notion de paiement des services écosystémiques(PSE) renvoie essentiellement
aux usages et rétributions qui peuvent être faits de la nature et des ressources naturelles. Six types de services sont souvent cités, il s’agit de :
- l’approvisionnement ;
- la régulation liée aux processus des écosystèmes ;
- services culturels et aménités ;
- soutien aux conditions favorables à la vie ;
- la séquestration et puits de carbone ; et
- services génétiques, oncologiques et de banques génétiques.
Une distinction est généralement établie entre les services issus de la gestion des
cycles de l’eau, ceux associés à la présence de forêts, ceux dérivés de la biodiversité, et enfin ceux procurés par les paysages. L’idée de mettre une valeur aux écosystèmes, espèces et gènes est de démontrer leur utilité à l’économie et à la société afin qu’elle en prenne soin pour en assurer une pérennité.
Il est possible de promouvoir tous ces services écosystémiques en RDCongo, il
suffira de les identifier pour les vulgariser auprès des décideurs et de la population afin de les mettre en pratique pour les rentabiliser.
Les services écosystémiques plus en vogue aujourd’hui en RDCongo sont ceux liés
au marché de carbone, à la séquestration et aux mesures d’atténuation des gaz à effet de serre (GES). D’après une carte préliminaire, le carbone forestier total en RDCongo est de 24,5 Gigatonnes (GT). Les ¾ de ce carbone sont concentrés sur 43% de la superficie du territoire (Centre, Nord et Est du pays) (Carte 4). Les forêts congolaises séquestrent le carbone et contribuent à l’atténuation du réchauffement climatique dans des proportions d’envergure mondiale. Elles contribuent à réguler le régime hydrique des bassins du Congo et du Nil, qui sont parmi les plus grands bassins versants du monde.
Figure 4:Carte de densité en carbone de la biomasse et pertes récentes du couvert forestier en RDC
D’autres services essentiels rendus par les écosystèmes en RD Congo sont la
formation des sols et le contrôle de l’érosion(Figure 5) ainsi que les services de provision tels que l’approvisionnement en produits forestiers non ligneux qui contribuent de manière significative à la subsistance des populations locales.
En vue d’assurer la promotion des paiements pour services environnementaux en
RD Congo, il a été créé en 2009, au sein de la Direction de Développement Durable (DDD) du Ministère en charge de l’Environnement, Conservation de la Nature et Développement Durable, la Division des Services Environnementaux (DES).
Le mandat de la DSE est de permettre au pays de s’impliquer aux enjeux
environnementaux du moment et de gérer les marchés des services environnementaux (paiement pour services environnementaux). Ces derniers offrent des options attractives pour la RD Congo ainsi que de nouvelles perspectives pour marier le développement socio-économique et communautaire, la protection de la biodiversité et la lutte contre les changements climatiques.
La DDD, à travers cette Division, a reçu mandat d’appuyer les initiatives
communautaires liées aux services environnementaux, au développement et à la diversification des activités économiques en milieu rural. Pour l’opérationnalisation de ce mandat, le Ministère de l’Environnement a bénéficié d’un appui dans le cadre de la composante 2 du Programme Forêt et Conservation de la Nature (PFCN) financé par le Fonds pour l’environnement mondial (FEM) et la Banque Mondiale.
Cet appui devrait permettre notamment : (i) le démarrage des activités des projets
pilotes permettant de générer des revenus pour les communautés locales et autochtones ; (ii) l’appui au développement et à la mise en œuvre de la stratégie nationale de séquestration de carbone forestier ; et (iii) l’élaboration de la stratégie nationale et la mise sur pied d’un cadre légal et réglementaire sur la Bioprospection.
Malheureusement, le Programme forêt et conservation de la nature a été cloturée en
juin 2015 sans que l’ensemble des activités prévues n’aient pas été réalisées.
Figure 5:Carte du Risque d’érosion
Section 3 : Principales menaces sur la biodiversité et leurs causes
Les récifs coralliens comptent parmi les écosystèmes les plus riches, mais aussi les
plus menacés. L’ours blanc, un des symboles les plus célèbres de la biodiversité menacée, par le changement climatique notamment (WWF, 2022).
Depuis le Sommet de la Terre de 1992, il est établi que la biodiversité est gravement
menacée par les activités humaines et s’appauvrit d’année en année à un rythme sans précédent. Depuis son apparition il y a 100 000 ans, l’humain a eu un impact croissant sur l’environnement, jusqu’à en devenir le principal facteur de changement. Avec la révolution industrielle, le rapport de domination de l’humain sur la nature est devenu si considérable que certains scientifiques soutiennent que ce fait marque l’entrée dans une nouvelle époque géologique, l’Anthropocène. La disparition des espèces est bien souvent le signe le plus visible de cette érosion de la biodiversité. À tel point que l’on parle parfois de « Sixième Extinction » pour désigner cette extinction massive et contemporaine des espèces, l’extinction de l’Holocène, en référence aux cinq grandes vagues d’extinctions massives survenues sur Terre au cours des temps géologiques.
Cinq menaces majeures pesant sur la biodiversité ont été identifiées : la destruction
des habitats, la surexploitation (chasse, pêche), les espèces envahissantes, le changement climatique et la pollution.
Une méta–analyse réalisée en 2022 pour l’IPBES révèle que, parmi les cinq grands
facteurs de pressions humaines qui contribuent directement à réduire la diversité du vivant, les deux plus importants sont les changements d’utilisation du sol et l’exploitation directe de ressources naturelles ; viennent ensuite la pollution, le changement climatique et les espèces invasives
En 2019, l’IPBES a mis à jour cet état des lieux. Selon le « Rapport sur l’état de la
biodiversité mondiale » (2019, réalisé en trois ans, par 145 experts de 50 pays à partir de plus de 15 000 références scientifiques) :
- Depuis le précédent rapport, l’artificialisation du monde a fortement augmenté : 66 % des mers sont significativement « modifiées » par l’humain ; l’agriculture et l’élevage occupent 30 % des terres émergées tout en consommant 75 % des eaux douces disponibles ; 33 % des ressources halieutiques sont surexploitées et les zones urbaines ont plus que doublé depuis le sommet de Rio (1992) ; la pollution par le plastique est six fois plus importante qu’en 1980. « La valeur de la production agricole a augmenté d’environ 300 % depuis 1970, la récolte de bois brut a augmenté de 45 % et environ 60 milliards de tonnes de ressources renouvelables et non renouvelables sont maintenant extraites chaque année dans le monde – quantité qui a presque doublé depuis 1980 » ; 500 000 espèces terrestres (+/- 9 % d’un total estimé de 5,9 millions d’espèces ont maintenant « un habitat insuffisant pour leur survie à long terme, si leur habitat n’est pas restauré » ;
- De 1900 à 2016, le rythme d’érosion de la biodiversité est « sans précédent dans l’histoire humaine » et il accélère encore. L’abondance moyenne des espèces locales dans les grands habitats terrestres a chuté d’au moins 20 %, environ 40 % des amphibiens, 33 % des récifs coralliens et plus de 33 % des mammifères marins et au moins 10 % des environ 5,5 millions d’espèces d’insectes sont proches de l’extinction. Plus de 680 espèces de vertébrés ont disparu depuis les années 1500, et les espèces domestiquées ne sont pas épargnées avec au moins 9 % de toutes les races domestiquées de mammifères considérées comme éteintes en 2016. Les évaluations scientifiques montrent que « ces tendances ont été moins graves ou évitées dans les zones qui appartiennent à ou sont gérées par des peuples autochtones et des communautés locales » ;
- Des causes indirectes (peu développées par le précédent rapport) sont, note l’IPBES, la démographie mondiale, la consommation par habitant, l’innovation technologique et une gouvernance et des responsabilités ne tenant pas compte des limites écologiques.
Ce travail a été conçu pour préparer la « Convention des Nations Unies sur la
diversité biologique » (COP15), prévue en Chine en 2020 comme un « pendant » à l’Accord de Paris sur le climat (2015). Le rapport a été présenté le jour de sa publication aux ministres de l’environnement du G7 réunis à Metz. Les ministres, ainsi que le représentant de la commission européenne chargé de l’environnement et de quelques autres pays, ont, sur cette base scientifique, adopté une charte (« Charte de Metz ») contenant trois axes : 1) lutter contre l’érosion de la biodiversité ; 2) encourager de nouveaux acteurs à s’engager ; 3) créer un cadre mondial de la biodiversité.
Par ailleurs, les principales menaces qui pèsent sur la biodiversité en R.D. Congo
sont :
- La déforestation;
- La dégradation des habitats ;
- Le braconnage ;
- L’exploitation non planifiée et extensive des ressources halieutiques ;
- L’introduction des espèces exotiques envahissantes ;
- La perte de l’agro-biodiversité ; Le changement climatique ;
- L’exploitation minière.
A ces menaces, il faut ajouter certains facteurs qui impactent négativement la
conservation et l’utilisation durable de la biodiversité. Il s’agit notamment :
- De la gestion inadéquate des aires protégées et des espaces de conservation exsitu;
- De la discontinuité des inventaires taxonomiques ; – Et des conflits armés.
3.1.1 Déforestation
En juillet 2017, la revue Nature publie un étude montrant que le recul mondial de la
forêt naturelle érode de manière « disproportionnée » la biodiversité ; les dernières forêts et paysages intacts devraient être protégés concluent les auteurs. La forêt tropicale continue à régresser et là où le couvert forestier recule, le risque qu’une espèce glisse dans la catégorie « menacée » ou qu’elle bascule dans une catégorie de menace plus élevée et qu’elle présente des populations en déclin augmente « considérablement ». Ce risque est en outre « disproportionné » dans les hot-spots de biodiversité que sont les massifs forestiers tropicaux de Bornéo, d’Amazonie centrale et la forêt du bassin du Congo ; là même une très faible déforestation (routes, pistes forestières, aires de stockage, petite urbanisation…) a de graves conséquences pour la biodiversité des vertébrés. Les scientifiques n’ont pas trouvé de preuve que la perte de forêt est plus grave et plus préjudiciable dans les paysages déjà fragmentés que dans ces massifs mieux préservés66 ; pour Bornéo, l’Amazonie centrale et le bassin du Congo une modélisation prédit qu’au rythme actuel de leur dégradation, rien que pour les vertébrés, 121 à 219 autres espèces rejoindront la liste des espèces menacées entre 2017 et 2050.
Le réchauffement climatique pourrait encore aggraver la situation, de même que la
dette d’extinction. Or, l’artificialisation du monde s’aggrave rapidement. Or, seules 17,9 % de ces trois zones sont actuellement protégées par un document écrit et moins de la moitié (8,9 %) ont une protection stricte. De nouveaux efforts de conservation et de restauration de l’intégrité écologique des forêts sont urgemment à mettre en œuvre à grande échelle (mégaréserves naturelles, réellement protégées, déjà suggérées en 2005 par C. Peres70) « pour éviter une nouvelle vague d’extinction globale ».
Un concept complémentaire, celui de pays mégadivers, complète cette approche. Il
vise à rapprocher entre eux les pays sur la base de leur capital naturel. Ainsi, 17 pays ont été identifiés par le Centre mondial de surveillance pour la conservation de la nature comme possédant à eux seuls 70 % de la biodiversité planétaire, leur conférant un rôle particulier dans la préservation de cette diversité
L’évaluation de changement du couvert forestier de la RD Congo entre 1990 (année
de référence) et 2010 donne un taux de déforestation annuel de 0,31 ± 0,042% (Carte 6). Ce taux est faible ; mais il est nettement plus élevé dans les zones à fortes densités de population et près de certaines agglomérations (Bumba, Gemena, Kananga, Kinshasa, Lisala, Lubumbashi, Kisangani, Wamba, Watsha, etc.) où les forêts ont littéralement disparu dans un rayon dépassant les 150 km, à cause notamment de la forte dépendance de la population à l’énergie ligneuse (DIAF, 2015).
L’exploitation forestière en RDC se fait dans une illégalité systématique
avec la complicité des dirigeants locaux, et dans une très grande violence envers les populations locales, avec plusieurs atteintes d’ordre environnemental. Nous prenons pour des besoins d’illustration de cette analyse l’accablant rapport de Global Witness publié le 03 Juin 2015 et intitulé «L’impunité importée. Comment les forêts du Congo sont exploitées illégalement pour le marché international. De ses enquêtes, Global Witness a démontré que le bois de la RDC dont le commerce représente 87,1 millions d’euros est produit par des entreprises qui ne respectent pas les lois destinées à protéger les forêts, en plus, elles ne paient pas les redevances forestières au gouvernement congolais.
L’absence de l’administration sur le terrain, son laxisme devant les violations des
textes réglementaires et législatifs, l’absence de contrôle et des sanctions dérisoires sont à la base de ce commerce florissant qui a occasionné une grande déforestation de la forêt congolaise
L’occupation disproportionnée de l’espace national, avec environ 47 % de la
population concentrée sur seulement 10 % du territoire, entraîne une forte sollicitation sur les ressources présentes, dépassant parfois la capacité même de charge. On note des zones isolées de fort peuplement humain en bordure du grand massif forestier de la cuvette centrale avec comme corollaire, l’augmentation des besoins en bois-énergie et en terres agricoles.
L’ouverture des voies d’accès pour l’exploitation forestière conduit à une
colonisation de nouveaux espaces par la population cherchant à profiter des facilités et autres infrastructures amenées par l’exploitant forestier, pour réaliser des activités de l’agriculture, de recherche de bois-énergie, du braconnage, de la recherche des PFNL, etc.
Cette déforestation résulte notamment : (i) de la forte dépendance de la population
à l’énergie ligneuse et faible recours aux énergies de substitution comme solaire, éolienne, hydroélectrique; (ii) de la pratique généralisée de l’agriculture itinérante sur brulis (iii) de l’implantation anarchique des carrières minières ; (vi) de l’absence de zonage et de plans d’utilisation de terres forestières et agricoles ; (vii) de la non application des dispositions légales et règlementaires relatives à la gestion durable des forêts.
À travers le monde dans une méta–analyse, Blowes et al. (2019) ont quant à eux
analysé plus de 50 000 séries chronologiques sur la biodiversité provenant de 239 études ayant produit des enregistrements temporels de composition d’espèces sur un site, les principaux types d’écosystème et de zones climatiques étant ici représentés. Ce bilan montre que les espèces et leur abondance ont rapidement et significativement changé, même sur les seules 25 dernières années. Les effets de cette réorganisation ne sont qu’incomplètement compris, mais ils affectent déjà l’économie mondiale.
Néanmoins, certaines dispositions permettent d’atténuer les différentes menaces
observées sur les composantes de la diversité biologique. Outre les méthodes conventionnelles relatives à l’évaluation, à la surveillance et à l’atténuation des menaces devant servir de référence et de guide à la mise sur pied d’un programme national cohérent, la RDC dispose des structures éparses spécialisées dans les domaines d’alerte, de surveillance ainsi que de la quarantaine dans le cadre de l’introduction du matériel vivant intact ou modifié. Cependant la logistique utilisée ainsi que les compétences requises paraissent inadaptées, inefficaces et rudimentaires.
Par ailleurs, la promulgation du Code forestier en 2002 a apporté des innovations
favorables à la contribution du secteur forestier à la lutte contre la pauvreté et à la gestion durable des Forêts. Par ses dispositions sur les « Forêts des communautés locales », la clause relative au volet social des cahiers des charges associées aux contrats de concessions forestières industrielles et la rétrocession de 40 % du produit des adjudications aux entités locales décentralisées, le code forestier marque une avancée considérable vers la reconnaissance des droits des communautés sur la gestion des Forêts dont elles dépendent traditionnellement pour leurs moyens d’existence.
Malgré ces dispositions, la responsabilisation des communautés locales dans la
gestion forestière n’est pas encore effective et le partage des bénéfices issus de l’exploitation forestière se fait toujours attendre. En effet, il a été constaté que : (i) les textes réglementaires, en particulier le décret portant sur les modalités d’attribution des concessions aux communautés locales, ne sont pas encore publiés, (ii) les procédures de gestion des forêts des communautés locales et de négociation sur des bases équitables des clauses des cahiers des charges n’ont pas encore été élaborées, (iii) le personnel du ministère en charge des forêts et des ONG, y compris les autorités locales, n’ont pas les compétences requises pour accompagner Ie développement de la foresterie communautaire.
En définitive, le problème qui sous-tend le retard constaté dans la mise en pratique
des dispositions relatives à l’implication des communautés locales dans la gestion forestière et le partage des bénéfices se pose donc en terme de « comment faire ». En d’autres termes, il renvoie à l’absence d’outils appropriés à la mise en œuvre de la foresterie communautaire. De ce fait, la contribution du secteur forestier à la lutte contre la pauvreté en milieu rural demeure donc insuffisante. II est aussi certain qu’avec le redémarrage du secteur forestier et particulièrement l’industrie du bois (formelle et informelle), si ces dispositions ne sont pas mises en pratique, les ressources forestières seront exposées à une exploitation non durable et conduire à leur dégradation.
Figure 6: Carte Types de forêts naturelles et perte récente du couvert forestier en RDC
3.1.2 Dégradation des habitats naturels
La détérioration des habitats a été la principale cause de l’érosion de la biodiversité
ces cinquante dernières années, principalement en raison de la conversion de milieux naturels et semi-naturels en terres agricoles. Ainsi, 50 % de la superficie d’au moins la moitié des 14 biomes de la planète ont déjà été convertis en terres de culture. La déforestation a détruit 16 millions d’hectares de forêts par an dans les années 1990, et 13 millions d’hectares ont également disparu au cours des années 200086. L’une des principales conséquences de cette occupation des sols est la fragmentation des habitats, qui a des répercussions graves sur de nombreuses espèces83.
Selon une étude de l’association Botanic Gardens Conservation
International (BGCI), publiée en septembre 2021, un tiers des arbres de la planète sont menacés d’extinction, spécifiquement au Brésil, en raison de l’agriculture intensive et du changement climatique.
L’Évaluation des écosystèmes pour le millénaire propose quatre scénarios sur
l’évolution future des écosystèmes au cours du XXIe siècle, selon l’importance qu’en accordera le monde et les modes de gestion. Ces futurs peuvent emprunter deux voies : un monde de plus en plus mondialisé ou un monde de plus en plus régionalisé. Les scénarios s’appuient ensuite sur différentes approches concernant notamment la croissance économique, la sécurité nationale, les technologies vertes et le traitement des biens publics. Le rapport conclut qu’il est possible de relever le défi d’inverser le processus de dégradation des écosystèmes, mais que cela nécessite des changements profonds des politiques et des pratiques qui sont loin d’être en voie de réalisation.
La Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et
les services écosystémiques (IPBES) publie le 8 juillet 2022 un rapport sur la surexploitation des espèces sauvages. Les champignons, les algues et les plantes sauvages constituent des sources d’alimentation et de revenu pour une personne sur cinq, 2,4 milliards dépendent du bois en tant que combustible pour cuisiner, et environ 90 % des 120 millions de pêcheurs traditionnels travaillent à petite échelle. Plus de 10 000 espèces sauvages sont exploitées pour l’alimentation humaine. Le bois est une ressource vitale pour 1,1 milliard de personnes qui n’ont accès à aucun combustible, et deux tiers de la production mondiale de bois rond proviennent d’espèces d’arbres sauvages. Les deux tiers des espèces ne sont pas utilisées de manière durable : l’exploitation forestière non durable menace 12 % des espèces d’arbres sauvages et elle met en danger plus de 1 300 mammifères sauvages. Environ 34 % des stocks mondiaux de poissons sauvages marins sont surexploités.
La destruction des habitats naturels et le développement des activités humaines
causent le déclin de centaines d’espèces animales et végétales. Raison pour laquelle la Liste Rouge de l’UICN des espèces menacées continue, malheureusement, de s’allonger chaque année après une mise à jour. C’est le cas de l’okapi (Okapia johnstoni), symbole national de la République du Congo, menacé d’extinction et le Rhinocéros blanc (Ceratotheriumsimum), autre espèce animale emblématique du pays, quasiment disparu.
Les principales causes de cette destruction des habitats naturels en RD Congo sont
entre autres : (i) les feux de brousses; (ii) la législation obsolète et non appliquée sur l’utilisation des feux de brousse; (iii) la chasse abusive et non réglementée; (iv) la démotivation des gardeschasse ; (v) l’exploitation anarchique de bois d’œuvre, de diamant, de l’or et du coltan favorisée par des conflits armés et la pauvreté généralisée de la population; (vi) l’utilisation de mauvaises techniques traditionnelles de récolte des plantes médicinales et alimentaires ; (vii) l’inexistence des plans d’utilisation des sols et du zonage ; (viii) la pratique des méthodes culturales inadaptées aux types de sols et leurs inclinaisons ; (ix) la collecte abusive de la matière ligneuse comme bois de chauffe ou de construction ; et (x) la forte dépendance de la population à l’énergie-bois. A ces causes, il y a lieu d’ajouter la pollution des systèmes aquatiques par des déchets notamment ménagers et des polluants des usines d’exploitations minières. Ce phénomène est de plus en plus visible dans les grandes agglomérations et les villes minières du Katanga.
Figure 7:Carte de l’Indice d’importance des concessions forestières pour la conservation des espèces menacées en
RDC
3.1.3. Braconnage des espèces fauniques Le braconnage des espèces fauniques résulte notamment du fait : (i) d’une législation sur
la chasse non renforcée et non mise en œuvre effectivement ; (ii) d’une forte demande de la viande de brousse qui comprend la forte commercialisation et la chasse des gibiers liée à la culture alimentaire de certaines tribus; (iii) d’une forte préférence de la viande de brousse en comparaison avec la viande de boucherie ; (iv) d’une valeur monétaire élevée de certains organes des animaux ; (v) des conflits armés qui provoquent la prolifération des armes à feu. Le braconnage est l’une des causes du déclin des espèces de faune. Les effectifs de certaines populations d’espèces ont tellement baissé que des mesures urgentes s’imposent. Il s’agit notamment des grands singes, de l’okapi et des éléphants.
3.1.4. Pêche non planifiée et extensive des ressources halieutiques
Bien que la pêche représente une des activités importantes contribuant aux moyens
de subsistance de plusieurs milliers de ménages abritant le long des rivières, les lacs, les fleuves Congo et Shiloango, la zone côtière maritime de notre pays en leur assurant un revenu, elle fait malheureusement face à des modifications qualitatives et quantitatives de l’abondance des ressources halieutiques, consécutives à une exploitation abusive des ressources biologiques et à des mutations environnementales importantes. Des menaces et des agressions multiformes, d’origine anthropique, se développent dans les zones de pêche avec un impact négatif sur les ressources halieutiques. Ce secteur se fait surtout de manière non planifiée et extensive.
Les causes directes de la pêche non planifiée et extensive des ressources
halieutiques sont : (i) une législation de la pêche obsolète et non adaptée au contexte moderne de gestion; et (ii) des quotas de pêches non-établis ou encore, déterminés arbitrairement.
Les causes profondes de la pêche non planifiée et extensive des ressources
halieutiques sont les suivantes : (i) l’utilisation de matériel de pêche non autorisé et la taille des mailles de filets non respectée ; (ii) l’utilisation de certaines méthodes de pêche traditionnelles ou modernes prohibées (empoisonnement de rivières, pêche aux embouchures et lieux de confluents, etc.) ; (iii) la pêche dans les frayères et lieux de reproduction ; (iv) les stocks halieutiques inconnus et quotas pas connus; (v) peu de spécialistes dans la gestion de la pêche et de la détermination des quotas ; (vi) la non-participation des communautés riveraines dans l’établissement et le respect des quotas et périodes de pêches ; et (vii) un système de gestion des pêches inadéquat.
3.1.5 Gestion inadéquate des aires protégées et des espaces de conservation ex-situ
La R.D. Congo possède un système impressif d’aires protégées couvrant près de 13,3% du territoire national et regorgeant un potentiel des ressources biologiques exceptionnel. Cependant, la plupart de ces aires protégées sont en péril et ne possèdent même plus du personnel pour les gérer. D’autres aires protégées ont été envahies par les communautés riveraines environnantes à la recherche de nouvelles terres agricoles ou des pâturages pour leur bétail. C’est le cas notamment des aires protégées de l’Est du pays qui font face à une forte pression anthropique.
Aujourd’hui, on observe que même les aires protégées n’offrent plus les garanties
souhaitées pour une conservation efficace des espèces qui s’y trouvent. En effet, outre l’attitude négative des communautés riveraines et de l’insécurité régnant dans les zones de conservation, les aires protégées connaissent d’énormes difficultés par l’insuffisance des infrastructures immobilières et de surveillance, à des faibles moyens humains et financiers, à la lourdeur de son administration, et à des faits de guerre où la quasi-totalité des aires protégées du pays ont été envahies par les fabricants de charbon de bois, les exploitants agricoles et miniers et même des braconniers.
En résumé, les principales causes directes de la mauvaise gestion des aires protégées
et des espaces de conservation ex-situ (jardins botaniques et zoologiques, banques génétiques) sont de trois ordres :
- La faible implication des communautés riveraines dans la gouvernance, la cogestion et le partage de bénéfices issus des aires protégées ou des jardins zoologiques ou botaniques ;
- la non application effective ou le non-respect de la législation nationale sur la conservation de la nature ;et,
- l’inexistence de banques génétiques pour la conservation de germoplasmes en laboratoires (ex-situ).
Les causes profondes de cette gestion inadéquate des AP et espaces de conservation
ex-situ sont les suivantes : (a) pas de motivation aux populations riveraines à participer dans la gouvernance et la cogestion des AP à travers le partage des avantages découlant de la biodiversité; (b) le manque de formation aux techniques de cogestion des AP et de participation des populations riveraines ; (c) le personnel insuffisant, peu qualifié ou peu motivé ; (d) la méconnaissance du rôle des banques génétiques dans la préservation de germoplasmes ; et (e) l’absence de formation dans le génie biologique ou la bio-prospection.
3.1.6. Discontinuité des inventaires taxonomiques
Depuis plus de 70 ans les inventaires taxonomiques intenses ont cessé en R.D. Congo. Les connaissances actuelles des espèces vivant en R.D. Congo restent limitées. Les rares recherches taxonomiques menées au cours des 20 dernières années, notamment par le programme régional de conservation de la biodiversité (CARPE), ont abouti à la description de nouvelles espèces de plantes supérieures, d’animaux ou de poissons. Il est impossible de sauvegarder une biodiversité si elle n’est pas connue. Les modes d’exploitation des ressources naturelles, la destruction des habitats, la déforestation, l’introduction des espèces exotiques invasives mettent en danger, sans qu’on s’en aperçoive, la biodiversité de la R.D. Congo.
Bien plus rares sont les systématiciens, botanistes et zoologistes, formés en R.D. Congo. Peu sont les herbiers, musées des sciences naturelles érigées pour les collections des spécimens dans le pays et s’ils existent ils sont mal entretenus.
En résumé, les causes directes et profondes de manque ou peu d’inventaires réalisés
sur la taxonomie et la santé des écosystèmes depuis plus de 70 ans sont les suivantes : (i) peu de personnel formé en taxonomie et inventaires des écosystèmes notamment forestiers ; (ii) inexistence d’herbiers et de musées d’histoire naturelle en R.D. Congo; et (iii) l’inexistence d’institutions spécialisées en surveillance et atténuation de menaces pesant sur la biodiversité et écosystèmes.
Toutefois, il convient de noter qu’un Centre de Surveillance de la Biodiversité
(CSB) vient de voir le jour à l’Université de Kisangani. Le Plan stratégique du CSB pour la période 2012-2017 s’articule autour de trois orientations stratégiques à savoir (i) la diffusion des informations sur la biodiversité ; (ii) la facilitation de partenariats pour augmenter la connaissance sur la biodiversité ; et (iii) la contribution au développement durable des communautés.
3.1.7. Introduction des espèces allochtones invasives
En R.D. Congo de plus en plus d’espèces exotiques envahissantes sont signalées. Il
y en a qui sont introduites au hasard ; tandis que d’autres ont été importées délibérément. D’autres espèces et cultivars introduits ont été des races exotiques améliorées pour l’agriculture et qui rivalisent avec les cultivars locaux et traditionnels qui tendent ainsi à disparaître.
L’introduction involontaire résulte principalement du fait que la R.D. Congo n’a
pas vraiment de système de contrôle efficace aux frontières par rapport aux espèces invasives. Cette négligence est un danger permanent pour la méga-biodiversité de la R.D. Congo qui comprend beaucoup d’espèces endémiques.
Certaines espèces de poisson ou de plante sont des espèces envahissantes qui
perturbent la vie aquatique. Nous pouvons citer la bioinvasion par Heterotisniloticus, une espèce vorace très envahissante qui colonise les eaux du fleuve Congo et ses affluents. Il est localement appelé «kongoyasika» par certains pêcheurs et d’autres l’appellent «zaïko». Cette espèce exotique au Congo serait venue de la République Centrafricaine après rupture des digues dans les années 1970s. La jacinthe d’eau Eichorniacrassipesest une autre peste qui obstrue la navigation fluviale et le barrage d’Inga. Cette plante, originaire de l’Amérique du Sud serait introduite au Congo dans les années 1800s comme plante ornementale (Dieudonné Musibono dans « Ressources en eau de la RD Congo, une opportunité pour son développement »)[4]. Par ailleurs, il y a lieu de déplorer la présence des espèces exotiques envahissantes dans certaines zones agricoles.
Ainsi, à considérer les problèmes causés à la navigation fluviale, à la production de
l’énergie hydro-électrique et au secteur agricole, il y a lieu d’affirmer que les pertes économiques occasionnées par la présence d’espèces exotiques envahissantes seraient énormes.
En ce qui concerne particulièrement la lutte contre la jacinthe d’eau douce sur le
fleuve Congo, des activités conjointes avec la République du Congo sont à envisager.
En résumé les causes directes de l’introduction des espèces allochtones invasives
en R.D. Congo sont les suivantes : (i) une règlementation inexistante sur l’introduction des espèces allochtones ; et (ii) le système de contrôle des espèces invasives est inefficace ou inexistant aux frontières.
3.1.8. Peu de maitrise de l’agro-biodiversité
La R.D. Congo compte plus de 360 ethnies. Chacune de ces ethnies a cultivé
pendant plus de 300 ans de nombreuses espèces de plantes et cultivars qui se sont adaptés à leur milieu. Elles ont en même temps domestiqué traditionnellement des espèces et races animales.
L’ensemble de ces espèces, cultivars ou races constituent l’agro-biodiversité du pays, y compris les espèces de plantes et animales introduites et actuellement cultivées à grande échelle à travers le pays comme le manioc, la canne à sucre, le maïs, etc.
L’agro-biodiversité est sensible et résiste peu à l’introduction des espèces exotiques
envahissantes. Elle est souvent délaissée au profit de l’adoption des espèces exotiques dont le rendement agricole ou d’élevage est supérieur à celui des espèces, cultivars ou races locaux, favorisant ainsi l’érosion génétique du fait de la disparition des espèces traditionnelles.
Dès lors, les causes directes de la perte de l’agro-biodiversité en R.D. Congo sont : (a) l’introduction clandestine des espèces et gènes exotiques envahissants souvent
à rendement améliorés ou alors possédant des caractéristiques de résistance à des maladies ; (b) le manque de personnel et de laboratoires génétiques ou agroalimentaires appropriés pour contrôler le mouvement des semences ; et (c) le manque de législation adéquate pour réguler l’importation et surveiller l’introduction des organismes génétiquement modifiés (OGM) en R.D. Congo.
3.1.9. Conflits armes à répétition
Depuis 1994, la RD Congo connaît des conflits armés récurrents. Parmi les effets néfastes
de ces conflits figurent notamment la destruction de l’habitat et de la faune et la surexploitation des ressources naturelles.
La destruction de l’habitat et la disparition des animaux sauvages qui en découle ont été
parmi les effets les plus sévères de ces conflits sur l’environnement. Les réfugiés et les personnes déplacées durant les conflits ont été provisoirement installés parfois dans des zones écologiques marginales et vulnérables, comme dans les zones tampons ou à proximité des parcs nationaux. Des vastes étendues des aires protégées ont été ainsi affectées par de nombreuses activités exercées par des groupes armés, des déplacées de guerre et des réfugiés. Pour des raisons de subsistance, nombreux d’entre les déplacés et réfugiés se sont livrés à la coupe de la végétation pour cultiver des champs ou pour obtenir du bois de feu dans des aires protégées.
Du fait de la destruction de l’habitat, certaines espèces de la faune et de la flore sont
menacées d’extinction au niveau local. C’est le cas notamment du rhinocéros blanc du Parc National de la Garamba, des Bonobos dans la cuvette centrale, des éléphants, de l’okapi, etc.
Les conflits armés ont conduit à la surexploitation des ressources pour des motifs aussi de
subsistance qu’à des fins commerciales. A cause de l’insécurité et de leur impossibilité de se livrer à leurs activités agricoles habituelles, les populations ont progressivement été contraintes de se retourner vers les aliments sauvages, comme produits forestiers non ligneux, pour survivre tels que la viande de brousse et les plantes alimentaires ou médicinales sauvages.
Dans les régions où se déroulent les combats, les troupes belligérantes se livrent
régulièrement à la chasse de grands mammifères pour se nourrir. Cette pratique a eu des conséquences désastreuses sur les populations d’animaux sauvages. Les espèces de grands mammifères, dont le rythme de reproduction est lent, ont été particulièrement vulnérables et sont les premières à disparaître. Au Parc National de la Garamba de la R.D. Congo le braconnage avait pris de l’ampleur avec le désarmement des gardes chasses de ce parc lors du conflit de 1996 et 1997.
Par ailleurs, pour financer les activités militaires, les détenteurs du pouvoir dans les zones
en conflit se tournent vers l’exploitation et le commerce des ressources naturelles telles que l’ivoire, le bois d’œuvre, le diamant, le coltan et l’or.
Les guerres (1996, 1998, 2003, 2012) en R.D. Congo ont été désastreuses pour la
conservation de la biodiversité. Des évaluations y relatives menées par le centre du patrimoine mondial en plusieurs sites des aires protégées le démontrent. Les bâtiments de l’administration des parcs nationaux, les véhicules des gardes et les équipements ont souvent été pillés systématiquement par les troupes combattantes, rebelles et populations locales. Ces pillages ont conduit à l’affaiblissement des institutions avec comme conséquence la nuisance aux programmes d’entretien et de surveillance des aires protégées. Même l’occupation des territoires congolais par les troupes armées sous la bénédiction des occidentaux fait revivre les mêmes faits.
3.1.10. Réchauffement climatique
En 2010, le Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique propose
plusieurs scénarios possibles sur l’évolution de la biodiversité au cours du siècle en réponse à ce changement global. Ainsi, la canicule de 2021 dans l’Ouest de l’Amérique du Nord a conduit à la disparition d’un milliard de crustacés en Colombie–Britannique.
Le changement climatique, s’il n’est pas jugulé très rapidement, va conduire à une
perte massive de biodiversité, non pas selon une pente douce, mais par paliers (précipices) irréversibles9[5]. Selon Reporterre, les menaces sur le climat et la biodiversité sont intriquées
Le réchauffement climatique se remarque par la fonte des glaciers sur les hautes
montagnes de l’Est de la RDCongo comme Ruwenzori, Karisimbi et Mikeno. Il a pour conséquence la disparition des espèces, qui en dépendent, même si elles ne sont pas encore répertoriées.
En ce qui concerne les conséquences du changement climatique sur la zone côtière
de la RD Congo, d’après les informations fournies par la troisième Communication nationale5 de la RD Congo à la Convention Cadre sur le Changement Climatique, cette zone côtière risque de perdre près de 50 m à l’horizon 2050 du côté du cordon littoral (de la ville de Moanda à la pointe de Banana) si l’érosion maintient le rythme actuel de sa progression. La distance pourra être de 100 m du côté de NSIAMFUMU menaçant de disparition les 2/3 de la ville de VISTA et du village
NSIAMFUMU ainsi que l’Hôtel Mangrove qui risquent d’être emportés par les eaux océaniques.
Les inondations dues aux marées hautes sont également en train d’agir
négativement. Le tronçon routier reliant Banana à Muanda a déjà été emporté. Le GIEC/IPCC prévoit une élévation du niveau moyen de la mer de l’ordre de 0,5m vers l’an 2050 (LACAZE, 1993, in MECN-EF, 2001 ; Bourdial, 2001 ; OCDE, 2004).
Sur base de ce scenario, les impacts socio-économiques dans l’espace côtier de la RDCongo pourront être notamment les suivants :
- La disparition de toute la région des mangroves, constituée des terres basses et marécageuses (dont les eaux ont un taux de salinité moyen de 3%) qui, déjà avec le niveau actuel de la mer sont de temps en temps inondées lors des marées hautes. L’élévation du niveau de la mer entraînera l’envahissement total et l’installation permanente des eaux océaniques (taux de salinité moyen 35%). Le pays perdra ainsi, non seulement son écosystème protégé par la convention RAMSAR (depuis 1994), habitat des espèces biologiques menacées de disparition (tortue de mer et lamantins surtout), et un site touristique, mais aussi, un des puits locaux d’absorption de CO2 ;
- La disparition probable de toutes les agglomérations et infrastructures socioéconomiques érigées sur le plateau de Muanda (situé entre 20 et 30m au-dessus du niveau actuel de la mer). En effet, les actions hydrodynamiques (houles, marées, tempêtes,) vont se dérouler de plus en plus haut par rapport à leur niveau actuel ;
- Les aquifères de l’espace côtier vont voir s’accroître le phénomène d’intrusion saline qu’ils connaissent déjà actuellement. L’alimentation en eau potable de la population s’en trouvera encore plus menacée ; et
- Des bouleversements au niveau de la biodiversité, avec comme conséquence la diminution de la richesse biologique avec toutes ses conséquences au niveau de la chaîne trophique.
Les actions stratégiques d’adaptation pour la zone côtière concernent la prévention et la protection de l’habitat, le contrôle, la surveillance et la lutte contre les pollutions, le renforcement et l’application des textes juridiques, la sensibilisation des populations et le renforcement des capacités des experts nationaux.
En ce qui concerne particulièrement la prévention et la protection de l’habitat, les activités suivantes sont à envisager :
- Restauration des mangroves par le reboisement ;
- Développement des activités alternatives comme sources d’énergie afin de protéger les mangroves ;
- Surveillance de la pêche illicite ;
- Identification par la recherche des espèces nouvelles ;
- Développement de l’écotourisme dans le Parc Marin des Mangroves ; et
- Mise en place d’un observatoire de l’érosion côtière et réalisation des études en vue de la construction des ouvrages pour la stabilité du trait côtier.
3.1.11. Exploitation minière
La RD Congo est l’un des pays miniers les plus importants du monde. Le secteur
se divise en deux types d’exploitation : l’exploitation minière industrielle à grande échelle et l’exploitation minière artisanale à petite échelle (EMA). Entre 1,8 et 2 millions de travailleurs sont impliqués dans l’extraction minière de type artisanal, et douze millions de personnes, soit
18% de la population, dépendent directement ou indirectement de l’extraction minière artisanale.
Une évaluation conduite par le PNUE avait permis d’identifier les problématiques
environnementales suivantes associées à l’exploitation minière industrielle : la dégradation du paysage, la pollution de l’air et de l’eau, la contamination radioactive et la détérioration du bienêtre social.
Les problématiques prioritaires pour l’exploitation minière artisanale à petite
échelle sont les suivantes : la contamination au mercure, la dégradation biophysique et les impacts sur les forêts, la biodiversité et les aires protégées ainsi que d’importants impacts humains et sociaux, tels que les risques sanitaires, les violations des droits de l’homme et le travail des enfants.
La plupart des opérations minières au Katanga, le centre minier principal de la RDCongo, sont des exploitations à ciel ouvert qui entrainent une importante dégradation des sols et du paysage. Une étude d’échantillonnage environnemental dans la région de l’arc cuprifère du Katanga réalisée en 2010 par le PNUE en collaboration avec le laboratoire suisse Spiez a montré l’importance de la pollution des eaux de surface proches des sources de rejets et de déchets de minerais, la pollution au cobalt et au cuivre étant la plus préoccupante.
Le secteur minier artisanal et à petite échelle présente aussi quelques problèmes
environnementaux particuliers et inquiétants. La dégradation des sols avec une perturbation directe des cours d’eau, des plaines inondables et des berges des rivières est monnayée courante.
De plus, les impacts du secteur de l’EMA sur les forêts, la biodiversité et les aires protégées s’accompagnent également de la déforestation, du braconnage et de l’empiètement sur les parcs, liés à l’établissement des camps de mineurs ainsi que de leurs activités minières.
Des niveaux remarquablement élevés de pollution aux métaux lourds le long des
lits des rivières ont été relevés par le PNUE au Katanga. La concentration élevée en métaux lourds constitue une menace pour le bétail, les espèces aquatiques et les autres espèces sauvages.[6]
3.1.12 Surexploitation et exploitation illicite des ressources naturelles
La croissance démographique exponentielle de la population mondiale a intensifié
la pression liée à l’exploitation des ressources naturelles (voir Gestion des ressources naturelles). Les espèces ou groupes d’espèces les plus surexploités sont les poissons et invertébrés marins, les arbres, les animaux chassés pour la « viande de brousse », et les plantes et les animaux recherchés pour le commerce d’espèces sauvages. En 2012, la FAO constate que 57 % des stocks de pêche en mer sont exploités au maximum de leur capacité et qu’environ 30 % sont en situation de surpêche. Près de 1 700 espèces animales sont victimes de braconnage ou de trafic (pour la viande, la peau, l’ivoire, les cornes ou le commerce d’animaux sauvages), à l’exemple de l’éléphant d’Afrique, du rhinocéros de Sumatra, du gorille de l’Ouest ou du pangolin de Chine.
En RDC, la population recoure aux biens de la nature et sans se préoccupée sur la
notion de régénération ou disparition de certaines espèces. L’Etat ne s’intéresse plus au contrôle démographique de façon méthodique. La biodiversité induit et stabilise des processus écosystémiques fondamentaux, dans l’espace et dans le temps ; parfois quand une espèce ou un biotope disparaît, les services écosystémiques ou les fonctions qu’elle permettait sont maintenues grâce à d’autres espèces (on parle alors de réorganisation, avec redondance fonctionnelle), mais il apparaît que dans les écosystèmes complexes (forêt tropicale, récifs coralliens par exemple), cette redondance est limitée.
Sous l’effet de l’anthropisation du monde, et du dérèglement climatique, une partie
des écosystèmes s’est récemment dégradée et simplifiée ; des espèces disparaissent et les populations d’animaux, de végétaux, champignons et microbes régressent ou changent d’aire. Des groupes d’espèces, à des vitesses différentes selon leurs capacités de mobilité, se rapprochent des pôles ou sont trouvés plus en altitude pour coloniser des zones dont la température leur convient mieux. Et les espèces ubiquistes ont étendu leurs territoires, devenant pour certaines invasives.
Section 4 Conséquences de l’appauvrissement de la biodiversité
Ces menaces et leurs causes directes, sous-jacentes ou profondes ont entraîné entre
autres, la réduction des populations animales, même dans les aires protégées, et la destruction de l’habitat naturel. Elles résultent dans des opportunités manquées pour la valorisation de la biodiversité et des écosystèmes uniques du pays. D’où, entre autres, les conséquences suivantes:
- Perte des opportunités pour la bio-prospection et valorisation des ressources génétiques par l’agro-biodiversité, les plantes médicinales, la pisciculture ;
- Perte des essences rares et de banques génétiques naturelles ;
- Perturbation du cycle biogéochimique ;
- Perte de l’agro-biodiversité traditionnelle en RDC ;
- Appauvrissement de la diversité de la forêt tropicale ;
- Perte d’une base-vie pour des populations autochtones ;
- Perte pour des opportunités culturelles, des connaissances issues de l’utilisation d’une biodiversité par les ethnies à travers le pays ;
- Appauvrissement des écosystèmes naturels et perte des services qu’ils rendent ;
- Réduction de l’approvisionnement en produits forestier non ligneux et protéines animales;
- Perte de l’habitat pour les espèces animales ;
- Perte de résilience face aux risques naturels ;
- Insécurité alimentaire ;
- Dépendance écologique ;
- Réduction de la capacité de séquestration de carbone et d’approvisionnement des services environnementaux ; et – perturbation de l’équilibre écosystémique.
La dégradation de la biodiversité induit des pertes des services écosystémiques qui
étaient naturellement rendus par les écosystèmes, ce qui se traduit par des coûts économiques largement non-comptabilisés et ignorés jusqu’ici en RDCongo. Il est essentiel de mettre désormais de la valeur sur la biodiversité et les services rendus par les écosystèmes afin de changer la tendance de perte vers la sauvegarde de la biodiversité.
Pour la décennie 2000-2010, la perte directe induite par la perte de services
écosystémiques était estimée à environ 50 milliards d’euros par an dans le monde entier. Mais des estimations portent à 7 % du PIB mondial les pertes cumulées en termes de bien-être d’ici à 2050. En RDCongo, il n’y a pas encore d’estimations sur la perte de la biodiversité et des services rendus par les écosystèmes. Mettre la valeur sur la biodiversité et les PES proviennent de l’hypothèse que donner un prix à la biodiversité, sur la base de méthodes partagées, devrait permettre d’encourager sa meilleure prise en compte comme « capital écologique », et aussi donner un coût négatif aux phénomènes de destruction et de surexploitation de milieux, de ressources et d’espèces vivantes.
La biodiversité et ses produits écosystémiques sont à priori et objectivement
inestimables. Et, comme elle n’a pas de prix, au sens économique du terme, certains économistes ont fait remarquer que des individus et groupes importants sont amenés à agir comme si elle n’avait pas alors de valeur. Les agents économiques tendent alors à ne pas prendre en compte la biodiversité dans leurs calculs, ou à la prendre en compte simplement de manière biaisée ou incomplète. C’est pourquoi certaines décisions politiques entrainent une mauvaise allocation des ressources avec un impact négatif sur le bien-être collectif et ce bien commun, à court, moyen ou très long terme.
Il s’avère important aujourd’hui d’intégrer les valeurs de la biodiversité dans la
comptabilité nationale. Cela pourrait commencer par le secteur du tourisme avec l’écotourisme.
Section 5 : Perspectives pour une gestion durable de la biodiversité et les écosystèmes en RDC
- Financer les recherches sur la gestion de la biodiversité et les écosystèmes ;
- Écologiser tous les congolais grâce à l’éducation relative à l’environnement et au développement durable ;
- Cartographier et sécuriser les zones de conservation :
- Limiter les pollutions ;
- Aménagement durable des écosystèmes
- Faire appliquer les lois sur l’aménagement et l’urbanisme ;
- Intégrer les riverains à la gestion des écosystèmes ;
- Créer un tribunal vert ;
- Développer l’écotourisme durable ;
- Éradiquer la pauvreté et la famine ;
- Financer les services et projets techniques des Ministères de l’environnement, du tourisme, de l’agriculture, la pêche et élevage, le développement rural, la recherche scientifique, l’aménagement du territoire, etc.
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
- AGEDUFOR, 2015. Présentation du Projet d’Appui à la gestion durable des forêts. MECNT, Kinshasa.
- Biodiversité en partage, documentaire de 54′ produit par AgroParisTech, réalisé par Jean-Hugues Berrou, https://www.dailymotion.com/video/x4zdvhg [archive]
- Bruno Fady et Frédéric Médail, Peut-on préserver la biodiversité ?, Paris, Le Pommier, coll. « Les Petites Pommes du savoir » (no 80), 2006, 64 p. (ISBN 2–7465–0272–0)
- Conseil économique social et environnemental (2011) La biodiversité : relever le défi sociétal ; rapport/avis produit à la suite d’une saisine gouvernementale par la section de l’environnement du CESE, avec comme
rapporteur Marc Blanc publié le : 09/06/2011 et adopté le : 09/06/2011 (Mandature : 2010-
2015) : Avis [archive], rapport [archive] et synthèse [archive]
- Cynthia Fleury et Anne-Caroline Prévot-Julliard (dir.), Le souci de la nature : apprendre, inventer, gouverner CNRS éditions, 2017, 378 p. (EAN 9782271088178)
- Cynthia Fleury et Anne-Caroline Prévot-Julliard, L’exigence de la réconciliation. Biodiversité et société, FayardMuseum national d’histoire naturelle, coll. Le temps des sciences, 2012, 471 p. (ISBN 978–2–213–66859–8)
- De Wasseige C., Devers D., De Marcken P., Eba’aAtyi R. &Mayaux P.-H., (2009) : Les forêts du bassin du Congo – Etat des forêts 2008. Office des publications de l’UE, 13 p.
- DIAF, 2015. Protocole méthodologique de l’évaluation du couvert forestier national de référence en République Démocratique du Congo. Document de travail. MECNT, Kinshasa. 34p.
- Institut Congolais pour la Conservation de la Nature, (2012) : Stratégie nationale de conservation de la biodiversité dans les aires protégées
- Institut Congolais pour la conservation de la nature, (2012) : Stratégie nationale pour la conservation communautaire
- Jean Dorst, Avant que nature meure, 2012 (1965), Delachaux et Niestlé, 544 p.
- Les Dossiers de La Recherche, « La Biodiversité : Les Menaces sur le Vivant », no 28, août-octobre 2007.
- Lise Barnéoud, La biodiversité ?, coll. « InfoGraphie », Éditions Belin, 2013, 80 p. (ISBN 978–2–7011–5692–7) Loi relative à la conservation de la nature (2014)
- Marco Fritz, Jorge Ventocilla, Heidi Wittmer, Ute Jacob, Didier Babin, Thomas Bobo, Nerea Aizpurua, Juliette Young, Marie Vandewalle et Allan Watt, Transformative change in the global post-2020 biodiversity framework: workshop report 23 25 26 June 2020, Publications Office of the European Union, 2020 (ISBN 978–92–76–214496, lire en ligne
- MECN-DD et UNITAR, (2006) : Profil National des Produits Chimiques de la République Démocratique du Congo, 110p.
- MECN-DD, (2006) : Programme d’Action National d’Adaptation aux changements climatiques, 96p.
- MECN-DD, (2011) : Programme National Environnement, Forêts, Eaux et Biodiversité 2ème génération, 129p.
- MECN-DD, (2014) : Cinquième rapport national sur la mise en œuvre de la Conservation sur la Diversité Biologique, 63p.
- MECN-DD, (2015) : Contribution Prévue Déterminée au niveau National, 12p.
- MECN-DD, (2015) : Rapport sur l’état de la mise en œuvre du Programme de travail de la CDB sur les Aires protégées
- MECN-DD, (2016) : Stratégie et plan d’action nationaux de la biodiversité,
- Michel Chauvet et Louis Olivier, La Biodiversité enjeu planétaire : Préserver notre patrimoine génétique, Paris, Sang de la Terre, coll. « Les dossiers de l’écologie », 1993, 413 p. (ISBN 2–86985–056–5)
- Natureparif, Entreprises, relevez le défi de la biodiversité, Victoires éditions, 2011, (ISBN 9–782–35113–086–5).
- Notre santé et la biodiversité, Serge Morand, Gilles Pipien, Ed. Buchet Chastel, 2013 (ISBN 978–2283–02657–1) Patrick Blandin, De la protection de la nature au pilotage de la biodiversité, Paris, Quae, coll. « Sciences en questions », 2009, 128 p. (ISBN 9782759203062, présentation en ligne [archive]).
- Philippe J. Dubois (2004) Vers l’ultime extinction ? La biodiversité en danger. Éditions La Martinière, Paris, 191 p.
- PNUD (2011) : Rapport sur le développement humain. La vraie richesse des nations: les chemins du développement humain, 260 p.
- PNUE, WCMC, World Atlas of Biodiversity, 2002 (ISBN 0–520–23668–8) [lire en ligne [archive]].
- Secrétariat de la Convention sur la Diversité Biologique, (2011) : Plan stratégique de la diversité biologique 2011-2020
- Simon A. Levin (coord.), Encyclopedia of Biodiversity, éd. Elsevier, 2007, (ISBN 978–0–12–226865–6).
- Verhegghen A., Defourny P., Earth and Life Institute (2010): Université catholique de Louvain, Louvain-laNeuve, Belgique SITES WEB CONSULTES http://www.afromoths.net/species/queryAjax http://www.congogreencitizen.org/index.php/biodiversite
[1] http://www.afromoths.net/species/queryAjax (consulté le 26 décembre 2015).
[2] BDA = Biotechnology for sustainabledevelopment in Africa (Biotechnologie pour le développement durable en
Afrique)
[3] The Alliance for Zero Extinction (AZE) has identified sites supporting the last remaining populations of one or more Endangered or Critically Endangered species (as listed on the IUCN Red List), thereby providing a tool to focus conservation efforts to prevent potential imminent global extinctions, consistent with Aichi Biodiversity Target 12. http://www.zeroextinction.org/; also see the database at http://www.birdlife.org/datazone/info/siteprotection
[4] http://www.dounia-risri.net/IMG/pdf/Dounia1_pp143-151.pdf
[5] La Troisième Communication nationale de la RD Congo à la Convention Cadre des Nations Unies sur le Changement
Climatique a été soumis en octobre 2014
[6] PNUE, 2011, Evaluation environementale post-conflit de la République Démocratique du Congo

 Naviguez vers congovirtuel
Naviguez vers congovirtuel Naviguez vers Kinkiesse
Naviguez vers Kinkiesse