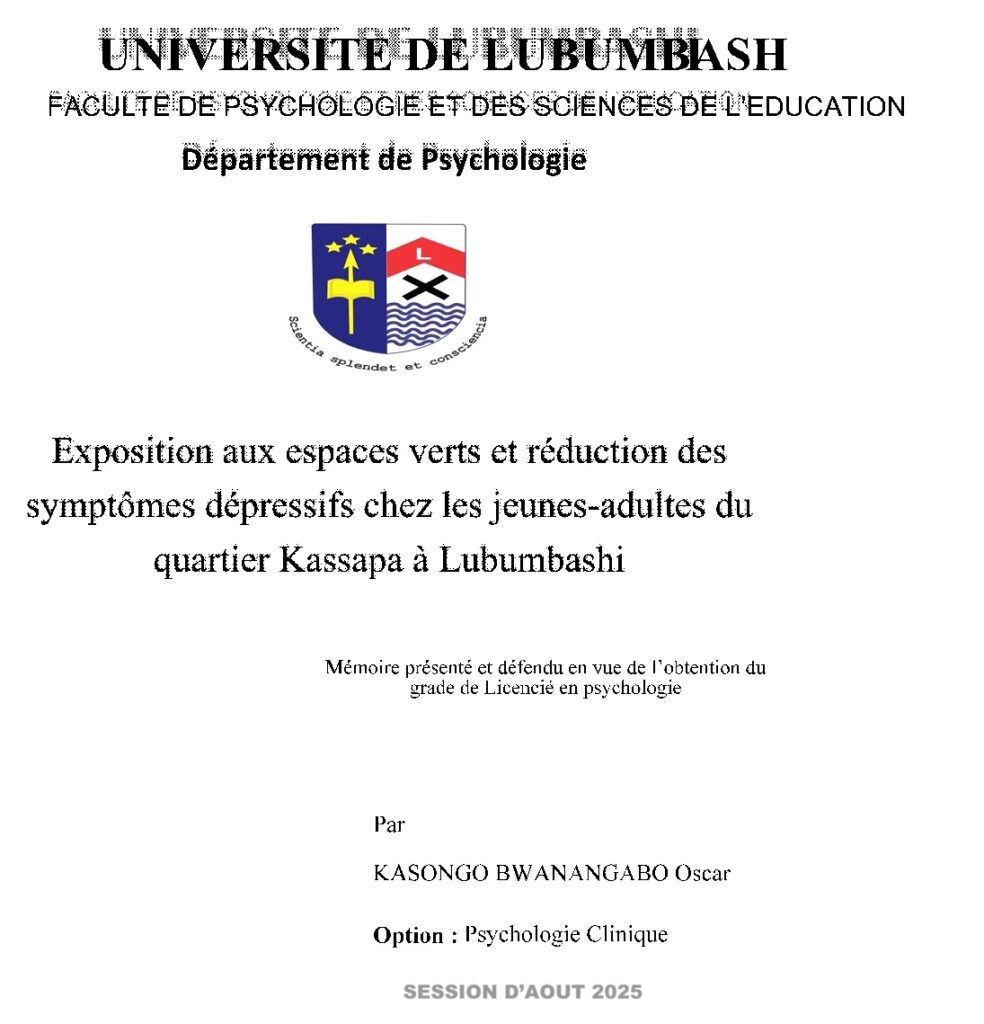
« Ce que l’on n’exprime pas par des mots, le corps le dit souvent par des maux ! »
La cause des enfants, François Dolto, 1985
DEDICACE
A ma chère famille : à mon PERE, mon Héro JOSEPH ILUNGA, à ma
MAMAN, mon Héroïne SIMONIE MWIKA WA MBAYO, A ma Future ravissante Epouse ANASTASIE MANDA ;
Je dédie ce travail !
![]() REMERCIEMENTS
REMERCIEMENTS
Nos remerciements premièrement s’adressent à l’être suprême le Dieu créateur du
monde entier et de l’univers, qui par son amour, sa bonté, sa grâce nous a gardé, protégé, doté de l’intelligence et sagesse à réaliser ce travail et à arriver au bout de celui-ci.
Nos remerciements s’adressent aussi au directeur de ce travail Monsieur le Professeur Ordinaire JEAN-PIERRE BIRANGUI qui par sa générosité nous a offert une taulerance, un amour, un accompagnement, un encadrement et plusieurs autres contributions scientifiques ou intellectuelles de la conception dudit travail à sa matérialisation de toutes les idées que renferment ce travail, que le bon Dieu vous comble de toutes sortes des grâces et des réussites, surtout qu’il vous garde, vous protège et combatte pour vous contre tout ennemi
!
Nous remercions également notre chère famille, famille de papa JOSEPH ILUNGA et maman MWIKA WA MBAYO, qui nous a soutenue financièrement, matériellement et spirituellement dans la réalisation de ce travail !
Nous remercions aussi, Monsieur POLYCARPE KUMWIMBA Kabongo, mon oncle qui a tant inspiré ma réflexion par ses capacités intellectuelles et surtout par son amour qu’il nous a prouvé de nous voir réussir, nous retenons de lui les ouvrages : » La themacitatologie », » la dissertation facile par la technique d’araignée à quatre pattes » merci pour tous, pour le soutient l’orque nous ne pouvions pas réussir à réaliser certains éléments du présent rapport, Puisse le très haut vous bénir !
Nous remercions également les habitants du quartier KASAPPA, principalement aux victimes de dépression qui ont contribué en acceptant de donner leurs points de vue et en faisant partie des sujets ciblés par cette investigation.
Nous remercions également le corps professoral de l’université de Lubumbashi en générale et en particulier à celui de la faculté de psychologie et des sciences de l’éducation, quant aux acquis ou connaissances qu’il nous a doté durant ce cursus académique.
Nous remercions également les amis camarades et collègues : HODARI MULISI CEDRICK Leader, MAYERIYE NGULUTOKO Esdras, MASAMBA KAHOZI Degaulle, ILONGA JEAN-Ndjodji, DALAKO NSILA jean-hortone, MWENZE KABUYA Elie, YAMA NDJAMBWIYA Faustin, SOBANUKA ESAU Edouard, MITANDA KANGANYI Mimi, AMINA EYAUDI Honorine, KAHODI WA KASONGO Pacifique étudiant en droit commercial université de Lubumbashi, Puisse le seigneur vous bénir dans toute votre vie et qu’il vous accorde sa grâce et sagesse, pour votre contribution et soutient dans l’élaboration de ce travail !
A toute personnes ayant contribuée d’une manière ou d’une autre dans le but de
réaliser ce travail, nous vous disons grand merci et que le seigneur vous bénisse et vous garde
!
![]() SIGLES ET ABREVIATIONS
SIGLES ET ABREVIATIONS
DSM V : Manuel Diagnostic et statistique des troubles mentaux
SORC : Stimulus ou simili, organisme, réactions, Conséquences
HDRS ou HAM-D : Echelle de dépression de Hamilton
A.C.P. : Approche centrée sur la personne
UNILU : Université de Lubumbashi
FPSE : Faculté de psychologie et des sciences de l’Education
La question portant sur les troubles maniaco-dépressifs qui affectent l’humeur des individus est de grande préoccupation aujourd’hui dans les domaines scientifiques, particulièrement en psychologie clinique.
Pour nous, dans une recherche scientifique, il est crucial de déterminer la question de départ dans le but d’y répondre, primordialement de manière hypothétique et deuxièmement par la confirmation ou infirmation des hypothèses départ les données mises en interprétation et analyses.
Mérin Mathew & Michelle Sabourin, J. soutiennent ceci : le terme problématique désigne une question ou un ensemble de questions qui se posent dans un contexte donné et qui nécessite d’être analysé ou résolu. Il est utilisé dans le cadre académique, scientifique ou littéraire pour structurer une réflexion ou un projet de recherche. La problématique sert à définir les enjeux d’un sujet, à cerner les limites de l’étude et à orienter la recherche ou l’analyse.[1]
Beauvais & Lemoine, L., la problématique est formulée à partir d’un état des lieux ou d’une observation et doit permettre de : [2]
- Clarifier les enjeux : Identifier ce qui est en jeu, les défis à relever ou les
questions en suspens.
- Orienter la recherche : Définir le cadre et les objectifs de l’étude.
- Structurer la réflexion : Aider à organiser les idées et les arguments de
manière cohérente.
Dans le présent travail, nous sommes partis des observations faites sur les jeunes adultes atteints de dépression par le trébuchement suppositoire hypothétique, et avons vu des réactions qui ont attiré notre attention ; il s’agit bien évidemment de :
La perte d’intérêt à exécuter des activités habituelles,
Le manque de confiance en soi,
L’apathie accompagnée d’une culpabilité
Les difficultés à se concentrer ;
Les pensées suicidaires
Cela nous a renvoyé à un questionnement de départ : « s’agira-t-il de la dépression ? » à cette question avons répondu en diagnostiquant de manière provisoire la dépression au travers les critères des diagnostics d’un trouble dépressif majeur ou de la dysthymie établit par le DSM V. Révisé :[3]
- Un épisode dépressif : La personne doit présenter une humeur
dépressive ou une perte d’intérêt ou de plaisir pendant la plupart de la journée, presque tous les jours, pendant au moins deux semaines.
- Symptômes associés : Au moins cinq des symptômes suivants doivent
être présents durant la même période, et au moins un des symptômes doit être soit l’humeur dépressive, soit la perte d’intérêt ou de plaisir. Les symptômes comprennent :
Humeur dépressive.
Diminution ou marque de l’intérêt ou du plaisir dans presque toutes les activités,
Perte ou gain de poids significatif (ou diminution ou augmentation de l’appétit),
Insomnie ou hypersomnie,
Fatigue ou perte d’énergie,
Sentiments de dévalorisation ou de culpabilité excessive,
Difficulté à penser, à se concentrer ou à prendre des décisions,
Pensées récurrentes de mort, idées suicidaires sans plan spécifique ou tentative de suicide.
3. Impact sur le fonctionnement : Les symptômes causent une détresse clinique
significative ou une altération du fonctionnement social, professionnel, ou dans d’autres domaines importants de la vie quotidienne.[4]
Ceci nous a renvoyé également à nous demander quelle serait la solution propice à ce problème de dépression ? Peut-on utiliser les espaces verts pour traiter ladite dépression ?
De manière systématique cela nous a renvoyé à une série des questions suivante :
Question 1. Quel est l’impact des espaces verts sur la réduction des
symptômes dépressifs ?
![]() Question 2. Faudra-t-il utiliser les espaces verts comme approche
Question 2. Faudra-t-il utiliser les espaces verts comme approche
thérapeutique en cas de dépression ?
C’est sur base de ces questions fondamentales que notre recherche a tenté de répondre, primordialement nous y avons répondu de manière provisoire que nous présentons dans les lignes qui suivent :
![]() 0.2. HYPOTHESES
0.2. HYPOTHESES
KAMBULU Nshimba dans son cours d’initiation à la recherche scientifique, définit le mot hypothèse comme étant : « une réponse provisoire à la question dans la problématique, elle peut être une réponse à une question posée. Elle est une réponse temporaire à la question posée de la recherche, en conformité avec la question de départ » voici ainsi de notre part, les hypothèses qui ont soutenu notre problématique :[5]
HYPOTHESE 1 : Les espaces verts auraient un impact positif sur la dépression en diminuant respectivement les symptômes suivants : la perte d’intérêt, la fatigue ou la perte d’énergie, l’insomnie, la culpabilité, le sentiment de dévalorisation, les difficultés à penser ou à prendre de décision, … brefs ils apporteront un bien être chez les victimes (une sérénité), la prise de courage.
HYPOTHESE 2 : L’utilisation des espaces verts en milieu clinique pourrait constituer une approche thérapeutique complémentaire, en synergie avec la thérapie cognitivo-comportementale, notamment par la technique de désensibilisation systématique.
0.3. OBJECTIFS DE L’ETUDE
Cette étude vise les objectifs suivants :
Identifier, Décrire et déterminer, l’impact qu’a les espaces verts sur la
réduction des symptômes dépressifs,
Approuver l’utilisation des espaces verts comme approche thérapeutique
en cas de dépression.
![]() 0.4. CHOIX ET INTERETS DE L’ETUDE
0.4. CHOIX ET INTERETS DE L’ETUDE
0.4.1. Choix de l’étude
Sachant qu’un sujet de recherche ne se choisit pas de manière aléatoire, mais suivant un ordre donné ; ce qui veut dire à partir d’un problème donné que l’on peut soit résoudre ou clarifier;[6] non seulement qu’à partir de cela, mais également des raisons particulières comme : la recherche d’une palliation aux différentes difficultés que traversent une population donnée et beaucoup d’autres facteurs qui entrent en jeux…que l’on ne peut, saurait décrire ici.
Ainsi donc, l’attention que nous avons tirée à ce thème portant sur l’exposition à des espaces verts et réduction des symptômes dépressifs chez les jeunes-Adultes du quartier
Kassapa à LUBUMBASHI n’est donc pas inutile mais plutôt importante et utile, car primordialement cette étude décrit, identifie et détermine l’impact qu’a les espaces verts chez les jeunes-adultes en situation dépressive ou encore en d’autres termes toute victime de dépression pourra avoir des solutions au travers des résultats qu’apportera en lumière notre investigation. Deuxièmement, c’est une thématique qui relève du domaine de formation auquel nous sommes définis à l’aide des méthodes scientifiques basées à pouvoir :
Secourir l’individu humain à surmonter les difficultés auxquelles il fait face,
Assister à sa souffrance, afin de proposer des directives ou de prises en charges
psychologiques qui visent principalement l’amélioration de son état anormal et même pathologique ou morbide sur le plan psychique, psychosocial que psychoaffectif.
Eu égard cela, en psychologie KASONGO BWANANGABO Oscar (2024) a mis en principe départ ses expériences ceci : « derrière une réaction, il y a une excitation »,[7] ce qui veut dire qu’à la présence d’une réaction, il y a également présence du stimulus qui veut dire ce qui pousse ou qui est à la base de ladite réaction, ainsi pour ce qui concerne le choix porté sur la si grande question de recherche qui met en évidence la thérapeutique des cas de dépression en termes d’impact d’exposition aux espaces verts, cela découle du constat fait chez différentes jeunes-adultes au sein de notre quartier qui départ quelques symptômes ou signes que l’on a pu observer en tant qu’étudiant et chercheur en psychologie qui nous renvoyaient hypothétiquement à penser à la dépression; et bien cela a suscité en nous une curiosité en ce qui concerne : l’identification concrète de la situation présente ou observée et quelle solution apporter audit problème, nous avions fait des séances d’exposition de manière masquée ce qui veut dire : l’on prenait aléatoirement un jeune-adulte en situation de démotivation de la vie et lui exposons sans qu’il ne s’en rende compte à un espace vert en termes de réconfort et bien l’on a observé au terme des séances masquées des changement du point vue motivation. Ceux-ci a en somme constitués les preuves du choix opérées sur cette thématique si grande et intéressante qui est actuellement préférence et sujet ou objet des questionnements dans le domaine de la recherche en générale et en particulier dans le domaine de la psychologie.
0.4.2. Intérêts du sujet
Cette étude a constitué ses intérêts en tripartie que voici : l’intérêt personnel, social et scientifique.
![]() 0.4.2.1. Intérêt personnel
0.4.2.1. Intérêt personnel
Nous avons voulu identifier au travers cette étude l’impact qu’a les espaces verts sur la réduction ou diminution des symptômes de la dépression chez les jeunes-adules et nous avons voulu y apporter d’autres stratégies psychologiques outre l’exposition aux espaces verts comme : le counseling psychologique, ou le soutien…, lesquelles une fois appliquées peuvent réduire encore plus les symptômes de la dépression.
![]() 0.4.2.2. Intérêt scientifique
0.4.2.2. Intérêt scientifique
Notre étude est pour les futurs chercheurs un manuel de référence afin d’accompagner ou même d’apporter des mesures psychologiques qui pourront aider les victimes des troubles maniacodépressifs et qui sont polarisés de manière permanente au pôle dépressif intense ou majeur afin de rétablir leur état qui affecte différents aspects de leur vie comme : l’état psychosocial, l’état familial voir même les aspects professionnels. Et cela leurs seront important, utile et nécessaire en se basant particulièrement sur les découvertes ou aux différents aspects qui n’ont pas été investigués dans cette étude.
![]() 0.4.2.3. Intérêt social
0.4.2.3. Intérêt social
Sachant que cette étude s’est intéressée aux victimes de la dépression, ces derniers auront des informations nécessaires quant aux mesures à prendre lors d’une manifestation permanente de de la dépression dans leur camp. Cette étude apporte également des informations nécessaires aux autorités politico-administratives et à la population entière de la ville de Lubumbashi en particulier à celle du quartier Kassapa sur les bienfaits des espaces verts des cas dépressifs, dans le but d’aménager et entretenir les espaces verts dans les milieux tant urbains que ruraux en raison de leur impact sur la réduction des symptômes de la dépression qui est un trouble qui affecte la majorité de la population départ ses causes diversifiées dans la vie quotidienne de chaque être humain.
Une recherche, est scientifique ; lorsqu’il y a la présence d’une ou de plusieurs méthodes, c’est la raison pour laquelle KAMBULU Nshimba (2022) ne pouvait dire : « pas de méthode, pas de scientificité »[8] de ce fait, en ce qui concerne la méthode de recherche pour cette étude, elle s’est servi de l’approche descriptive, particulièrement sur les méthodes : la d’étude des cas et de la méthode clinique.
Nous avons recouru à ces méthodes parce qu’elles nous ont permis d’étudier de manière approfondie les cas concernés par cette recherche en faisant en revanche usage d’une diversité des techniques, lesquelles sont décrites de manière claire et précise dans les lignes qui suivent.
Pour nous, la méthode se fait découvrir que par l’emploi des techniques, ainsi
donc pour cette étude ; nous nous sommes servis de la méthode clinique et de la méthode d’étude des cas. Pour ce qui est des techniques utilisées, voici quelques techniques que nous avons employées durant notre recherche.
Nous avons utilisé la technique du questionnaire, l’entretient directif, non directif et semi directif, l’observation clinique basée sur : (observation participante et l’observation armée), l’analyse de contenus, la technique documentaire, les échelles de mesure ou d’évaluations de dépression, les sites internet ; ainsi que l’analyses fonctionnelle SORC.
Nous avons recouru à ces techniques parce que les dites techniques en psychologie permettent de produire, de dépouiller et de traiter les données, c’est surtout le veut de pouvoir identifier l’impact des espaces verts sur la réduction des symptômes dépressifs chez les jeunes adultes. Ces techniques nous ont donné libre accès aux informations nécessaires qui ont permis l’élaboration claire et nette du présent rapport de recherche.
0.6. DELIMITATION DE L’ETUDE
Pour KAMBULU NSHIMBA, toute recherche scientifique doit être située dans le temps, dans l’espace et dans le domaine scientifique;[9] ainsi notre travail n’est allé à l’encontre de cette réalité ou aspect que nous l’avons décrit et délimité temporellement, spatialement et nous y avons annexé sans porter en ignorance l’aspect déterminatif du cadre limitant le type de recherche menée, que nous présentons ici en termes de variétés ou typologie des recherches scientifique.
![]() 0.6.1. Délimitation temporelle
0.6.1. Délimitation temporelle
Le présent travail s’est effectué de la période allant du mois de Mars au mois d’août 2025, ce moment était porté en choix du simple fait qu’il nous a permis à bien produire, dépouiller et traiter les données de manière claire suivant certaines exigences et règles scientifiques qui relèvent de notre domaine de formation (la psychologie clinique)
![]() 0.6.2. Délimitation spatiale
0.6.2. Délimitation spatiale
C’est avec intérêt que notre travail porte sur des préoccupations voulant déterminer et identifier en décrivant les effets ou impacts positifs des espaces verts sur les symptômes dépressifs des certains jeunes adultes, c’est ainsi que cette étude s’est basée dans la commune ANNEXE de la ville de LUBUMBASHI (province du haut Katanga) en particulier dans le quartier KASSAPA, avec comme cible les jeunes adultes victimes d’au moins d’un trouble de l’humeur pour dire simplement de la dépression.
![]() 0.6.3. Délimitation Typologique
0.6.3. Délimitation Typologique
Notre étude s’inscrit dans le domaine de la psychopathologie qui s’occupe de la description de troubles mentaux et des troubles de l’humeur (particulièrement au trouble maniaco-dépressif). Nous nous sommes occupés principalement dans cette étude de la dépression, qui est manifeste chez la plupart des jeunes-adultes.
![]() 0.7. STRUCTURE DU TRAVAIL
0.7. STRUCTURE DU TRAVAIL
Pour tout travail scientifique, le chercheur est appelé à structurer son travail en
différentes parties ou en chapitres; dans le but de permettre la compréhension de son déroulement suivi de son élaboration. Pour se faire, nous avons trois chapitres en ce qui concerne ce travail ; elles sont décrites dans les lignes qui suivent. Hormis l’introduction et la conclusion, nous avons :
Le chapitre premier qui porte sur les considérations théoriques, il renferme : les définitions des concepts clés ou principaux de notre thématique, les théories qui l’explique en se focalisant sur celles qui vont dans le même ordre d’idées avec les espaces verts ou la nature et en fin de compte nous avons les études antérieures pour dire les études ayant été menées avant la nôtre et lesquelles ont souligné ou basé leur problématique sur la même thématique. Le deuxième chapitre quant à lui, il porte sur les cadres méthodologiques, il décrit le champ d’investigation, la population et l’échantillon de la recherche, les méthodes et les techniques, la présentation des variables et leurs indicateurs, ainsi que les difficultés rencontrées durant notre investigation.
En fin, le troisième chapitre est consacré aux résultats de la recherche. Nous présentons, analysons ; interprétons et discutons les résultats obtenus lors des entretiens et des séances d’expositions y compris en suite, la contribution scientifique de l’étude.
CHAPITRE PREMIER
![]() CONSIDERATIONS THEORIQUES
CONSIDERATIONS THEORIQUES
Dans cette partie, nous définissons les concepts principaux de notre thématique, nous décrivons les théories explicatives, nous présentons les généralités sur les états dépressifs et nous la mettons finish par quelques études antérieures.
Pour Carl Hempel : « la définition des concepts semble être la méthode la plus naturelle et peut-être la seule adéquate pour caractériser un concept scientifique.[10]
Jean-Pierre Aistolf and Call, disent que : un concept scientifique est capable de remplir une fonction opératoire : fonction de discrimination ou fonction de jugement, dans l’interprétation de certaines observations ou expériences. C’est un outil permettant d’appréhender efficacement la réalité. C’est un instrument de théorie pour l’interprétation des phénomènes.[11]
Pour DURKHEIM, la définition des concepts permet d’éviter toutes ambigüités sémantiques des termes utilisés.
En effet pour nous : la définition des concepts est une étape capitale ou nécessaire et indispensable dans les travaux scientifiques, car elle permet de fil de compréhension ou de déterminants cibles du travail, elle permet à éclairer l’occupation majeure ou le pourquoi d’un travail scientifique. Ainsi le présent travail débouche sur les concepts que voici : Exposition, Espaces verts, Réduction, Symptômes, Dépressif, Jeunes-adultes.
![]() 1.1.1. Exposition
1.1.1. Exposition
Selon le Dictionnaire de l’Académie Française 6ème Edition (1835) c’est l’action par laquelle une chose est exposée.
Selon le Dictionnaire le robert sur Dicoenligne.com cela veut dire : action d’exposer. Et ce dernier veut dire : disposer pour soumettre à une action, à une influence.
Ex : exposer une substance à des radiations.
Pour ce qui est de notre part : exposition signifie soumettre un sujet à un stimulus pour voir ses effets. Ex : Exposer un jeune adulte en souffrance de dépression aux espacesverts dans le but d’observer ses effets sur la réduction de ses symptômes.
![]() 1.1.2. Espaces-verts
1.1.2. Espaces-verts
Selon Philippe Clergeau, les espaces verts sont « des lieux végétalisés de
différentes tailles et formes qui participent à la biodiversité urbaine et offrent des services écologiques tels que la régulation climatique, la filtration de l’air et la gestion des eaux pluviales.[12]
Alain Roger, les définit comme étant des « territoires de nature insérés dans la
trame urbaine, contribuant à l’embellissement du cadre de vie et au bienêtre des citadins »[13]
Pour ce qui nous concerne, espaces verts veut dire, un endroit calme formé de
flore qui sert de : détente, relaxation dans le but d’y tenir exposé et réduire les symptômes d’un cas de dépression.
![]() 1.1.3. Réduction
1.1.3. Réduction
Selon le Larousse : La réduction est l’action de diminuer, de réduire ou de se réduire, aboutissant à une diminution de valeur, de nombre, de quantité ou d’importance.[14]
Réduction pour nous veut dire : l’acte qui consiste à rendre moins fréquente ou plus petite ou moins élevée la manifestation d’un comportement en termes de fréquence plus élevée. Dans cette étude il s’agit de rendre moins élevée la fréquence des symptômes de dépression au travers l’exposition aux espaces verts.
![]() 1.1.4. Symptômes
1.1.4. Symptômes
Selon le Robert, le mot symptôme(e) veut dire : phénomène, caractère perceptible ou observable lié à un état, à une maladie qui permet de déceler, ce dont elle a comme signe.
Selon les auteurs sur https://www.cancer.gov/publications/dictionaries/cancerterms/def/symptom cela veut dire ressenti vécu par une personne et pouvant indiquer une maladie ou un trouble.
Pour ce qui nous concerne, le terme symptôme renvoi aux critères indicateurs de la présence d’une maladie ou d’un trouble. Il s’agit bien évidemment pour cette recherche des critères indicateurs de la présence du trouble dépressif.
![]() 1.1.5. Dépressifs
1.1.5. Dépressifs
Selon la théorie psychanalytique, cela veut dire une personne en état de dépression, ce qui signifie : un état pathologique de souffrance psychique consciente et de culpabilité, accompagné d’une réduction des valeurs personnelles et d’une diminution de l’activité psychomotrice et organique.[15]
Selon le Larousse, c’est ce qui présente les caractéristiques d’une dépression.
Ex : une phase dépressive ou un état dépressif.
Pour ce qui nous concerne : le mot dépressif renvoi à l’état d’une personne atteinte d’un trouble de l’humeur qui est la dépression. Dans le cadre de ce cours, il s’agit des jeunes adultes atteints de dépression qui découle des plusieurs causes comme : la perte des objets ou d’un être cher, les déceptions amoureuses…
![]() 1.1.6. Jeunes-Adultes
1.1.6. Jeunes-Adultes
Selon VINCENZO Cicchellie and all (2001) souligne que ; l’expression des jeune-adulte associe deux termes apparemment contradictoires, reflétant la complexité de cette phase de vie où les individus naviguent entre la dépendance prolongée et aspiration à l’Independence.[16]
Selon nous, jeune-adulte veut dire un être humain de sexe soit masculin ou féminin qui est entre la phase d’immaturité vers celle de maturité et qui est victime de la dépression.
![]() 1.2. LES GENERALITES SUR LE TROUBLE DEPRESSIF
1.2. LES GENERALITES SUR LE TROUBLE DEPRESSIF
« La dépression se manifeste par une humeur triste, une perte d’intérêt pour toute activité et une baisse de l’énergie. Les autres symptômes sont : une diminution de l’estime de soi et de la confiance en soi, une culpabilité injustifiée, des idées de mort et de suicide, des difficultés à se concentrer, des troubles du sommeil et une perte d’appétit. La dépression peut aussi s’accompagner de symptômes somatiques.»[17]
Ces troubles ont des conséquences sur la vie affective, familiale, professionnelle et sociale. A la différence du « coup de blues », ou de la « déprime », dans la dépression l’humeur et le mal-être varient peu d’un jour à l’autre ou selon les évènements de vie. En France, la prévalence annuelle des épisodes dépressifs est estimée à 8 % chez les 18-75 ans. Les femmes sont deux fois plus touchées que les hommes. Le risque suicidaire est fortement associé aux troubles dépressifs : 15 à 20 % des personnes dépressives chroniques mettent fin à leurs jours.[18]
1.2.1. Classification des troubles psychiques19
A l’heure actuelle, deux classifications internationales des diagnostics psychiatriques sont utilisées :
- Classification internationale des maladies de l’Organisation Mondiale de la santé, dixième version (CIM-10),
- Diagnostic Statistical Manual, cinquième version (DSM-V), développé par l’Association américaine de psychiatrie.
Elles proposent une description clinique de syndromes (ensemble de symptômes) mais ne tiennent pas compte de l’origine des symptômes, ni de la personnalité qui les accompagne.
1.2.2. Symptômes de troubles dépressifs[19]
Les symptômes majeurs sont les suivants :
- Humeur dépressive, tristesse, perte d’intérêt ; fatigue ou perte d’énergie ; trouble
de l’appétit (avec perte ou prise de poids) ; troubles du sommeil (perte ou augmentation) ; ralentissement ou agitation psychomotrice ;
- Sentiment d’infériorité, perte de l’estime de soi; sentiment de culpabilité inappropriée; difficultés de concentration; idées noires, pensées de mort, comportement suicidaire.
1.2.3. L’origine des dépressions[20]
On situe l’origine de la dépression dans des expériences infantiles de perte, de souffrance et d’échec. Il existe une vulnérabilité génétique : une personne dont le parent de premier degré est atteint à 10 fois plus de risque de développer un trouble bipolaire. Les évènements de vie (divorce, séparation, problèmes professionnels ou financiers…) et les stress répétés (surmenage, manque de sommeil, perturbation des rythmes sociaux et biologiques), sont des facteurs précipitants. Mais leurs effets dépendent aussi de facteurs complexes, psychologiques et biologiques.
Le modèle théorique actuel est biopsychosocial, avec interactions complexes entre vulnérabilité génétique, modifications des systèmes de régulation du stress et influences environnementales.
Développée par Stéphanie Kaplan et Rachelle Kaplan (1989), cette théorie
suggère que les environnements naturels aident à restaurer les ressources attentionnelles épuisées. La vie moderne impose une forte demande cognitive, notamment chez les jeunes adultes soumis à des études, au travail ou aux réseaux sociaux. L’exposition aux espaces verts offre une « fascination douce » (soft fascination), qui permet au cerveau de récupérer son effort cognitif actif.[21]
En réduisant la fatigue mentale, la nature améliore l’humeur et diminue les
symptômes dépressifs (S et R. Kaplan, 1995).[22]
Une étude de Berman et al. (2008) a montré que les individus qui marchaient
dans un parc avaient une meilleure capacité attentionnelle et un bien-être accru par rapport à ceux qui marchaient en milieu urbain.[23]
1.2.2. La théorie de la réduction du stress (Stress Reduction Theory – SRT)
Ulrich (1991) propose que la nature a un effet physiologique direct sur la
réduction du stress. Selon cette théorie, l’exposition aux espaces verts active des mécanismes de relaxation automatique et réduit la production de cortisol, hormone du stress.[24]
Une diminution du stress contribue à une baisse des symptômes anxieux et
dépressifs (Ulrich et al., 1991).[25]
Une étude de van den Berg et al. (2010) a montré que les personnes vivant à
proximité d’espaces verts avaient un niveau de stress perçu plus bas et un risque moindre de troubles anxio-dépressifs.
1.2.3. La théorie de la biophilie
Wilson a introduit le concept de biophilie, qui postule que les humains ont une
affinité innée pour la nature, héritée de l’évolution. Cette connexion instinctive aux environnements naturels favorise le bien-être psychologique.[26]
Le contact avec la nature stimule des émotions positives et réduit les pensées
négatives répétitives, un facteur clé dans la dépression (Kellert & Wilson, 1993).[27]
L’étude de Mayer et al. (2009) a montré que le sentiment de connexion à la nature
était associé à une diminution du stress et à une meilleure satisfaction de vie.[28]
1.2.4. La théorie de la cohésion sociale
Les espaces verts favorisent les interactions sociales et renforcent le sentiment de
communauté, ce qui joue un rôle clé dans la prévention de la dépression (Kuo & Sullivan, 2001).30
Un accès facil aux espaces verts est associé à une augmentation des interactions
sociales positives, réduisant ainsi l’isolement social, un facteur de risque majeur de la dépression (Maas et al., 2009).[29]
Une étude longitudinale a montré que les jeunes adultes vivant près d’espaces
verts développaient un meilleur réseau de soutien social, facteur protecteur contre la dépression (Sugiyama et al., 2008).[30]
1.2.5. La théorie de l’activité physique et de la régulation émotionnelle
Les espaces verts encouragent l’activité physique, qui joue un rôle fondamental
dans la régulation de l’humeur et la prévention de la dépression (Pretty et al., 2005).[31]
L’exercice en milieu naturel (« green exercise ») améliore davantage la santé
mentale que l’exercice en intérieur, en augmentant les endorphines et en réduisant le stress (Thompson Coon et al., 2011).[32]
Une méta-analyse a montré que les jeunes adultes qui pratiquent une activité
physique régulière dans des environnements naturels présentent des niveaux plus bas de dépression et d’anxiété (Barton & Pretty, 2010).[33]
![]() 1.4. ETUDES ANTERIEURES
1.4. ETUDES ANTERIEURES
Etant donné qu’Il y a des études qui ont été menées portant sur la même
thématique, voici quelques études qui nous ont précédées et dont les résultats enrichissent la nôtre et nous ont été bénéfiques en termes des comparaisons dans le but de ne presque pas redire ou tomber dans une répétition scientifique. Il s’agit des études suivantes :
Kaplan Rachelle et Kaplan Stéphane (1989) dans leur étude portant sur expe-
rince of nature : psychological perspective, ils ont utilisé une triangulation des méthodes qui repose sur une approche psychologique et environnementale, combinant des méthodes qualitatives et quantitatives. Elles ont utilisé des enquêtes et des observations pour évaluer comment les individus réagissent à différents environnements naturels. Les participants ont été exposés à des paysages variés, et leur réaction émotionnelle a été mesurée à travers des questionnaires. Ils avaient comme objectif principal de l’étude : d’explorer les effets psychologiques de l’exposition à la nature sur le bien-être des individus, en particulier comment ces environnements peuvent réduire le stress et améliorer la santé mentale. Ils sont arrivés aux résultats selon lesquels : l’exposition à des environnements naturels a des effets positifs sur le bien-être psychologique, notamment une réduction des symptômes de stress et de dépression. Les participants rapportaient des sentiments de calme, de sérénité et d’amélioration de leur humeur après avoir passé du temps dans des environnements naturels. L’étude a conclu que ces expériences naturelles sont cruciales pour la santé mentale, soutenant l’idée que la nature joue un rôle essentiel dans la restauration psychologique.[34]
Ulrich, R. (1983) dans son étude portant sur : Aesthetic and affective response
to natural environnements, par le trébuchement de l’approche expérimentale pour examiner l’impact des environnements naturels sur le bienêtre émotionnel, il s’est servi également des évaluations subjectives, en demandant aux patients de décrire leurs émotions et leurs niveaux de stress. Les mesures physiologiques, telles que la fréquence cardiaque et la pression artérielle, ont été prises pour quantifier les effets physiologiques de l’exposition à différents types de paysages. Dans cette étude, l’objectif principal était d’explorer comment l’exposition à des environnements naturels (comme des arbres et des paysages verdoyants) pourrait influencer la santé mentale des individus, en particulier en réduisant le stress et en améliorant l’humeur. Il est arrivé aux résultats selon lesquels les patients ayant une vue sur des paysages naturels présentaient des niveaux de stress significativement plus bas et des améliorations de leur humeur par rapport à ceux ayant une vue sur des environnements urbains. Ulrich a conclu que les environnements naturels peuvent avoir des effets restaurateurs sur le bien-être psychologique, contribuant ainsi à des résultats de santé plus positifs.[35]
JULIE EMOND (AOUT 2017) dans son mémoire de maitrise présenté à l’uni-
versité du QUEBEC A MONTREAL portant sur « les espaces verts urbains et leur contribution à l‘amélioration de la qualité de vie des résidents de la petite-patrie » l’objectif principale de cette étude était de mettre en lumière les bénéfices des espaces verts sur la qualité de vie des résidents du quartier la Petite-Patrie, dans le but de pouvoir mieux aménager ces espaces verts pour répondre aux besoins de la population du quartier. En utilisant les méthodes : enquête psychosociale, les observations, les tests statistiques appuyées par les questionnaires et entretiens, elle est arrivée aux résultats que voici et nous citons :[36]
« Les bénéfices de la végétation ou des espaces verts en ville sont nombreux (par exemple pour purifier 1’air, apaiser 1’esprit ou agir comme oasis de fraîcheur), en somme, nous concevons qu’un espace vert aménagé de manière conviviale, sécuritaire et dont la morphologie incite à des pratiques spatiales diversifiées et simultanées, encourage davantage les résidents à y accéder. Tel que nous 1’avons rappelé, la fréquentation des espaces verts a de nombreux bénéfices sur la qualité de vie des gens, notamment pour l’atténuation des effets des îlots de chaleur urbains, la diminution du stress et l’augmentation des opportunités d ‘activité physique. »[37]
Sandrine MANUSSET Décembre 2012 dans son article qui porte sur « Im-
pacts psychosociaux des espaces verts dans les espaces urbains » les objectifs étaient : apporter des arguments scientifiques acquises à : plus de nature en ville ; appréhender la globalité du bienfait du végétal sur l’homme à la fois dans son individualité et dans son espèce sociale ; identifier des personnes ressources. Elle a procédé depuis 2010 ces études en collaboration avec Val’hor, l’UNEP, l’IDDR et Agro campus aux analyses de contenus, aux méthodes d’enquête et des méthodes documentaires ou analyse et synthèse bibliographique dans différents domaines d’une part en : santé publique, écologie, urbanisme, sociologie et d’autre part en psychologie, cela étaient réalisé à l’échelle internationale tendant à faire un état des lieux des connaissances scientifiques acquises sur les impacts positifs du végétal en ville.
Cela leurs ramènent aux résultats que voici, nous citons :
« Les impacts psychosociaux que nous retenons de notre étude sont au nombre de trois : ils répondent à la très forte attente de nature des habitants, les espaces verts se révèlent porteurs des dynamiques sociales qui permettent de soutenir la cohésion sociale d’un quartier ; ce qui renvoient finalement à la relation cognitive que chacun de nous entretient avec le végétal et qui est une source fondamentale de santé mentale et donc de bien-être. »[38],
« S’appuyant sur l’exploitation de bases de données de santé publique, Maas (2008) cité par Sandrine MANUSSET a démontré que les taux de dépression sont 1,33 fois supérieurs dans les zones avec peu d’espaces naturels. Selon la même étude, les habitants en présence d’espaces naturels dans un rayon d’un kilomètre autour de leur habitation se sentent plus en forme et ont moins d’épisodes morbides. »41
Depuis les années 80, des praticiens reconnaissent et utilisent cet effet des plantes sur l’homme, à titre thérapeutique. Aux États-Unis, les travaux de Roger Ulrich (1983, 2002) cité par Sandrine MANUSSET en 2012 sont une référence notoire sur l’effet thérapeutique des jardins dans les hôpitaux et les prisons par l’effet relaxant du végétal sur les patients qui à la fois supportent mieux les Impacts psycho-sociaux des espaces verts dans les espaces urbains, le développement durable et territoires, traitements et présentent un état mental plus favorable conduisant à une accélération de la convalescence.[39]
En France, L’ethnologue Anne Monjaret (2010) a étudié le rôle des végétaux dans les hôpitaux parisiens sous un aspect thérapeutique et de moyen d’accompagner la convalescence des malades, qu’au maintien de la cohésion des équipes médicales.[40]
Partant de l’aspect comparatif des études ci-dessus, d’une part l’aspect ressemblance : de la première étude à la dernière, les chercheurs se sont basé sur la nature et ses effets, y compris notre étude. D’autre part l’aspect dissemblance, ce que notre étude s’est sur quoi basée, il s’agit des symptômes dépressifs qui ont comme thérapie les espaces verts, non seulement mais aussi la cible d’étude qui est les jeunes adultes ce qui n’est pas nécessairement le cas des autres études.
DEUXIEME CHAPITRE
![]() CADRE METHODOLOGIQUE
CADRE METHODOLOGIQUE
Etant donné que dans cette étape qu’il est impérativement demandé au chercheur de décrire le champ d’investigation, la population, l’échantillon de la recherche, les méthodes et les techniques ; en fin de compte les difficultés auxquelles va-t-il faire face durant son investigation, voyons donc dans la présente partie les différentes informations ou contenus des points énumérés peu dessus.
![]() 2.1. PRESENTATION DU CADRE DE RECHERCHE
2.1. PRESENTATION DU CADRE DE RECHERCHE
2.1.1. Présentation du champ d’investigation
Notre étude ou notre recherche s’est menée dans le quartier Kassapa chez deux cas victimes de dépression habitants dudit quartier. Voici sa description. Nous soulignons également avant cela que nous nous sommes référé aux informations que rapportent le rapport scientifique de GABRIELLA MWAYUMBA Zaidi (2021), voici ce que nous relate l’auteur à propos du quartier Kassapa de la province du haut-Katanga.
2.1.2. Situation Géographique
Le quartier Kassapa est situé dans la province du haut-Katanga, commune Annexe. Le quartier Kassapa Géographiquement, est limité :
Au Nord par la prison Kassapa
A l’Est par la cellule Nema
A l’Ouest par la ligne Haute tension et Au sud par la cellule kamisepe.
2.1.3. Aperçu Historique
En 1960 avec la succession de Moïse THOMBE le quartier Kassapa devient une école provinciale de la police. En 1967 MOBUTU décida la réunification de la police et créa la police nationale Zaïroise à KAMATETE et Lubumbashi pour la formation de commandant de la police qui avait pour la durée de formation vingt-quatre mois ou deux ans mais réduit jusqu’à six mois. En 1972, il y a eu création de la gendarmerie nationale qui deviendra le centre d’instruction. A l’événement de Mzée Laurent Désiré KABILA cela devient un centre d’instruction de la Kassapa pour apprendre aux policiers comment lutter contre les ennemis suivant les ordres donnés. Le centre Kassapa dépend administrativement de Kinshasa. En ce qui concerne la décision du travail, ils sont repartis de la manière suivante :
Il y a le chef de poste P1, P2 officié de renseignement, P3 officié d’organisation, P4 officié de logistiques, P5 officier chargé de relation publique, P6 officier chargé de finance et le service de la santé ». En outre, dans le même quartier, il y a une répartition du quartier selon les appellations suivantes :
Q1 : pour les policiers
Q2 : pour les gendarmes
Q3 : pour les G.S.P.
IL y a encore la cellule de NEEMA et de KAMISEPE qui sont toujours dans le quartier. Ils sont prédominés par la loi militaire, c’est-à-dire celui qui cherche aller à l’encontre de la loi, c’est la même loi qui va l’indiquer.
2.1.4. Situation socio-économique
![]() Situation éducationnelle
Situation éducationnelle
Sur le plan éducationnel, dans ce quartier il y a une école publique de Vodacom et beaucoup des écoles privées comme Christ novic, complexe Pax, etc. malgré ces écoles nous constatons que dans ce quartier il y a une analphabétisation des enfants dû aux irrégularités des salaires de soldats.
![]() Situation sanitaire
Situation sanitaire
Sur le plan sanitaire, nous venons de constater que dans notre lieu d’investigation il y a des hôpitaux et plusieurs centres de santé comme : centre police, Luna, Hayerafa, CTB et le centre FARDC. Le centre FARDC se trouve dans le camp Etat-major. Ce centre n’a pas de fourniture sanitaire et puis dans ce contre les agents ne respectent pas les mesures d’hygiène ni de nettoyage par manque de matériel.
2.1.5. Situation socio-culturelle
Du point de vue culturelle, nous dirons que le quartier Kassapa est dominé par les agriculteurs quoi qu’on en trouve les fonctionnaires de l’Etat et ceux qui exercent les activités libérales en une moindre teneur et un peu des étudiants. Dans ce quartier nous trouvons trois marchés qui sont : marché Moise, Kasonko et Ruta, dans ce marché les marchandises sont étalées même sur le sol à côté de la route et des circulations des mouches sur les différentes marchandises comme la viande, les poissons salés, les chinchards, etc. Ceci explique que la majorité des marchands ne respectent pas les mesures d’hygiène alimentaire.
Nous voyons l’ensemble des animaux d’une région quelconque ou d’un pays, qui renferme ce milieu, les animaux domestique (les chèvres, les boucs, les cochons ; les lapins, les chiens, les chats…) les oiseaux domestique (les poules, les canards, les pigeons…)
Dans ce quartier nous retrouvons les plantes fruitières telles que : les manguiers, les citronniers, les avocatiers, mais aussi c’est une agglomération qui est dominée par la culture maraîchère de choux, des amarantes, des gombos etc. En dépit de ce qui vient d’être cité, nous remarquons beaucoup des termitières qui servent à la fabrication des briques qui aident la population à ériger leurs maisons. Ce quartier se situe dans une végétation que nous appelons la savane herbeuse qui contient des petits arbres et des termitières qui aident la population à la fabrication des briques, pour l’usage de construction, les arbres sont utilisés à la fabrication des braises localement appelés Makala. De notre part, nous épousons la pensée de François Malaise, qui prône sur « le Shaba (actuellement appelé Haut-Katanga) n’est pas proprement parler une région à vocation agricole. En effet, sa vocation première de l’époque coloniale consistait dans des activités minières comme le consacre les appellations locales « capitale du Cuivre » pour l’actuelle ville Lubumbashi ou encore de scandale Géologique pour les territoires de l’ancienne province du Katanga concédés à l’Union minière du Haut-Katanga
».
Nous voyons qu’aujourd’hui avec la chute de la Gécamines, cela a entraîné une crise totale au sein de la population qui peut toutefois chercher à exploiter la végétation par les travaux agricoles pour le maintien d’équilibre dans leur foyer. L’espace urbain Kasapa se trouve dans le climat tempéré qui varie entre deux saisons qui se présentent comme suites : la saison sèche et la saison pluvieuse. Il sied de signaler que la saison sèche a une durée de six à sept mois, cela permettra aux gens de façonner les briques pour leurs constructions et favoriser un bon achèvement de construction des maisons pour ceux qui en déclenchent. En fin, la saison pluvieuse, compte au moins cinq à six mois de continuité. C’est-à-dire du début du mois de Novembre jusqu’à la fin du mois de Mars, cela est une occasion aux agriculteurs de pouvoir cultiver les champs et d’espérer à un rendement selon la quantité et la qualité de grains semés et en plus de cela sans oublier la grandeur du champ qu’il a eu à faire.
2.1.6. Organigramme du quartier Kassapa
C’est sur base de comment fonctionne les dirigeants ou les autorités politico administratives du quartier Kassapa que nous établissons cette hiérarchisation qui n’est rien d’autre qu’une présentation de ce que le chef du quartier en son autorité nous a livré comme information sur base de la question de comment est dirigé et comment fonctionne le quartier Kassapa sur l’aspect de la gérance ou de la structuration des autorités du dit quartier, voici une représentativité ou représentation de ce que regorge la hiérarchisation du quartier Kassapa.
SOURCE : Direction Générale du Chef de Quartier Titulaire
2.2. POPULATION ET ECHANTILLON DE RECHERCHE
En ce qui concerne la population de recherche, sachant scientifiquement qu’une étude ne peut se faire à son insu, nous disons à titre définitionnel qu’une population de recherche est un ensemble d’individu ayant les mêmes manières d’êtres, des vivres et même de faire ou encore voir les mêmes caractéristiques sur lesquels le chercheur veut tirer des conclusions. Et bien cela peut s’étendre en se basant engament sur la même situation géographique.
Dans le cadre de cette étude de cas en psychologie clinique, la population de recherche cible l’ensemble des jeunes adultes âgés de 18 à 30 ans présentant des symptômes dépressifs légers à modérés. Cette population a été définie en fonction de critères cliniques et développementaux spécifiques, en cohérence avec la littérature actuelle sur la santé mentale et les facteurs environnementaux de protection chez les jeunes.
Les jeunes adultes représentent une tranche d’âge particulièrement vulnérable au développement de troubles dépressifs, en raison de transitions psychosociales majeures (études, entrée dans la vie professionnelle, autonomie).
La présente étude repose sur l’analyse approfondie de deux cas cliniques, sélectionnés parmi cette population cible. Les participants sont deux jeunes adultes habitants du quartier kassapa en proie des troubles dépressifs, et ayant accepté de participer à un protocole thérapeutique incluant une exposition en une période de plus ou moins deux mois encadrés, accompagnés en leurs exposant à des environnements naturels urbains, combinée à un suivi psychothérapeutique standard.
Cette approche qualitative et exploratoire vise à comprendre en profondeur comment et dans quelles conditions l’exposition à la nature influence l’évolution des symptômes dépressifs, en tenant compte du vécu subjectif des patients et du contexte clinique.
2.3. METHODES ET TECHNIQUES
Une recherche s’avère scientifique qu’à l’utilisation d’une ou plusieurs méthodes
lesquelles sont matérialisées par la présence d’une ou des plusieurs techniques. Ainsi cette partie du rapport présente les procédures par lesquelles nous sommes passés pour aboutir au résultats de cette étude. Voici donc, dans les lignes qui suivent la description des méthodes et des techniques utilisées dans cette étude de manière détaillée.
2.3.1. Méthodes
Selon les auteurs sur https://www.la–difference–entre.com/difference.methodetechnique une méthode est un mode opératoire, une approche ou un guide pour réaliser un travail ou pour réussir ce qui est entrepris. Autrement dit, la méthode est la manière de faire avec ordre et raisonnement.
Selon également les auteurs sur : https://commentouvrir.com/tech/les–3–
principaleshttps://commentouvrir.com/tech/les–3–principales–methodes–de–recherche– enpsychologiemethodes-de-recherche-enpsychologie, la Méthodologie de recherche est l’ensemble des techniques et des procédures utilisées pour mener une étude. Elle comprend la conception de l’étude, la collecte de données, l’analyse des résultats et la présentation des résultats. La méthodologie de recherche est essentielle pour assurer la validité et la fiabilité des résultats d’une étude.
Pour nous, une méthode est un ensemble des techniques qui permettent d’aboutir
à un résultat donné. Nous avons utilisé dans cette étude les méthodes suivantes :
A. La méthode d’études des cas
L’étude de cas est une méthode qualitative utilisée en psychologie clinique pour examiner en profondeur un phénomène psychologique à travers l’analyse détaillée d’un ou plusieurs individus dans leur contexte réel (Yin Robert K. 2018).[41] Elle permet de comprendre les processus cliniques complexes, en tenant compte des interactions entre facteurs individuels, environnementaux et thérapeutiques.
Dans cette recherche, la méthode repose sur une étude de cas multiple portant sur deux jeunes adultes âgés de 18 à 30 ans, présentant des symptômes dépressifs légers à modérés. Les cas ont été choisis de manière intentionnelle (échantillonnage raisonné) en fonction de critères cliniques pertinents et de leur engagement dans un protocole d’exposition à des espaces verts. Chaque cas a été analysé à partir de données recueillies selon plusieurs techniques que nous avons décrites clairement et de manière détaillée dans la prochaine étape, il s’agit de :
Entretiens cliniques non structurés ou on directifs (pré- et post-intervention ou exposition)
Échelles d’évaluation de la dépression (ex. : Beck, Hamilton)
Observations cliniques
Voir les questionnaires (pré et post exposition)
L’intervention a duré 4 semaines pour dire un mois, avec une exposition encadrée à des espaces verts (sentiers boisés), combinée à un suivi psychothérapeutique. Les données sont analysées selon une approche thématique afin de dégager des patterns dans l’évolution des symptômes et le vécu de l’expérience.
En psychologie clinique, cette méthode permet de générer des hypothèses cliniques fondées, de mettre en lumière des mécanismes de changement psychologique, et d’ouvrir la voie à des recherches futures à visée plus générale.
Pour ce qui concerne l’utilité qu’a cette méthode dans cette étude, elle nous a permis de mieux approfondir les difficultés qu’approuvaient nos deux jeunes adultes victimes des dépressions sur plusieurs plans comme : l’identification des symptômes de dépressions nous citons ici ; la perte d’intérêt et des plaisirs dans l’accomplissement des tâches habituelles ou quotidiennes, et bien tant d’autres symptômes. De maniérer concluante ou alors brève, cette méthode nous a donné la possibilité de mieux connaitre ou comprendre les vrais problèmes de nos deux cibles. Nous avons pu au travers cette méthode identifier plusieurs perspectives ou aspects sur la dépression ce qui nous a conduit vers ce que KAMBULU NSHIMBA JACQUES appelle : la triangulation,[42] ce qui veut dire nous sommes allés vers l’usage des plusieurs autres méthodes qui sont décrites fidèlement dans la partie suivante.
B. La Méthode Clinique
La méthode clinique en psychologie clinique est une démarche d’investigation
approfondie centrée sur l’étude de la personne dans sa singularité, son histoire, son fonctionnement psychique et son contexte de vie. Elle vise à comprendre les manifestations psychologiques d’un sujet dans leur complexité, en prenant en compte à la fois ses discours, ses comportements, ses affects et son environnement.[43] Elle a comme caractéristiques principales :[44]
- Approche qualitative et compréhensive :
Elle s’oppose aux méthodes expérimentales en s’intéressant moins à la
généralisation des résultats qu’à la compréhension profonde d’un cas particulier (Kaës, 1992).
- Centrée sur la subjectivité :
La méthode clinique s’appuie sur le discours du sujet, ses émotions, ses
représentations et ses conflits internes, souvent analysés à travers l’entretien clinique, l’observation, l’analyse des processus transférentiels, etc
- Utilisation des outils variés :
Elle mobilise des instruments cliniques comme :
L’entretien clinique (semi-directif ou libre),
Les tests projectifs (ex. : Rorschach, TAT),
Les échelles psychométriques (avec prudence),
L’analyse de cas.
Dans cette étude, nous avons utilisé les entretiens, les échelles de mesures comme ; l’échelle d’Hamilton et celle de BECK et bien tant d’autres.
- Interprétation et implication du clinicien :
Le clinicien est engagé subjectivement dans la relation et l’interprétation des
données qui reposent sur une co-construction de sens entre clinicien et patient (Devereux, 1967).[45]
La méthode clinique vise comme objectifs :
Comprendre les mécanismes psychiques en jeu (défenses, conflits, traumatismes…)
Repérer la dynamique du fonctionnement psychique individuel
Élaborer un diagnostic clinique et une prise en charge adaptée
Cette approche s’inscrit dans le cadre de la méthode clinique différenciée, telle
que définie par Blanchet et Gotman (2010), qui privilégie une observation rigoureuse du sujet dans sa globalité, en contexte réel, et dans une perspective compréhensive. Elle permet d’explorer la manière dont un facteur environnemental ici, l’exposition régulière à des espaces verts peut influencer l’évolution symptomatique tout comme la réduction, en tenant compte du vécu subjectif du patient.49
La psychologie clinique s’appuie sur une méthode clinique (où le diagnostic joue un rôle essentiel) en prenant en compte la singularité de chacun et en visant un objet particulier (l’homme en confit). C’est d’une part une activité pratique, et d’autre part une méthode et un corpus de connaissances centrées sur le sujet (observation, évaluation, diagnostic et aide).
Elle peut donc être définie comme une démarche de la psychologie clinique qui
a pour objet l’étude, l’évaluation, le diagnostic, l’aide et le traitement de la souffrance sous ses différentes formes (maladie mentale, événement de vie, questionnement, dysfonctionnement, traumatisme…), mais aussi le développement personnel.
La méthode clinique se réfère aussi bien aux techniques utilisées par le
psychologue qu’à la démarche clinique, dont cette démarche clinique comprend plusieurs étapes et niveaux d’interventions entre autres l’entretien clinique, les tests, les questionnaires et échelles, l’observation clinique, l’étude de cas, et les entretiens cliniques à visée thérapeutique, son objectif est de faire accroître les connaissances qu’on a d’un individu, et comprendre le changement puis acquérir beaucoup des informations à son sujet.
La méthode clinique utilisée dans cette recherche repose sur une approche
qualitative par étude de cas clinique approfondie, centrée sur l’observation, l’analyse et la compréhension des processus psychologiques en lien avec l’exposition aux espaces verts chez des jeunes adultes présentant des symptômes dépressifs.
Il faut également souligner que la méthode Clinique compte différents aspects
dont elle nous a été importante spécifiquement dans son aspect où elle vise à recueillir des informations fiables (évaluation, diagnostic, traitement de la souffrance psychique) et qui réfère en dernière instance ces informations à la dimension subjective singulière.
De plus, la méthode clinique possède une finalité orientée vers l’action
thérapeutique. Elle « guide une activité pratique visant la reconnaissance et la nomination de certains états, aptitudes, comportements dans le but de proposer une thérapeutique (psychothérapie par exemple) » (Kasongo, 2023) cité par Dalako Nsila Jean-Hortone (2025) son application cherche à établir un cadre basé sur « le consentement libre et éclairé », avec un faible degré de contrainte, favorisant un « recueil d’informations souhaitées les plus larges et les moins artificielles possibles qui donnent au sujet des possibilités d’expression » (Kasongo, 2023). Tshimanga (2023) cité par Dalako Nsila Jean-Hortone dans son mémoire de recherche (2025) précise que la méthode clinique repose essentiellement sur l’observation, incluant l’observation clinique proprement dite du patient et la technique particulière de l’entretien clinique comme outil principal d’investigation. Ces techniques permettent de recueillir des données qualitatives riches, essentielles pour comprendre le vécu subjectif du patient, ses émotions, ses pensées et l’histoire de sa problématique.
Et bien en ce qui concerne l’importance de l’applicabilité de cette méthode dans
cette recherche, se basant sur ses perspectives ou buts thérapeutiques, nous l’avons utilisé dans les fins de pouvoir appliquer une psychothérapie basée sur l’exposition aux espaces verts des victimes de dépression qui définit, détermine principalement et pratiquement notre variable indépendante.
2.3.2. Techniques
Nous avons utilisé dans cette étude : l’observation clinique, l’analyse de contenus, l’entretien directif, non directif et semi directif, les questionnaires, la technique documentaire, les échelles des mesures de la dépression (l’échelle de Hamilton, échelle de
Beck), l’observation clinique basée sur : (l’observation participante et l’observation armée), les analyses fonctionnelles (le SORC et les cercles vicieux).
1. Techniques de production des donnés
Nous nous sommes servi ans cette recherches des techniques suivantes comme outils ou moyens de productions des données :
A. L’observation clinique
L’observation est la base de la simple connaissance, du monde. Elle suppose l’attention centrée sur un objet et la capacité de discriminer les différences entre les phénomènes. C’est une action de considérer avec attention suivie ou soutenue la nature, l’homme, la société, afin de les mieux connaitre. L’observation Clinique ne concerne pas la réalité psychique en soi mais ses effets. L’observation Clinique, si elle vise la réalité psychique, subjective, porte sur un certain nombre d’éléments qui sont autant d’effets de la réalité psychique ; la réalité psychique n’est en effet pas observable en soi. Pour faire une observation Clinique, la méthode Clinique suppose donc une implication et des dispositifs pour limiter la saturation subjective, elle suppose une oscillation entre un mouvement d’implication et un mouvement de la distanciation ou de dégagement.[46]
L’observation est destinée à nous faire percevoir différemment les choses à en avoir une image plus rigoureuse ; elle nous apprend à nous détacher de ce qui nous semble familiers pour le percevoir autrement. Passer d’une perception simple à une méthode permettant de faire de la recherche. Nous définissons donc l’observation en cueillette des données où le chercheur devient le témoin des comportements des individus et des pratiques au sein des groupes en se tournant sur les lieux même où ils se déroulent.[47]
Il existe plusieurs formes d’observation tant en thérapie qu’en recherche, mais nous citons ici celles qui ont fait partie des techniques de production des données de cette étude, il s’agit de : l’observation participante et l’observation armée.
![]() L’Observation participante
L’Observation participante
L’observateur fait une assimilation en devenant témoin des comportements sociaux d’individus ou des groupes sur le milieu de leurs activités, sans modifier le déroulement de ces activités (Abarello, 2007) cité par Kasongo Maloba Tshikala.
![]() L’observation armée
L’observation armée
Selon nous, c’est une technique qui consiste à utiliser des outils d’enregistrement dans le but de comprendre le phénomène étudié.
Nous avons fait appel à cette technique car elle nous permis de mieux cerner la modification des comportements anormaux chez nos patients pendent nos séances d’exposition. Brièvement, elle nous a permis de plus mieux comprendre la situation de nos patients dans le but d’intervenir. Nous sommes parti des simples observations aux observations plus complèxes basées sur l’utilisation des outils comme : enregistreur des vidéos et de sons. C’était à chaque début et fin de séance que l’on observait nos patients, avant les séances d’expositions aux espaces verts, les observations avaient comme but ou fin : identifier les comportements malsains ou anormaux des sujets, et l’observations postexpositions, avaient comme cible ou visée : l’identifications des comportements réduits par l’exposition aux espaces verts.
B. L’entretien
JEAN-PIERRE BIRANGUI (2024) Le mot entretien, vient du verbe entretenir qui signifie étymologiquement tenir ensemble. Il signifie à la fois les soins, les réparations, les dépenses matérielles qu’exige le maintien en bon état d’un objet, ce qui est nécessaire à l’existence matérielle d’un individu. D’une collectivité et l’action d’échanger des paroles avec une ou plusieurs personnes, et le sujet dont on entretient. L’entretien, ce qui permet de tenir ensemble, est le principal outil de communication pour le clinicien. L’entretien est un dispositif par lequel un psychologue ou clinicien répondant professionnellement à une demande d’aide concernant un patient, favorise la production d’un discours de ce patient pour obtenir des informations c’est agir sur la problématique subjective de ce patient. Il s’apparente à une interview dont les objectifs ne seraient pas seulement d’extraire de l’information, mais également de créer le cadre nécessaire pour que cette information puisse être resituée et élaborée par le patient. Il est constitué par la fonction de recueil de données, de soutien et de traitement qui par un remaniement des modes de pensée et des comportements du patient, vise une amélioration de l’état psychique du patient.[48]
Nous avons utilisé dans cette recherche, l’entretien structuré libre ou directif, l’entretien non structuré non libre ou non directif et l’entretient semi-directif.
![]() L’entretien structuré ou directif
L’entretien structuré ou directif
L’entretien structuré met l’accent sur le problème à résoudre et laisse une plus
grande place à l’expertise du clinicien, tandis que l’entretien non structuré s’intéresse en premier lieu à la personne en difficulté et invite le clinicien à jouer avant tout un rôle de facilitateur. (JEAN-PIERRE BIRANGUI 2024).[49]
L’entretien directif est conduit sur le mode d’un questionnaire organisé et préparé
par écrit ou de mémoire. Il ne permet pas une grande implication personnelle de la part du consulté. Il est souvent utilisé pour conduire une investigation ou l’interrogatoire du client. Le psychologue détermine lui-même les thèmes de l’échange, et, induit les réponses de l’interviewé et/ou du sujet (entretien d’embauche, de recherche). Ceci suppose un protocole d’entretien prédéterminé qui délimite le champ d’investigation voire un questionnaire précis.
Il s’apparente à un interrogatoire.( TSHIBANGU LUSHIKU Pierre 2021-2022)[50]
![]() L’entretien non structuré ou non directif ou libre
L’entretien non structuré ou non directif ou libre
Encore appelé entretien centré sur la personne, dans le cadre de la pratique de
l’A.C.P., l’entretien non directif est un entretien au cours duquel le consultant évite de donner au client une direction, quel que soit le domaine, évite aussi de penser à ce que le client doit penser ou sentir, et, évite d’agir d’une manière prédéterminée. 11 s’agit tout simplement d’écouter au sens le plus strict, c’est tout. Le psychologue laisse le sujet parler librement par associations libres autour d’un thème. ( TSHIBANGU LUSHIKU Pierre 2021-2022)55
Il reste à l’écoute, repère l’enchaînement des thèmes dans le discours, aide
éventuellement par des relances pour que la personne élabore son point de vue personnel. II doit rester vigilant afin de ne pas orienter à son insu, le discours dans le sens qu’il souhaite. (Makelele Basile, cité par ASPAN A KASAS 2019, p.92).[51]
![]() L’entretien semi-Directif
L’entretien semi-Directif
L’entretien semi-directif part d’une idée, d’une hypothèse et de questions posées
par le consultant, qui cadre le discours. L’aspect spontané des associations du client est moins présent dans ce genre d’entretien. L’entretien semi-directif part d’une idée, d’une hypothèse et de questions posées par le consultant, qui cadre le discours. L’aspect spontané des associations du client est moins présent dans ce genre d’entretien. Dans le cadre d’une consultation. Il constitue le dispositif de base du psychologue clinicien. Dans ce cas la demande émane du patient. Exemple : l’entretien de recueil des données.[52]
Dans ce type d’entretien, le praticien dispose d’un guide d’entretien il a en tête
quelques questions qui correspondent à des thèmes sur lesquels il se propose de mener son investigation. Ces questions ne sont pas posées de manière hiérarchisée ni ordonnée mais au moment opportun de l’entretien, à la fin d’une association du sujet par exemple. Ce qui est proposé. C’est avant tout une trame à partir de laquelle le sujet va pouvoir dérouler son discours, c’est le praticien qui cadre le discours à partir des questions du guide mais il adopte toute de même une attitude non directive : il n’interrompt pas le sujet, le laisse associer librement mais seulement sur le thème proposé (Mulwani Makelele Basile, cité par ASPAN A KASAS 2019, p.90).[53]
Nous avons fait recours à ces techniques dans notre étude, parc qu’elles nous ont
permis de mieux récolter les informations possibles auprès de nos deux patients. Nous avons au cours de ces entretiens laisser à un moment libre nos patients à s’exprimer ce qui prouve l’utilisation de l’entretien non structuré ou libre ou non directif. Nous un moment cadré, structuré notre entretien et bien les patients répondaient aux question sur base des thèmes bien précis. Nous avons aussi utilisé l’entretien semi durectufcar il nous a permis de mieux cadrer notre recherche en mesurant ou structurant nos moment d’échange oui de production des données, ceci s’orientait vers les visées ou les objectifs à l’aide d’un guide d’entretien sur mesure, ce qui veut dire adapté ou conforme aux critères des hypothèses et de objectifs.
C. Le questionnaire
Kambulu Nshimba (2021) un questionnaire est un document écrit comportant
Une série des questions ou d’items qui concernent un thème bien déterminé. Il
peut contenir : Le question à réponse fermées où l’on laisse le choix libre du sujet,
Des questions ouvertes : le participant développe ses opinions librement, il
répond spontanément en utilisant son propre vocabulaire,
Des questions à réponses complexes dans lesquelles nous trouvons des
questions miroitées, dès que reflètes.
Déroulement de construction et administration du questionnaire
Nous avons constitué notre questionnaire en franchissant les six grandes étapes
pour la construction d’un questionnaire de recherche, il s’agit de :
- La pré-enquête : Nous avons commencé par faire une préenquête de
l’existence du phénomène à étudier et cela par l’appui de la méthode d’enquête psychosociale, ainsi nous nous sommes rendu compte que la situation était réelle. C’est ainsi que l’on est passé à la deuxième étape qui est celle du prétest,
- Le prétest : Ici nous soulignons que cette étape a consisté à poser différentes
questions des renseignements sur l’existence du problème ou de dépression chez les jeunes adultes dans le quartier KASSAPA, c’est ainsi que nous sommes passés à la troisième étape qui est celle de la détermination des thèmes.
- La détermination de thèmes : nous avons élaboré différents thèmes auxquels
on pouvait constituer différentes questions sur le sujet, nous pouvons dire que c’était en termes de thèmes centraux et les thèmes récurant qui accompagnaient notre sujet de recherche allant dans le même sens.
- L’élaboration du questionnaire : Autravers les différents thèmes récurrents
et le thème central, nous avons abouti à une réalisation des 10 questions principales qui ont permis l’existence du présent travail, celles-ci sont belles et bien présentées dans les parties réservées aux annexes.
- La rédaction définitive : nous avons rédigé notre questionnaire contenant 10
questions principales ou faisant parties de nos objectifs fixés en ce qui concerne cette étude. Nous l’avons rédigé sur des papiers A4, lesquels nous ont permis de les administrer aux victimes de dépression (nos deux patients) qui à leur tour ont pu remplir et fournir différentes informations sur principalement la réduction des symptômes dépressifs.
- L’administration : l’administration d’un questionnaire se fait de deux
manières, directement et indirectement.
F.1. Administration directe : ici le chercheur soumet un questionnaire au sujet
et ce dernier y rempli de façon directe ce qui veut dire qu’il lit et remplit lui-même le questionnaire de manière spontanée.
F.1. L’administration indirecte : ici le chercheur ne soumet pas le
questionnaire au sujet, mais par contre qu’il l’interroge et le chercheur lui-même remplit le protocole.
En ce qui nous concerne, notre questionnaire a été administré de manière directe,
et de manière indirecte. Nous avons soumis notre questionnaire d’une part nos patients au questionnaire de manière directe et d’autre part de manière indirecte. Cette administration s’est effectué avant, pendant et après les séances d’expositions aux espaces verts, ce qui a constitué notre expérimentation thérapeutique auprès de nos deux patients en proie de dépression. Avant la séance d’exposition le but était de pouvoir identifier ou rassemblez des informations sur le patient qui constitue sa situation actuelle ou présente. Après ou l’administration post exposition le but était de pouvoir mesurer l’intensité des symptômes de la dépression ou alors mesurer l’impact de notre thérapie « exposition aux espaces verts » sur les symptômes de la dépression.
D. L’échelle de Hamilton
L’évaluation clinique de la dépression repose sur des instruments validés
permettant de quantifier la sévérité des symptômes. Parmi les outils les plus largement utilisés dans le domaine de la psychologie clinique, l’échelle de dépression de Hamilton (HDRS ou HAM-D) occupe une place centrale depuis sa création par Max Hamilton en 1960. Elle a été conçue pour évaluer la sévérité de la dépression chez des patients hospitalisés et s’est progressivement imposée comme un standard dans les essais cliniques et les suivis thérapeutiques.[54]
L’échelle de Hamilton est une échelle d’évaluation clinique hétéro-administrée,
c’est-à-dire remplie par un clinicien à partir d’un entretien avec le patient. Elle existe en plusieurs versions, dont la plus courante comporte 17 items (HAM-D17), bien que des versions étendues (21 ou 24 items) soient également utilisées. Les items évaluent des dimensions telles que :[55]
- L’humeur dépressive
- La culpabilité
- Les idées suicidaires
- L’insomnie (précoce, intermédiaire, tardive)
- L’agitation et le ralentissement psychomoteur
- L’anxiété (psychique et somatique)
- Les troubles somatiques (gastro-intestinaux, généraux)
- La perte de poids
Chaque item est noté sur une échelle de 0 à 2 ou de 0 à 4, selon l’intensité du symptôme.
Interprétation des scores (HAM-D17) :[56]
- 0–7 : Pas de dépression
- 8–13 : Dépression légère
- 14–18 : Dépression modérée
- 19–22 : Dépression sévère
- ≥23 : Dépression très sévèree
Dans les études cliniques sur les antidépresseurs, la HAM-D est fréquemment
utilisée comme mesure principale de l’efficacité du traitement (par exemple, réduction du score de HAM-D ≥ 50 % = réponse au traitement). Elle est également utilisée pour identifier
la rémission (souvent définie comme un score final ≤ 7).[57]
L’échelle de dépression de Hamilton reste un outil incontournable dans la
recherche et la pratique clinique pour évaluer la sévérité de la dépression.
Cette technique nous a été utile dans cette recherche, elle a été appliquée en toute
début et toute fin des séances d’exposition aux espaces verts de nos patients dans le but de nous rassurer du niveau de leur état dépressif. Nous notons ici que son application a indiqué un niveau de dépression sévère avant les séances d’intervention thérapeutiques et un niveau de dépression légère vers les états modérés après notre interne thérapeutique.
E. L’inventaire de mesure de dépression de Beck (13 items)
Développé par Aaron T. Beck (1961), version abrégée proposée par Beck et
coll. dans les années 1970. Il a comme objectif principal : dépistage rapide des symptômes dépressifs, notamment en contexte épidémiologique ou clinique de routine. Le BDI-13 est une version courte du Beck Dépression Inventory (BDI), dérivée de la version originale à 21 items. Il comporte 13 items évaluant des dimensions cognitives, émotionnelles et somatiques de la dépression. Chaque item est coté de 0 à 3, selon la sévérité. Score total : 0 à 39. Plus le score est élevé, plus la symptomatologie dépressive est marquée. Les 13 items couvrent des aspects tels que :[58]
Tristesse, Perte d’intérêt, Sentiment d’échec, Sentiment de culpabilité, Idées
suicidaires, Retrait social, Indécision, Modification de l’image de soi, Difficulté à travailler, Fatigue, Perte d’appétit, Perturbation du sommeil, Irritabilité.
Cette version est conçue pour réduire le fardeau de passation tout en conservant
une bonne validité psychométrique. Le BDI-13 est souvent utilisé dans :[59]
Des études de dépistage en population générale ou en milieux sco-
laires/universitaires,
Des recherches en psychopathologie clinique (dépression, anxiété),
Des études interculturelles et interventionnelles.
Il a contenu des avantages et des limites que voici :[60]
Court et rapide à administrer (moins de 5 minutes)
Bonne fidélité (alpha de Cronbach > 0.80 dans plusieurs études)
Bonne validité convergente et discriminante
Adapté à des environnements variés (milieux cliniques, recherche
communautaire, contextes internationaux.
Limites :
Moins détaillé que le BDI-II (21 items)
Moins sensible aux changements cliniques fins
Certaines dimensions de la dépression (par ex. agitation, culpabilité excessive)
sont moins couvertes
L’Inventaire de Dépression de Beck à 13 items (BDI-13) constitue un outil fiable,
valide et efficace pour mesurer la dépression légère à modérée dans des contextes de recherche ou de dépistage rapide en psychologie clinique. Il est particulièrement utile lorsqu’un temps de passation court est requis ou en recherche de terrain.[61]
Cette outil nous permis de mesurer l’état dépressif de nos patients ou participants
à notre intervention thérapeutique.
F. La technique documentaire
Elle vise à analyser le sens d’un texte en prenant en considération toutes les
composantes de celui-ci qui appuient surtout le travail ou la thématique du sujet étudié.
Selon MWELE Tundulu (2020), c’est une analyse critique de la documentation
qui est une technique qui consiste à rassembler les documents écrits, bien sélectionnés pour les analyser, les interpréter suivant l’évolution des faits.
Elle est centrée sur trois réseaux d’informations distinctes :
Les informations constituant le message proprement dit (composante
linguistique)
Les informations relatives à l’émetteur du message (composante pédagogique)
Les informations relatives à l’effet poursuivi et son émetteur à l’argumentation (composante pragmatique)
Nous avons consulté différents documents qui se rapportent à notre sujet
d’étude. Cette technique permettant de collecte des informations à partir des écrits déjà existants sur le sujet de recherche, nous voyons également les documents externes : site internet, plaquettes, documents internes, rapports d’activités…)
La recherche qualitative est généralement interprétative : il ne s’agit pas de tester
ses théories, mais bien de comprendre un phénomène donné à partir d’interprétations, de témoignages puis d’opinions recueillies.
La technique documentaire permet aussi dans une recherche scientifique de
pouvoir collecter ou produire les données autravers les connaissances existantes portant sur le même sujet d’étude afin de construire ou établir une base de connaissances dont il peut s’inspirer. Ainsi en ce qui nous concerne nous avons utilisé plusieurs instruments constituant les éléments nécessaires pour notre étude il s’agit de :
- Les articles sur internet
- Les articles sur Wikipédia
- Les livres électroniques et en formats dures
- Les travaux des fins des cycles
- Les mémoires en électroniques et formats dures
- Les thèses
2. Technique de dépouillement des données
Nous avons utilisé à ce niveau l’analyse de contenu comme méthode de dépouillement de données.
![]() L’analyse des contenus
L’analyse des contenus
Après avoir collecté les données de terrain de notre recherche, l’analyse de contenu nous a permis de les dépouiller, car elle est une technique de plus en plus raffinée et en constante amélioration s’appliquant à des discours extrêmement diversifiés et fondés sur la déduction ainsi que l’inférence. Il s’agit d’un effort d’interprétation qui se balance entre deux pôles, d’une part, la rigueur de l’objectivité, et, d’autre part, la fécondité de la subjectivité (Bardin, 1977).67
67 BARDIN, Laurence. L’analyse de contenu. Paris : presse Universitaire de France (PUF), 1977. (Rééditions :
1993, 2001, etc.)
Selon Picard (1995) cité par Kazadi Ndjibu André, l’analyse de contenu a profité de l’organisation et de la structuration des sciences sociales dans les années 1920-1930. Elle bénéficia également de la consolidation de la psychologie sociale qui se consacrait alors à la communication de masse. En plus, la psychologie clinique lui fit honneur dans ses tentatives de raffinement de ses propres méthodes d’interprétation et d’intervention sur les comportements.[62]
Pour Van Campenhoudt & Quivy (2011) cité également par Kazadi Ndjibu An-
dré, l’analyse de contenu occupe une grande place dans la recherche sociale, notamment parce qu’elle offre la possibilité de traiter de manière méthodique des informations et des témoignages qui présentent un certain degré de profondeur et de complexité, comme par exemple d’entretien semi-directifs. Mieux que toute de dépouillement des données empiriques, l’analyse de contenu permet, lorsqu’elle porte sur un matériau riche et permettant de satisfaire harmonieusement aux exigences de la rigueur méthodologique et de la profondeur inventive qui ne sont pas toujours facilement conciliables. Le premier aspect fondamental de l’analyse de contenu est la compréhension du sens explicite de la communication. Le second est le dévoilement d’une signification implicite du message.[63]
Ce deuxième aspect concerne la révélation d’un autre message entrevu à travers ou à côté du premier (Bardin, 1989, p.46).[64][65] L’analyse de contenu opère donc à partir d’un premier niveau de lecture, au pied de la lettre, et se prolonge à un second niveau de lecture : le sous-jacent ou le sous-entendu. Le but poursuivi durant cette phase centrale d’une analyse de contenu consiste à appliquer, au corpus de données, des traitements autorisant l’accès à une signification différente répondant à la problématique mais ne dénaturant pas le contenu initial (Robert & Bouillaguet, 1997).[66]
En ce qui nous concerne principalement, sous le terme d’analyse de contenu nous
faisons simplement allusion à une stratégie ou technique, applicable à des rapports ou des contenus d’informations divers, qui visent à dépouiller lesdites informations en vue de les interpréter. Le choix d’une orientation ou une stratégie ou encore d’un outil de recherche spécifique et le sens de l’interprétation reposent à la fois sur la nature des données, les questions qui structurent la recherche ainsi que sur les fondements épistémologiques qui animent le chercheur. Ainsi pour son usage ou encore application dans ce rapport, nous avons commencé par le repérage des indices et l’élaboration des indicateurs, où il s’agissait spécifiquement de choisir les indices contenus dans le corpus en fonction des hypothèses (si est seulement si celles-ci étaient déterminées) et de les organiser systématiquement sous forme d’indicateurs précis et fiables. Ensuite nous sommes passé par la préparation du matériel, où nous avons notamment accompli les opérations de découpage du corpus en unités comparables, de catégorisation pour l’analyse thématique.
Enfin nous avons procédé par la classification thématique ou la liste des thèmes
abordés dans le corpus. Nous soulignons ici également que, l’analyse de contenu demande un grand esprit scientifique pour avoir la facilité d’accepter de donner les vrais thèmes à traiter.
En suite de cela, cette section s’est généralement effectuée en accord avec une problématique de recherche déterminée au préalable entre autres :
Question 1. Quel est l’impact des espaces verts sur la réduction des
symptômes dépressifs ?
Question 2. Faudra-t-il utiliser les espaces verts comme approche
thérapeutique en cas de dépression ?
Ou, dans une approche indicative, en cherchant à questionner un objet dont on a
une idée générale au préalable.
L’analyse de contenu s’organise autour de trois phases chronologiques : la pré-
analyse, l’exploitation du matériel ainsi que le traitement des résultats, l’inférence et l’interprétation. La pré analyse c’est effectuer à l’avance une première analyse ; le déroulement du processus qui découle entre prescription et analyse appelé phase pré analytique, comporte la préparation du patient et du matériel, l’acte de recueil d’un échantillon représentatif, sa conservation et son transport. L’objectif est de faire ressortir les idées centrales d’un codage spécifique (codage sélective) parfois prés codés ; dont sur ce point, lors de l’entretien avec la victime, ont rassuré toujours la confidentialité pour conclure qu’avec un soutien psychologique.
L’exploitation du matériel est une action de mettre en valeur quelque chose en
vue d’en tirer un profit. Comment exploiter un guide d’entretien ? Il faut se présenter et présenter le thème général de l’enquête (il est possible de proposer un thème le plus large, et de voir comment il apparaît dans le discours et à la place qu’il occupe). Expliquer le but et l’objectif de la recherche ; cependant, on s’est principalement référé à notre guide d’observation et d’entretien après avoir présenté le thème et les questions de recherche.
Traitement des résultats : globalement, présenter les résultats d’une enquête ex-
prime de manière concise et synthétique le texte, les raisons de l’enquête et puis ses méthodes, ses résultats et ses conclusions principales, les discuter en imaginer le prolongement ;
Influence et l’interprétation : interpréter les résultats signifie donner du sens aux
résultats et nous permettre de vérifier si notre hypothèse est vraie ou fausse, comparer les expériences 2 à 2 : on compare l’expérience témoin avec une autre expérience. Confère au troisième chapitre.
L’analyse des données quantitatives consiste à retranscrire les données qualita-
tives, ayant donné une grille d’analyse, à coder les informations recueillies et à les traiter. L’analyse décrit le matériel d’enquête et en étudie la signification. Cette partie approfondie principalement les principales étapes de l’analyse de contenu. Ainsi donc, dans notre étude nous avons utilisé la méthode d’études des cas, la méthode clinique, l’observation Clinique, et l’entretien non directif, non structuré ou libre, les échelles, comme techniques, l’analyse de contenu et une grille pour chaque cas qui nous a permis d’une certaine manière d’interpréter l’impact des espaces verts sur la réduction des symptômes dépressifs qui sera présenté et décrit dans le chapitre troisième.
3. Techniques de traitement de données
Nous avons utilisé dans cette étude comme techniques, outils ou moyens des traitements des données d’une part : l’analyse fonctionnelle SORC et l’analyse fonctionnelle des cercles vicieux : d’autre part nous nous sommes servi des règles ou principes d’interprétations des différentes échelles de mesures comme : l’inventaire de dépression BECK et l’échelle de mesure de dépression d’Hamilton.
a. L’analyse fonctionnelle SORC
L’analyse fonctionnelle SORC est un modèle largement utilisé en psychologie comportementale et en thérapie comportementale cognitive (TCC), particulièrement pour l’évaluation et l’intervention des comportements problématiques. Ce modèle permet de comprendre les fonctionnements complexes des comportements humains en se concentrant sur les relations entre les Stimulus (S), les Organismes (O), les Réponses (R) et les Conséquences (C).
Le modèle SORC est une approche systématique utilisée pour comprendre les
comportements en termes de leur contexte environnemental, biologique et émotionnel. Il décompose les comportements en 4 éléments essentiels : Stimulus (S) : Facteurs externes qui provoquent le comportement (environnement, événements déclencheurs). Organisme (O) :
Caractéristiques internes de l’individu, telles que ses croyances, émotions, cognitions, et son état physiologique. Réponse (R) : Le comportement observable ou l’action de l’individu en réponse aux stimuli. Conséquence (C) : Résultats du comportement qui influencent la probabilité qu’il se répète à l’avenir.
a) Stimulus (S)
Le stimulus fait référence à tout événement ou situation dans l’environnement
qui déclenche une réaction chez l’individu. Cela peut inclure des facteurs tels que :
Stimuli externes : bruits, situations sociales, événements stressants. Stimuli
internes : pensées automatiques, émotions ou sensations corporelles.
b) Organisme (O)
Il s’agit des caractéristiques internes de l’individu qui modulent la façon dont le
stimulus est perçu et traité. Cela inclut :
Croyances (ex. : croyance en soi, pensées négatives), Émotions (ex. : anxiété,
colère), État physiologique (ex. : fatigue, faim), Capacités cognitives (ex. : capacité à résoudre des problèmes)
c) Réponse (R)
Le comportement observé, qui résulte de l’interaction entre le stimulus et
l’organisme. Ce comportement peut être adapté ou dysfonctionnel, selon les circonstances. d) Conséquence (C)
Les conséquences sont les effets de la réponse, et elles jouent un rôle crucial dans
la répétition du comportement. Elles peuvent être :
Renforcement positif : récompenses ou renforcements (ex. : compliments,
évitement d’une situation désagréable),
Renforcement négatif : la suppression de stimuli désagréables,
Punition : conséquences négatives qui diminuent la probabilité du
comportement.
Le modèle SORC s’inspire principalement de la théorie de l’apprentissage et de
la psychologie comportementale.
Rachman, S. (1977). Dans son ouvrage « The Conditioning Theory of Fear », Rachman a détaillé les relations stimulus-réponse et a montré comment les conséquences renforcent les comportements. Cette base est essentielle pour comprendre les interactions SORC.[67]
Goldiamond, I. (1974). Il a approfondi les applications de l’analyse
fonctionnelle en comportement humain dans des contextes cliniques. Il a défini les modèles SORC comme des éléments clés pour comprendre les comportements dysfonctionnels et leur modification.[68]
L’analyse fonctionnelle SORC est un outil précieux dans divers contextes
thérapeutiques et cliniques, notamment :
- Troubles anxieux : Identification des stimuli déclencheurs de l’anxiété,
analyse des réponses (comportements d’évitement, panique), et étude des conséquences (récompenses, renforcements négatifs).
- Troubles de l’alimentation : Par exemple, l’examen des stimuli émotionnels
ou sociaux qui déclenchent des comportements alimentaires compulsifs, et des conséquences qui renforcent ces comportements.
- Troubles de la conduite : Analyse des comportements problématiques (agression, fugue) en lien avec les événements déclencheurs et les renforcements sociaux ou individuels.
Nous avons utilisé cet outil dans notre recherche chez le patient DANIEL NGOY. Il nous a permis de mieux appréhender et comprendre la situation dépressive de notre patient et nous a donné une vue nette et cire sur la situation présente du sujet.
Nous nous en sommes servis et avons mieux appréhender les éléments ou
facteurs déclencheurs de la situation dépressive de Monsieur Daniel Ngoy, ce qu’il pouvait avoir comme réaction ou réponses aux stimuli, et en fin les insectes négatifs ou conséquences sur ses états cognitifs, affectifs, sociaux et comportementaux.
En gros, cet outil nous a permis des traiter les informations obtenues chez nos
patients répondant premièrement au traité DANIEL NGOY dans le but de mieux comprendre sa situation départ les données obtenues pendent nos séances d’exposition aux espaces verts, deuxièmement nous avons utilisé cet outil dans cette recherche pour analyser et comprendre la situation dépressive de notre deuxième patient qui réponds au nom de THIERRY Samba. Nous avons par cette analyse compris et mieux appréhendé clairement la situation de Monsieur Thierry Samba, ce qui nous a permis à mieux identifier en nous indiquant sur ce que pourraient être les stratégies thérapeutiques de Monsieur Thierry Samba.
2.3. LES DIFFICULTES RECONTREES
Nous n’avons pas fait face à plusieurs difficultés mais elles ont fait objet dans cette étude. Voici la difficulté la plus pertinente de cette étude :
Nous voulions au cours de cette étude la réduction instantanée des symptômes
de dépressions cela était plus difficile par le fait que la réduction desdits symptômes nécessitait un temps et cela s’est et se réduit de manière progressive.
| VARIABLES | INDICATEURS |
| VARIABLES DEPENDENTES | |
| Les espaces verts | |
| VARIABLES INTERMEDIAIRES | Paroles des motivations : |
| Entretiens de motivation | |
| VARIABLES INDEPENDENTES : | |
| Les symptômes dépressifs |
TROISIEME CHAPITRE
PRESENTATION DES RESULTATS
Le présent chapitre apparait le plus expérimental de notre investigation, car il va au-delà de toutes les considérations théoriques pour présenter les données qui nous ont permis de vérifier nos réponses anticipatives. Ainsi, dans cette partie nous présentons et analysons ; nous interprétons les informations ou les données de notre recherche lesquelles étaient obtenues au cours de notre investigation, nous donnons enfin de réponses à notre problématique pour ainsi confirmer ou infirmer les hypothèses émises. (Discussions)
3.1. PRESENTATION ET ANALYSE DES DONNEES (CAS)
3.1.1. Premier Cas
Voici ainsi ce que nous avons obtenu comme informations auprès de notre premier patient qui répond au nom de DANIEL NGOY.
3.1.1.1. Identification du patient
Nom : DANIEL NGOY
Genre : M
Age : 30 Ans
Eta-civil : Célibataire
Fratrie : Ainé de famille
Province d’origine : Haut-Katanga
Niveau d’étude : Licencié
Profession : Vendeur des téléphones mobiles
Nationalité : Congolaise
Motif de consultation : Plaintes d’un état de tristesse intense, des idées de désespoir et un isolement progressif qu’il attribue à « une série de trahisons sentimentales »
Anamnèse :
Monsieur Daniel Ngoy, âgé de 30 ans, célibataire, vivant à Lubumbashi dans
la commune Annexe, plus précisément au quartier Kassapa, calme et respecté dans son entourage, titulaire d’un diplôme en gestion commerciale obtenu à l’Université de Lubumbashi, et travaillant comme vendeur dans une maison de téléphonie mobile. Il consulte pour un état de tristesse intense, des idées de désespoir et un isolement progressif qu’il attribue à « une série de trahisons sentimentales » ayant, selon ses mots, « tué son cœur petit à petit ».
L’histoire commence à l’âge de 19 ans, lorsqu’il entretient sa première relation
sérieuse avec une fille du quartier, une camarade du groupe de jeunes de son église. Plein d’espoir et profondément investi affectivement, il vit cette relation avec intensité et naïveté, la considérant déjà comme une future épouse. Mais après quelques mois, la jeune fille, influencée par sa famille et attirée par un autre garçon mieux nanti, met fin à la relation sans explication claire. Daniel vit cette rupture comme un premier coup dur, mais il tente de se convaincre que ce n’était qu’un malheureux hasard.
À 22 ans, il entame une nouvelle relation avec une camarade de promotion,
relation qui durera près de deux ans. Celle-ci se termine lorsqu’il découvre que sa partenaire, bien qu’affectueuse avec lui, s’était secrètement fiancée à un autre homme vivant en Afrique du Sud. Ce double jeu provoque un choc émotionnel : Daniel se replie sur lui-même, perd confiance en ses jugements, et commence à développer une peur du lien affectif. Il se jette alors dans le travail pour tenter d’oublier, mais au fond de lui, il ressent un vide croissant.
À 25 ans, il croit enfin avoir trouvé la bonne personne : une jeune enseignante
qu’il rencontre à cette période de sa vie. Leur relation semble stable, douce, complice. Ils parlent sérieusement de fiançailles, prévoient même d’acheter un terrain ensemble. Mais soudain, après deux ans, elle lui annonce qu’elle est enceinte d’un autre homme, qu’elle avait continué à fréquenter « par peur de se tromper ». Cette nouvelle anéantit Daniel. Il perd toute confiance en l’amour, s’isole, devient silencieux, et commence à présenter des symptômes dépressifs marqués : insomnie, perte d’appétit, difficulté de concentration, pleurs fréquents, pensées d’auto dévalorisation. Il commence à manquer le travail sans justification, évite ses amis, et passe la plupart de son temps enfermé dans sa chambre. Il dit souvent à sa sœur : « Mon cœur est devenu un désert ».
À 29 ans, après une tentative timide de nouvelle relation via les réseaux sociaux,
qui se termine par un ghosting humiliant, Daniel s’effondre totalement. Il perd du poids, arrête de prendre soin de lui, reste parfois des jours sans se laver. Il évoque des pensées sombres, comme « ça ne sert à rien de continuer », planification d’un acte suicidaire. Ses proches commencent à s’inquiéter sérieusement et l’emmènent à faire une consultation.
Faits observés :
Nous avons observé pendent nos séances d’entretiens auprès de Monsieur DANIEL NGOY les faits suivants : état de tristesse intense, des idées de désespoir et un isolement progressif, le repli sur soi, manque de confiance en soi, peur des relations affectives. Difficulté de concentration, pleurs fréquents, pensées d’auto dévalorisation, parle avec lenteur, le regard vide, la posture affaissée. Il dit avoir perdu tout espoir, se sentir incapable d’aimer à nouveau, et avoir l’impression d’être « brisé à jamais ». 3.1.1.2. Tableau clinique
| |
Diagnostic :
Au vu du tableau clinique que présente le patient DANIEL NGOY, en nous basant également sur les résultats que nous donne l’inventaire abrégé de dépression de BECK (13 ITEMS) au seuil de gravité de 16 et plus ; et de l’examen psychologique que nous avons eu à effectuer, nous disons donc que le patient DANIEEL NGOY souffre d’un épisode dépressif majeur ou encore d’une dépression sévère selon l’échelle de BECK.
3.1.1.3. ANALYSE FOCTIONNELLE SELLON LA GRILLE DE SORC
S O R C
| 1 ère rupture de relation amoureuse ème rupture de 2 relation amoureuse 3ème Rupture de relation amoureuse 4ème rupture de relation amoureuse par un ghosting humiliant. S | Rien à signaler Sensation d’un vide croissant. Manque de confiance en l’amour, pensées d’auto dévalorisation Pensées sombres « ça ne sert à rien de continuer ». | Rien à signaler Se trouver un boulot pour oublier Eviter ses amis et maquer le travail sans justification, Passer du temps enfermé dans la chambre. Cessation de prendre soin de lui ou de se laver Planification d’un acte sui suicidaire. | Rien à signaler Repli sur soi, perte de confiance en ses jugements, peur du lien affectif. insomnie, perte d’appétit, difficulté de concentration, pleurs fréquents, pensées d’auto dévalorisation. Isolement social. 4. Perte de poid. |
Type de personnalité : Introvertie « (I) Gustave Carl YUNG. »[69]
Stratégie psychothérapeutique : La psychothérapie basée sur l’exposition aux espaces verts.
3.1.2. Deuxième Cas
3.1.2.1. Identification du patient
Nom : Thierry Samba
Genre : M
Age : 29 Ans
Eta-civil : Célibataire
Fratrie : 2ème de sa famille
Province d’origine : Haut-Katanga
Niveau d’étude : Licencié
Profession : Sans emploi
Nationalité : Congolaise
Motif de consultation : plaintes des troubles de l’humeur persistants, une fatigue inexpliquée, un retrait social marqué, des troubles du sommeil, et un désintérêt pour les activités de la vie quotidienne.
Anamnèse :
Monsieur Thierry Samba, âgé de 29 ans, vivant à Lubumbashi dans la
commune Annexe, quartier Kassapa, célibataire de son état, titulaire d’un diplôme en électromécanique se plaint des troubles de l’humeur persistants, une fatigue inexpliquée, un retrait social marqué, des troubles du sommeil, et un désintérêt pour les activités de la vie quotidienne.
L’histoire de sa maladie remonte à environ deux ans, mais trouve ses racines dans
un parcours personnel et professionnel frustrant et semé d’embûches. Thierry se décrit comme un élève studieux et ambitieux dans son enfance, élevé dans une famille où l’éducation était vue comme la seule porte de sortie vers une vie meilleure.
Après avoir brillamment terminé ses études secondaires dans une école technique de
Lubumbashi, il réussit à entrer à l’ISTL où il poursuit avec détermination un cursus en électromécanique, convaincu qu’il pourra décrocher un emploi stable après l’obtention de son diplôme. Cependant, après sa graduation en tant que licencié à 25 ans, il entame un long parcours d’attente, de frustrations et d’échecs dans ses recherches d’emploi.
Pendant deux années, il multiplie les candidatures dans les entreprises minières de la ville, les agences de maintenance, les sociétés d’ingénierie et même dans les établissements scolaires techniques comme enseignant contractuel, sans obtenir de réponse favorable.
Plusieurs fois, il participe à des entretiens prometteurs, mais est toujours confronté à la fameuse exigence d’« expérience professionnelle » ou à la nécessité d’un « parrainage », qu’il n’a pas. Petit à petit, Thierry perd confiance en lui.
Au début, il gardait l’espoir, s’investissant dans de petits boulots ponctuels comme réparateur de moteurs à domicile ou assistant bénévole dans un garage. Mais au fil du temps, ces activités deviennent rares, sous-payées, et insuffisantes pour subvenir à ses besoins. Il commence alors à ressentir un profond sentiment d’inutilité. À partir de 27 ans, ses symptômes dépressifs deviennent plus évidents : il se plaint d’un épuisement constant malgré le repos, d’une perte d’appétit, de troubles du sommeil (difficulté à s’endormir, réveils précoces), de perte d’intérêt pour ses activités favorites, notamment le football de quartier qu’il pratiquait chaque week-end.
Il devient irritable, hypersensible aux critiques de sa famille qui lui demande souvent s’il « cherche vraiment » du travail. Il commence à éviter les réunions de famille, les fêtes du quartier, et même l’église, par honte de sa situation. Il dit se sentir « comme un fardeau inutile », « sans avenir », et « laissé de côté par la société ».
À plusieurs reprises, il a eu des pensées suicidaires passives, notamment lorsqu’il voyait ses anciens camarades de classe en uniforme de sociétés minières, roulant en voiture pendant que lui restait à la maison. Il n’a pas tenté d’acte suicidaire, mais il confesse avoir parfois souhaité ne pas se réveiller le matin. Ses journées sont rythmées par l’ennui, l’autoaccusation, et une rumination constante sur son avenir incertain.
À 28 ans, il entame une relation avec une jeune femme du quartier, mais celle-ci le quitte quelques mois plus tard, déclarant ne pas pouvoir « construire un avenir avec un homme qui ne travaille pas ». Cet échec amoureux vient renforcer son sentiment de rejet, d’humiliation, et accentue son isolement. C’est sa mère, inquiète de son comportement renfermé et de son manque d’énergie, qui l’encourage à trouver solution en cherchant qui pouvait l’accompagner ou le soigner (psychologue).
Faits observés :
Pendent nos séances d’entretien Monsieur Thierry, parle peu, garde les yeux au sol, semble abattu, avec un discours marqué par des idées de dévalorisation, de culpabilité (« j’ai déçu mes parents », « je suis un raté »), et une forte anxiété sur l’avenir. Il ne présente pas de symptômes psychotiques ni de troubles maniaques, mais son discours est très pessimiste, rigide et teinté d’impuissance apprise.
3.1.2.2. Tableau clinique
| |
Diagnostic :
Au vue du tableau clinique que présente le patient THIERRY SAMBA, en nous
basant également sur les résultats que nous donne l’inventaire abrégé de dépression de BECK (13 ITEMS) au seuil de gravité de 16 et plus ; et de l’examen psychologique que nous avons eu à effectuer, nous disons donc que le patient THIERRY SAMBA souffre d’un épisode dépressif majeur ou encore de dépression sévère selon l’échelle de BECK.
3.1.2.3. ANALYSE FONCTIONNELLE SELLON LA GRILLE DE SORC
S O R C
| Long parcours d’attente, de frustrations et d’échecs dans ses recherches d’emploi.Déception amoureuse | Pensées suicidaires La rumination Manque de confiance en soi Sentiment de rejet | Repli sur soi L’irritabilité Désintérêt dans les activités quotidiennes accompagné d’un évitement social | Rien à signaler |
Type de personnalité : Introvertie « (I) Gustave Carl YUNG. »[70]
Stratégie psychothérapeutique : Psychothérapie basée sur l’exposition aux espaces verts
3.1.3. Déroulement de l’intervention thérapeutique
Nous avons présenté chaque cas et quelques informations liées à leur souffrance, à présent nous présentons de manière détaillée les processus par lesquels nous sommes passés pour intervenir auprès des patients atteints de la dépression ce qui définit même notre étude ou alors le visé de cette recherche.
3.1.3.1. L’intervention thérapeutique avec le patient DANIEL NGOY Objectif :
L’objectif de cette intervention s’inscrit dans la logique telle qu’annoncée par notre étude dans sa partie d’objectifs : identifier, Décrire et déterminer, l’impact qu’a les espaces verts sur la réduction des symptômes dépressifs, et Approuver l’utilisation des espaces verts comme approche thérapeutique en cas de dépression. Nous avons pu amener le patient DANIEL NGOY vers un état acceptable ou alors un état d’amélioration basée sur une réduction successive des symptômes de dépression. Cela s’est effectué pendant au moins 10 séances trois de simples entretiens, de prise de contact et d’un examen psychologiques et 7 autres d’exposition aux espaces pour dire (des séances thérapeutiques) voici :
1ère Séance :
Objectif : ans la toute première séance, il s’agissait de prendre contact et d’établir une relation de confiance basée sur la thérapie ou le traitement de son problème et aussi avoir son libre consentement à participer à cette expérimentation thérapeutique.
Date et heure : Le 01 mars 2025, à 14 H’50
Comme dans son anamnèse telle décrite dans les parties précédentes, le patient Thierry a été amené et conscientisé par ses proches de pouvoir chercher un psychologue qui pouvait l’accompagner et que cela coïncidait avec notre moment d’investigation basée sur la mesure de l’impact d’une approche ou technique psychothérapeutique basée sur l’exposition aux espaces verts. Et c’est ainsi que nous avons gagné la confiance de monsieur DANIEL NGOY à participer à cette prise en charge.
Au cours de notre entretien avec le patient, il nous a présenté ses identités par une série des questions qu’on lui posait progressivement, et il nous a en même temps fournis les informations sur sa maladie qui ont constituées l’histoire de sa maladie.
Cette séance avait comme objectif de récolter les informations sur le patient au travers une observation clinique et un questionnaire. Elle nous a permis de récolter toutes les informations possibles sur sa personne et un briefing de sa maladie avant les interventions formelles thérapeutiques.
2ème séance
Objectif : Dans cette séance l’objectif était de pouvoir établir un diagnostic provisoire ou hypothèque, basée sur des simples observations cliniques et bien l’histoire ou anamnèse de la maladie du patient.
Date et heure : Le 03 Mars 2025 à 14 30’
Nous avons au travers ces moyens conclus hypothétiquement qu’il s’agissait d’une dépression sans détermination préalable vue les informations assez limitées (simples observations et histoire de la maladie)
3ème séance
Objectif : Cette séance s’est assignée comme objectif, mieux comprendre la situation présente du patient dans le but de pouvoir diagnostiquer de manière systématique au travers des instruments ou tests standardisés comme : l’inventaire abrégé de dépression de BECK (13 ITEMS) le problème réel du patient.
Date et Heure : Le 4 Mars 2025 à 14 h 15’
Nous avons soumis notre patient à une série des questions visant à comprendre réellement sa situation et cela nous a révélé des éléments comme : manque de confiance en soi, perte d’intérêt, les perturbations de sommeil ou alors, les insomnies répétées.
Nous avons également soumis le patient au test de mesure de dépression (inventaire abrégé de dépression de BECK) ce dernier nous a révélé une dépression sévère car le seuil s’élevait au rang de 16 point et plus.
Et bien départ les résultats de ces instruments, nous avons conclu systématiquement que notre patient souffrait d’une dépression au seuil le plus sévère.
Nous soulignons que les 3 premières séances consistaient à récolter les informations sur le patient. Et bien comme thérapie proposée se basait sur une psychothérapie qui se centrait sur l’exposition aux espaces verts accompagnée d’un soutient motivationnel sur sa situation dans le but de voir comment les espaces verts auraient comme impacte sur la réduction de symptômes dépressifs. Et bien nous présentons donc ici et dans les lignes qui suivent la description détaillée des processus par lesquels nous sommes passés pendent les séances pré et post exposition.
4ème Séance
Objectif : Mesure de l’état dépressif
Date et heure : Le 6 mars 2025 à 14 h 15
A notre première séance d’exposition ou séance psychothérapeutique, de Monsieur DANIEL NGOY nous avons commencé de prime abord par lui donner quelques paroles de motivation puis nous lui avons soumis à l’échelle de mesure de dépression d’Hamilton dans le but de nous rassurer du niveau de dépression, cette dernière a indiqué une dépression sévère. Nous lui avons exposé aux espaces verts pendent une durée de 30 Minutes tout en étant à ses côtés pour l’observer et lui motiver à accepter la situation et prendre courage).
Nous avons juste après l’exposition soumis également Monsieur DANIEL NGOY à un questionnaire qui retraces les objectifs et hypothèses de notre étude, le questionnaire nous a révélé aucun changement du point de vue diminution de son état dépressif. Et bien à cette première séance rien n’a été signalé en terme des résultats positifs.
5ème séance
Objectif : L’objectif de cette séance deuxième séance psychothérapeutique, était de pouvoir identifier l’impact des espaces vert sur les symptômes spécifiques, que nous citons ici en ces termes : manque de joie ou perte d’intérêt dans ses activités quotidiennes (vente des téléphones dans un shop), les insomnies répétitives.
Date et Heure : Le 8 Mars 2025 à 14 h 15’
Avant la séance, nous lui avons soumis à l’échelle de masure de dépression d’Hamilton, cette échelle a montré toujours une dépression sévère. Nous lui avons soumis quelques paroles de motivations sur sa situation, et lui avons exposé aux espaces verts également pour une durée de 30 minutes tout en étant toujours à ses côtés pour observation et accompagnement et suggestion des quelques mots de motivation et de détente de sa mémoire ou pensées.
Nous avons observé à la fin de la séance que Monsieur DANIEL était très content très joyeux, et il nous a dit sous effets des joies qu’il irait demain à son poste très tôt matin pour vendre.
Et bien pour nous rassurer de la sévérité de son état de dépression, nous lui avons soumis encore à l’échelle d’Hamilton qui nous a montré une diminution progressive.
6ème Séance
Objectif : Cette troisième séance psychothérapeutique avait comme objectif de vérifier la diminution des symptômes suivants : Humeur dépressive, perte d’appétit, fatigue ou perte d’énergie, sentiments de dévalorisation ou de culpabilité excessive.
Date et Heure : Le 10 Mars 2025 à 14 h 15’
Nous avons posé quelques questions de curiosité visant à vérifier les bienfaits de la précédente séance, nous nous sommes rendu compte que le patient DANIEL NGOY avait changé de manière un peu plus progressive.
Nous avons exposé Monsieur DANIEL NGOY aux espaces verts en lui donnant une instruction selon laquelle : cette séance ne prendra que 30 minutes. A la fin de cette exposition, nous lui avons soumis à l’échelle d’Hamilton et bien évidemment cette dernière nous a amené à un état dépressif léger, et nous avons vu sur le champ : l’humeur changé d’humeur dépressive à une humeur normale ou à une sérénité. Nous avons vu monsieur DANIEL NGOY nous dire en nous racontant combien il est capable d’exécuter des tâches multiples si l’on pouvait les lui présenter sur place.
Dans cette séance nous avons quelques fois atteint l’objectif pas de manière globale ou totale, mais de manière un peu plus partielle ce qui veut dire que nous avons vu certains symptômes disparaitre et non la totalité des symptômes que nous nous sommes assigné comme objectif en tant qu’objets de travail du jour.
7ème séances
Objéctif : Dans cette quatrième séance psychothérapeutique, nous nous sommes fixé comme objectif la réduction des deux symptômes plus dominants : les idées de désespoir, évitement social.
Date et heure : Le 13 Mars 2025 à 14 h 15’
Nous avons de prime abord soumis notre patient à un questionnaire qui vérifie de manière rapide l’état ou le niveau de sa dépression en nous focalisant sur les symptômes qui ont fait objet de disparition ou de réduction suite aux expositions précédentes. Nous nous sommes rendu compte que lesdits symptômes n’ont pas été identifiés ou observés en terme de manifestation, il s’agit de : l’humeur dépressif, la perte d’intérêt.
Nous avons exposé notre patient aux espaces vers pendent une durée de 30 minutes, tout en l’accompagnant de manière participative et interactive en échange des paroles motivationnelles sur les bien fais du bien être en société, avec les amis dans le but de booster sa capacité à éviter son social (amis, église, lieu de travail), nous avons aussi des paroles de motivation sur le fait que son morale remonte et qu’il n’ait pas un désespoir total.
En fin de séance nous avons fait un petit entretien qui a tourné au tour de ces
deux symptômes susmentionnés dans le paragraphe précédent. Nous nous sommes rendu compte que la morale du patient avait changé de camp ce qui veut dire cela lui a ramené à un état d’espoir à un avenir encore meilleur, cela s’est observé au travers ses dires : je suis vraiment content de vous rencontrer, je suis très joyeux et j’espère à mon futur, j’aurais ma femme et mes beaux enfants, des maisons, j’aurais des biens matériels, »
Nous soulignons que l’objectif de cette séance était atteint d’une part du fait que sur les deux symptômes qui ont fait objet de travail, l’un a été réduit sur le champ et l’autre a resté dans une persistance : « l’évitement social » parce qu’il continuait à avoir peur de se mettre en relation et passer du temps avec ses amis à l’exception de nous en qui, il avait pu faire confiance.
8ème séance
Objectif : Pour cette cinquième séance psychothérapeutique, l’objectif était d’amener le patient à faire confiance à ses amis, bref, diminuer ses évitements sociaux.
Date et Heure : Le 16 mars 2025 à 15 h 20’
Nous avons administré un questionnaire avant l’exposition ou l’activité principale du jour, pour vérifier la diminution réelle ou la persistance de symptômes traités précédemment. Nous nous sommes rendu compte que le traitement avait des effets positifs sur lesdits symptômes. Appart le questionnaire nous avons également vérifié cela par une simple observation basée sur un entretien interactif qui a été appuyé par une série de questions qui visent également à mesurer la présence ou la disparition totale desdits symptômes.
Nous avons au cours de cette séance exposé notre patient au espace vert en une durée de 30 minutes avec participation et paroles de motivations. Nous avons après la séance proposée au patient d’aller rendre visite à l’un de ses amis de la place ; nous sommes partis sans hésitation très content et heureux de faire cette visite surtout en du fait qu’il été accompagné par nous. L’objectif de cette séance a été atteint, car notre patient arrivait maintenant à s’ouvrir à la société (rendre visite ses amis, aller à l’église, à son lieu de travail).
9ème séance
Objectif : l’objectif post exposition de diminuer le symptôme du manque d’appétit
Date et heure : Le 18 Mars 2025 à 15 h 5 ‘
Nous avons commencé cette sixième séance psychothérapeutique par remonter plus la morale du patient en procédant par un entretien interactif basé sur le partage de quelques histoires des gens qui ont subi les mêmes situations et ont vaincu, notre objectif dans cette étape était pratiquement d’amener le patient à développer une résilience face à sa situation présente.
Nous nous sommes fixé l’objectif post exposition de diminuer le symptôme du manque d’appétit, en lui donnant premièrement des conséquences sur le fait de laisser sciemment la nourriture, parce que nous nous sommes rendu compte que c’est sans atteinte organique que monsieur Daniel pouvait abandonner par son propre gré la nourriture soit disant qu’il n’avait pas d’appétit.
Nous avons exposé le patient pendent une durée de 30 minutes en lui soumettant également aux paroles du bien fait de la prise ou la consommation normale de la nourriture et après la séance nous avons fait un entretien en lui posant des questions sur ce qu’il aime manger ou consommer, nous lui avons même soumis à des images, vidéos des très bonnes cuissons dans le but de provoquer en lui le goût permanant de la consommation de la nourriture et nous lui avons propos de mieux ou tout faire pour consommer la plus bonne quantité possible de la nourriture, le patient était motivé disant qu’il ira exécuter cela. Nous avons bel et bien vérifié l’atteinte de notre objectif à la prochaine séance.
10ème séance
Objectif : l’objectif d’identifier réellement l’impact des espaces verts sur la réduction d’au moins tous les symptômes de manière générale.
Date et Heure : Le 21 Mars 2025 à 14 h 10’
Cette septième séance et celle qui a mis fin à notre intervention thérapeutique du patient DANIEL NGOY, nous avons fixé l’objectif d’identifier réellement l’impact des espaces verts sur la réduction d’au moins tous les symptômes de manière générale.
Nous avons exposé le patient aux espaces verts pendent une durée de 30 minutes en accompagnant un aspect des paroles de motivations.
Nous avons après la séance soumis le patient DANIEL NGOY à l’échelé de
dépression de Hamilton ce dernier a montré ce qui suit :
Les résultats ont montré la diminution progressive ou absence des symptômes suivants :
L’humeur dépressif
Sentiments de culpabilité
Les idées suicidaires
Les insomnies
L’état de détresse
Manque d’intérêt dans les activités quotidiennes
Ralentissement dans le langage
Agitation
Anxiété
Prise de conscience
Le résultat de cette échelle a montré un seuil moins grave ou léger de la dépression.
Ces activités ont marqué la fin de notre intervention et accompagnement du point de vue exposition, mais les visites continuent jusqu’à lors pour nous éviter les rechutes et l’aider à développer facilement une résilience.
3.1.3.2. L’intervention thérapeutique avec le patient THIERRY SAMBA
L’objectif de cette intervention s’inscrit également dans la logique telle qu’annoncée par notre étude dans sa partie d’objectifs : identifier, décrire et déterminer, l’impact qu’a les espaces verts sur la réduction des symptômes dépressifs, et Approuver l’utilisation des espaces verts comme approche thérapeutique en cas de dépression. Nous avons pu amener le patient THIERRY vers un état acceptable ou alors un état d’amélioration basée sur une réduction successive des symptômes de dépression.
Nous soulignons ici que nous avons procédé de la même manière avec notre deuxième patient que le patient précèdent et cela s’est effectué pendant 10 séances : trois séances de simples entretiens, observations et de prise de contact et d’un examen psychologiques et 6 autres d’exposition aux espaces pour dire (des séances thérapeutiques) voici la description détaillée de chacune d’elle :
1ère Séance :
Objectif : Prise de contact avec le patient
Date et heure : Le 25 mars 2025 à 14 h 00’
Dans la toute première séance, il s’agissait de prendre contact et d’établir une relation de confiance basée sur la thérapie ou le traitement de son problème et aussi avoir son libre consentement à participer à cette expérimentation thérapeutique. Comme dans son anamnèse telle décrite dans les parties précédentes, le patient Thierry a été amené et conscientisé par ses proches (sa maman) de pouvoir chercher un psychologue qui pouvait l’accompagner et que cela coïncidait avec notre moment d’investigation basée sur la mesure de l’impact d’une approche ou technique psychothérapeutique basée sur l’exposition aux espaces verts. Et c’est ainsi que nous avons gagné la confiance de monsieur Thierry à participer à cette prise en soin.
Au cours de notre entretien avec le patient, il nous a présenté ses identités par une série des questions qu’on lui posait progressivement, et il nous a en même temps fournis les informations sur sa maladie qui ont constituées l’histoire de sa maladie.
Cette séance avait comme objectif de récolter les informations sur le patient au travers une observation clinique et un questionnaire. Elle nous a permis donc de récolter toutes les informations possibles sur sa personne et un briefing de sa maladie avant les interventions formelles thérapeutiques.
2ème séance
Objectif : Etablissement du diagnostic provisoire
Date et heure : Le 27 mars 2025 à 14 h’
Dans cette séance l’objectif était de pouvoir établir un diagnostic provisoire ou hypothèque, basée sur des simples observations cliniques et bien l’histoire ou anamnèse de la maladie du patient.
Nous avons au travers ces moyens conclus hypothétiquement qu’il s’agissait d’une dépression sans détermination préalable vue les informations assez limitées (simples observations et histoire de la maladie)
3ème séance
Objectif : Compréhension de la situation réelle du patient
Date et heure : le 31 Mars 2025 à 14 h 30’
Cette séance s’est assignée comme objectif, mieux comprendre la situation présente du patient dans le but de pouvoir diagnostiquer de manière systématique au travers des instruments ou tests standardisés comme : l’inventaire abrégé de dépression de BECK (13 ITEMS) le problème réel du patient.
Nous avons soumis notre patient à une série des questions visant à comprendre réellement sa situation et cela nous a révélé des éléments comme : manque de confiance en soi, perte d’intérêt, les perturbations de sommeil ou alors, les insomnies répétées et des pensées ou idées suicidaires.
Nous avons également soumis le patient au test de mesure de dépression (inventaire abrégé de dépression de BECK) ce dernier nous a révélé une dépression sévère car le seuil s’élevait au rang de 16 point et plus.
Et bien départ les résultats de ces instruments, nous avons conclu
systématiquement que notre patient souffrait d’une dépression au seuil le plus sévère.
Nous soulignons que les 3 premières séances consistaient à récolter les informations sur le patient. Et bien comme thérapie proposée se basait sur une psychothérapie qui se centrait sur l’exposition aux espaces verts accompagnée d’un soutient motivationnel sur sa situation dans le but de voir comment les espaces verts impacteraient sur les symptômes dépressifs. Et bien nous présentons donc ici et dans les lignes qui suivent la description détaillée des processus par lesquels nous sommes passés pendent les séances pré et post exposition.
4ème Séance
Objectif : Mesure de son état dépressif
Date et Heure : Le 5 Avril 2025 à 15 h 20’
A notre première séance d’exposition ou psychothérapeutique, de Monsieur
THIERRY, nous avons commencé de prime abord par lui donner quelques paroles de motivation puis nous lui avons soumis à l’échelle de mesure de dépression d’Hamilton dans le but de nous rassurer du niveau de dépression, cette dernière a indiqué une dépression sévère. Nous lui avons exposé aux espaces verts pendent une durée de 30 Minutes tout en étant à ses côtés pour l’observer et lui motiver à accepter la situation et prendre courage).
Nous avons juste après l’exposition soumis également Monsieur THIERRY à un questionnaire qui retrace les objectifs et hypothèses de notre étude, le questionnaire nous a révélé aucun changement du point de vue diminution de son état dépressif. Et bien à cette première séance rien n’a été signalé en terme des résultats positifs.
5ème séance
Objectif : identifier l’impact des espaces vert sur les symptômes spécifiques, que nous citons ici en ces termes : manque de joie ou perte d’intérêt dans ses activités quotidiennes, les insomnies répétitives.
Date et heure : Le 7 Avril 2025 à 15 h 30’
L’objectif de cette séance deuxième séance psychothérapeutique, était de pouvoir identifier l’impact des espaces vert sur les symptômes spécifiques, que nous citons ici en ces termes : manque de joie ou perte d’intérêt dans ses activités quotidiennes, les insomnies répétitives.
Avant la séance, nous lui avons soumis à l’échelle de mesure de dépression d’Hamilton, cette échelle a montré toujours une dépression sévère. Nous lui avons soumis quelques paroles de motivations sur sa situation, et lui avons exposé aux espaces verts également pour une durée de 30 minutes tout en étant toujours à ses côtés pour observation et accompagnement et suggestion des quelques mots de motivation et de détente de sa mémoire ou pensées.
Nous avons observé à la fin de la séance que Monsieur THIERRY SAMBA était très joyeux.
Et bien pour nous rassurer de la sévérité de son état dépressif, nous lui avons soumis encore à l’échelle d’Hamilton qui nous a montré une diminution plus progressive.
6ème Séance
Objectif : Vérification de la diminution des symptômes…
Date et Heure : Le 9 Avril 2025 à 14 H 15’
Cette troisième séance psychothérapeutique avait comme objectif de vérifier la diminution des symptômes suivants : Humeur dépressive, perte d’appétit, fatigue ou perte d’énergie, sentiments de dévalorisation ou de culpabilité excessive.
Nous avons posé quelques questions de curiosité visant à vérifier les bienfaits de la précédente séance, nous nous sommes rendu compte que le patient THIERRY avait changé de manière un peu plus progressive du fait certaines manifestations n’avaient plus place.
Nous avons exposé Monsieur THIERRY SAMBA aux espaces verts en lui donnant une instruction selon laquelle : cette séance ne prendra que 30 minutes. A la fin de cette exposition, nous lui avons soumis à l’échelle d’Hamilton et bien évidemment cette dernière nous a amené à un état dépressif léger, et nous avons vu sur le champ : un état de courage, de sérénité, qui s’est installé, les effets sur sa culpabilité, manque d’énergie et bien une section précise des symptômes diminuer.
7ème séances
Objectif : Réduction de symptômes particuliers…
Date et Heure : Le 11 avril 2025 à 15 h’
Dans cette quatrième séance psychothérapeutique, nous nous sommes fixé comme objectif de réduire deux symptômes plus dominants : les idées de désespoir, évitement social.
Nous avons de prime abord soumis notre patient à un questionnaire qui vérifie de manière rapide l’état ou le niveau de sa dépression en nous focalisant sur les symptômes qui ont fait objet de disparition ou de réduction suite aux expositions précédentes. Nous nous sommes rendu compte que lesdits symptômes n’ont pas été identifiés ou observés en terme de manifestation, il s’agit de : l’humeur dépressif, la perte d’intérêt.
Nous avons exposé notre patient aux espaces vers pendent une durée de 30 minutes, tout en l’accompagnant de manière participative et interactive en échange des paroles motivationnelles sur les bien fais du bien être en société, avec les amis dans le but de booster sa capacité à ne pas éviter son social (amis, église, lieu de travail), nous avons fait mention aussi des paroles de motivation sur le fait que son morale remonte et qu’il n’ait pas un désespoir total.
En fin de séance nous avons fait entretien qui a tourné au tour de ces deux symptômes susmentionnés dans le paragraphe précédent. Nous nous sommes rendu compte que la morale du patient avait changé de camp ce qui veut dire cela lui a ramené à d’un état de désespoir à celui d’espoir à un avenir encore meilleur, cela s’est observé au travers ses dires et bien ceci a été également pareil chez le patient précédent (monsieur DANIEL NGOY)
« : je suis très joyeux et j’espère à mon futur, j’aurais ma femme et mes beaux enfants, des maisons, j’aurais des biens matériels, j’aurai un bon travail et je paierai des véhicules, je construirai des maisons de mon choix et mon gout »
Nous soulignons que l’objectif de cette séance était atteint d’une part du fait que sur les deux symptômes qui ont fait objet de travail, l’un a été réduit sur le champ et l’autre a resté dans une persistance : « l’évitement social » parce qu’il continuait à avoir peur d’aller à l’Eglise, chercher ou se mettre en couple, passer du temps avec ses amis, et même ses proches.
8ème séance
Objectif : Amener le patient à faire confiance à son monde social
Date et heure : Le 13 avril 2025 à 15 h’
Pour cette cinquième séance psychothérapeutique, l’objectif était d’amener le patient à faire confiance à ses amis, bref, diminuer ses évitements sociaux.
Nous avons administré un questionnaire avant l’exposition ou l’activité principale du jour, pour vérifier la diminution réelle ou la persistance de symptômes traités précédemment. Nous nous sommes rendu compte que le traitement avait des effets positifs sur lesdits symptômes. Appart le questionnaire, nous avons également vérifié cela par une simple observation basée sur un entretien interactif qui a été appuyé par une série de questions qui visaient également à mesurer la présence ou la disparition totale ou progressive desdits symptômes.
Nous avons au cours de cette séance exposé notre patient au espace vert en une durée de 30 minutes avec participation et paroles de motivations. L’objectif de cette séance a été atteint, car notre patient arrivait maintenant à s’ouvrir à la société (rendre visite ses amis, aller à l’église,).
9ème séance
Objectif : Développement de la résilience
Date et heure : Le 17 Avril 2025 à 15 h 0’
Nous avons commencé cette sixième séance psychothérapeutique par remonter plus la morale du patient en procédant par un entretien interactif basé sur le partage de quelques histoires des gens qui ont subi les mêmes situations et ont vaincu, notre objectif dans cette étape était pratiquement d’amener le patient à développer une résilience face à sa situation présente.
Nous nous sommes fixé l’objectif post exposition de diminuer le symptôme du manque d’appétit, en lui donnant premièrement des conséquences sur le fait de laisser sciemment la nourriture, parce que nous nous sommes rendu compte que c’est sans atteinte organique que monsieur THIERRY SAMBA pouvait abandonner par son propre gré la nourriture.
Nous avons exposé le patient pendent une durée de 30 minutes en lui soumettant également aux paroles du bien fait de la prise ou la consommation normale de la nourriture et après la séance nous avons fait un entretien en lui posant des questions sur ce qu’il aime manger ou consommer, nous lui avons même soumis à des images, vidéos des très bonnes cuissons dans le but de provoquer en lui le goût permanant de la consommation de la nourriture et nous lui avons proposé de mieux ou tout faire pour consommer la plus bonne quantité possible de la nourriture, le patient était motivé. Nous avons bel et bien vérifié l’atteinte de notre objectif à la prochaine séance.
10ème séance
Objectif : Identification intacte de l’impact de notre intervention par l’exposition
Date et heure : Le 20 Avril 2025 à 15 h’
Cette septième séance et celle qui a mis fin à notre intervention thérapeutique du patient THIERRY SAMBA, nous avons fixé l’objectif d’identifier réellement l’impact des espaces verts sur la réduction d’au moins tous les symptômes de manière générale.
Nous avons exposé le patient aux espaces verts pendent une durée de 30 minutes en ajoutant un aspect des paroles de motivations.
Nous avons après la séance soumis le patient THIERRY SAMBA à l’échelé de dépression de Hamilton.Les résultats ont montré la diminution totale ou absence des symptômes suivants :
L’humeur dépressif
Sentiments de culpabilité
Les idées suicidaires
Les insomnies
L’état de détresse
Manque d’intérêt dans les activités quotidiennes
Ralentissement dans le langage
Agitation
Anxiété
Prise de conscience
Le désespoir
Le résultat de cette échelle a montré un seuil moins grave ou léger de la dépression.
Ces activités ont marqué la fin de notre intervention et accompagnement du point de vue exposition des tous nos deux patients, mais nous soulignons que les visites continuent en terme d’accompagnement jusqu’à lors pour nous éviter les rechutes et l’aider à développer facilement une résilience. Et bien nous voudrions signifier par ce paragraphe que la diminution de symptômes de dépression au travers l’exposition au espaces verts qui s’accompagne des entretiens ou paroles ou même ou thérapie motivationnelle ne s’effectue de manière rapide c’est d’une manière plus progressive que cela s’effectue. Et la persistance ou un suivi longitudinale st souhaité.
3.2. INTERPRETATION DES RESULTATS
Il est crucial pendent l’élaboration d’un rapport de recherche scientifique de passer à l’étape d’interprétation ou de la mise au claire ou alors de la mise en état compréhensif et plus accessible du phénomène étudier au travers différentes théories explicatives.
Nous rappelons que cette étude s’était assignée comme objectifs d’une part : d’Identifier, de Décrire et de Déterminer l’impact qu’a les espaces verts sur la réduction des symptômes dépressifs chez les jeunes adultes dont l’âge varie entre18-30 ans vivants dans le quartier Kassapa ; et d’autres part : d’Approuver l’utilisation des espaces verts comme approche thérapeutique en cas de dépression.
L’analyse fonctionnelle par la grille de SORC, la situation de dépression de Monsieur DANIEL NGOY, révèle que cet état dépressif est principalement déclenché par des simili externes liés à ses ruptures répétées des relations amoureuses et ces simili étant renforcés par les facteurs internes : ses sensations d’un vide interne, le manque de confiance en l’amour, les pensées d’auto dévalorisation, les pensées sombres « ça ne sert à rien de continuer », cela influence fortement ses réactions ou réponses comportementales qui se caractérisent par : Se trouver un boulot pour oublier, éviter ses amis et maquer le travail sans justification, passer du temps enfermé dans la chambre, cessation de prendre soin de lui ou de se laver, planification d’un acte suicidaire. Ces facteurs donnent naissance aux multiples conséquences telles que : le repli sur soi, perte de confiance en ses jugements, peur du lien affectif, l’insomnie, la perte d’appétit, difficulté de concentration, pleurs fréquents, pensées d’auto dévalorisation. Isolement social, la perte de poids.
L’analyse fonctionnelle par la grille de SOTC révèle que la situation dépressive de Monsieur THIERRY SAMBA, s’explique par des facteurs déclenchants : long parcours d’attente, de frustrations et d’échecs dans ses recherches d’emploi, les ruptures ou déceptions amoureuses répétées. Ceci impacte de manière négative les états cognitifs, affectifs et comportementaux du patient. Et bien cela lui ramènent aux conséquences telles que : manque d’énergie ou épuisement constant, perte d’appétit, troubles de sommeil, sentiment de rejet trouble de l’humeur.
Nos deux patients ont consulté pour des troubles dépressifs ou de l’humeur :
Plaintes d’un état de tristesse intense, des idées de désespoir et un isolement progressif qu’il attribue à « une série de trahisons sentimentales pour le patient DANIEL NGOY, et plaintes des troubles de l’humeur persistants, une fatigue inexpliquée, un retrait social marqué, des troubles du sommeil, et un désintérêt dans les activités de la vie quotidienne pour le patient THIERRY SAMBA, leurs tableaux cliniques primaires présentaient de niveau de sévérité des états dépressifs.
Les résultats de cette étude montrent que les jeunes adultes ayant un accès fréquent aux espaces verts rapportent des niveaux significativement plus faibles de symptômes dépressifs par rapport à ceux ayant ou pas d’accès aux espaces verts.
Dans cette étude les résulte obtenus par le moyen de l’exposition aux espaces verts en une étroite association des aspects motivationnels, ce qui veut dire la motivation basée sur la parole de consolation ou de motivation au prêt du patient. Nous avons constaté une réduction progressive des symptômes tels que : « L’humeur dépressif, Sentiments de culpabilité, Les idées suicidaires, Les insomnies, L’état de détresse, Manque d’intérêt dans les activités quotidiennes, Ralentissement dans le langage, Agitation, Anxiété, Prise de conscience, Le désespoir. »
L’exposition régulière aux espaces verts semble jouer un rôle protecteur contre les troubles dépressifs, possiblement en favorisant la détente, le courage et les interactions ou non évitement des interactions sociaux.
Les résultats de cette étude approuvent que les espaces verts ont de l’impact sur l’humeur dépressive, ce qui s’oriente vers les aspects de la théorie de la restauration de l’attention développée par Kaplan Rachelle et Kaplan Stéphane (1989), qui suggère que les environnements naturels aident à restaurer les ressources attentionnelles épuisées, ils réduisent la fatigue mentale, la nature améliore l’humeur et diminue les symptômes dépressifs.
Une étude de Berman et al. (2008) a montré que les individus qui marchaient
dans un parc avaient une meilleure capacité attentionnelle et un bienêtre accru par rapport à ceux qui marchaient en milieu urbain.
Cette étude révèle que les espaces ont de l’impact de manière progressive des symptômes anxio-depressifs ; cela s’oriente vers ce qu’explicite la théorie de la réduction du stress développée par Ulrich (1991) qui propose et explique que la nature a un effet physiologique direct sur la réduction du stress. Selon cette théorie, l’exposition aux espaces verts active des mécanismes de relaxation automatique et réduit la production de cortisol, hormone du stress. Une diminution du stress contribue à une baisse des symptômes anxieux et dépressifs (Ulrich et al., 1991).
La théorie de la biophilie développée par Wilson postule que les humains ont une affinité innée pour la nature, héritée de l’évolution. Cette connexion instinctive aux environnements naturels favorise le bien-être psychologique. Le contact avec la nature stimule des émotions positives et réduit les pensées négatives répétitives, un facteur clé dans la dépression (Kellert & Wilson, 1993).
Et cette étude au travers ses résultats a montré une diminution progressive des idées ou pensées suicidaires qui s’alignent ou font parties des idées négatives que peut contenir les aspects cognitifs de l’individu.
Dans cette étude nous avons identifié que l’exposition aux espaces verts aurait
un impact sur la réduction progressive du retrait ou isolement ou même évitement social en cas de dépression ce qui s’alignent sur ce qu’approuve la théorie de la cohésion sociale qui stipule que : les espaces verts favorisent les interactions sociales et renforcent le sentiment de communauté, ce qui joue un rôle clé dans la prévention de la dépression (Kuo & Sullivan, 2001).
Maas et al en 2009, suggèrent qu’un accès facilité aux espaces verts est associé à une augmentation des interactions sociales positives, réduisant ainsi l’isolement social, un facteur de risque majeur de la dépression (Maas et al., 2009).
Une étude longitudinale a montré que les jeunes adultes vivant près d’espaces verts développaient un meilleur réseau de soutien social, facteur protecteur contre la dépression (Sugiyama et al., 2008).
Dans un quartier tel que kasappa, où les conditions des vies peuvent être
marquées par des stress socio-économiques, les espaces verts représentent un lieu important de répit mental et d’équilibre psychologique.
Nous pouvons donc dire que, cette étude suggère qu’une plus grande accessibilité aux espaces verts dans le quartier kasappa et voir même dans la ville entière contribuerait à l’atténuation des symptômes dépressifs chez les jeunes adultes. Cela souligne l’importance d’inclure l’environnement urbain dans les stratégies de promotion de la santé mentale et dans le developpement durable autravers la nature.
3.3. DISCUSSIONS DES RESULTATS
La discussion de résultat est également une étape cruciale dans un rapport de
recherche, elle vise à discuter ou confronter les résultats obtenus aux études antérieur dans le but de vérifier les hypothèses et signifier leur confirmation ou infirmation. Nous présentons ici dans les lignes qui suivent les résultats qui ont fait objet de cette étude, nous les confrontons aux études antérieures et nous signifions nos hypothèses.
Cette étude révèle que l’exposition régulière aux espaces vert a de l’impact sur la
réduction progressive des symptômes liées à la dépression. Il s’agit de :
L’humeur dépressif
Sentiments de culpabilité
Les idées suicidaires
Les insomnies
L’état de détresse
Manque d’intérêt dans les activités quotidiennes
Ralentissement dans le langage
Agitation
Anxiété
Prise de conscience
Le désespoir
Ces résultats sont approuvés également par les études suivantes :
Kaplan Rachelle et Kaplan Stéphane (1989) dans leur étude portant sur experince of nature : psychological perspective, les résultats montrent que : l’exposition à des environnements naturels a des effets positifs sur le bien-être psychologique, notamment une réduction des symptômes de stress et de dépression. L’étude a conclu que ces expériences naturelles sont cruciales pour la santé mentale, soutenant l’idée que la nature joue un rôle essentiel dans la restauration psychologique.
Ulrich, R. (1983) dans son étude portant sur : Aesthetic and affective response to natural environnements, les patients ayant une vue sur des paysages naturels présentaient des niveaux de stress significativement plus bas et des améliorations de leur humeur. Les environnements naturels peuvent avoir des effets restaurateurs sur le bien-être psychologique, contribuant ainsi à des résultats de santé plus positifs.
JULIE EMOND (AOUT 2017) dans son mémoire de maitrise présenté à l’université du QUEBEC A MONTREAL portant sur « les espaces verts urbains et leur contribution à l‘amélioration de la qualité de vie des résidents de la petite-patrie » « Les bénéfices de la végétation ou des espaces verts en ville sont nombreux (par exemple pour purifier 1’air, apaiser 1’esprit ou agir comme oasis de fraîcheur), en somme, nous concevons qu’un espace vert aménagé de manière conviviale, sécuritaire et dont la morphologie incite à des pratiques spatiales diversifiées et simultanées, encourage davantage les résidents à y accéder. Tel que nous 1’avons rappelé, la fréquentation des espaces verts a de nombreux bénéfices sur la qualité de vie des gens, notamment pour l’atténuation des effets des îlots de chaleur urbains, la diminution du stress et l’augmentation des opportunités d ‘activité physique. »
Sandrine MANUSSET Décembre 2012 dans son article qui porte sur « Impacts psycho-sociaux des espaces verts dans les espaces urbains. « Les impacts psychosociaux que nous retenons de notre étude sont au nombre de trois : ils répondent à la très forte attente de nature des habitants, les espaces verts se révèlent porteurs des dynamiques sociales qui permettent de soutenir la cohésion sociale d’un quartier ; ce qui renvoient finalement à la relation cognitive que chacun de nous entretient avec le végétal et qui est une source fondamentale de santé mentale et donc de bien-être. »,
« S’appuyant sur l’exploitation de bases de données de santé publique, Maas (2008) cité par Sandrine MANUSSET a démontré que les taux de dépression sont 1,33 fois supérieurs dans les zones avec peu d’espaces naturels. Selon la même étude, les habitants en présence d’espaces naturels dans un rayon d’un kilomètre autour de leur habitation se sentent plus en forme et ont moins d’épisodes morbides. »
![]() VERIFICATION DES HYPOTHESES
VERIFICATION DES HYPOTHESES
HYPOTHESE 1 : Notre première hypothèse stipulait que : « Les espaces verts auraient un impact positif sur la dépression en diminuant respectivement les symptômes suivants : la perte d’intérêt, la fatigue ou la perte d’énergie, l’insomnie, la culpabilité, le sentiment de dévalorisation, les difficultés à penser ou à prendre de décision, … brefs ils apporteront un bien être chez les victimes (une sérénité), la prise de courage. »
Cette hypothèse est bien confirmée du fait qu’elle a été vérifiée et les résultats retracent de manière explicite notre hypothèse.
HYPOTHESE 2 : Oui, les espaces verts devraient être utilisés dans le domaine clinique comme approche thérapeutique en un constant repère ou concordance ou symbiose de la Thérapie cognitivo-comportementale, passant par la technique de désensibilisation systématique.
Une thérapie fait référence à une prise en soin qui apporte ou pas du bien fait, mais dans le sens clinique ce terme est pris beaucoup plus dans son sens positif qui vise à apporter un bien être.
Notre deuxième hypothèse stipule qu’on devrait utiliser les espaces comme thérapie. Nous avons confirmé cette hypothèse par le trébuchement de nos résultats qui sont plus positifs dans le sens où les espaces verts qui ont fait objet primaire de cette étude ont apporté un impact positif ou du bien être sur la réduction des symptômes dépressifs.
Ceci s’aligne sur ce qu’approuvent les recherches suivantes :
Depuis les années 80, des praticiens reconnaissent et utilisent cet effet des plantes sur l’homme, à titre thérapeutique. Aux États-Unis, les travaux de Roger Ulrich (1983, 2002) cité par Sandrine MANUSSET en 2012 sont une référence notoire sur l’effet thérapeutique des jardins dans les hôpitaux et les prisons par l’effet relaxant du végétal sur les patients qui à la fois supportent mieux les Impacts psycho-sociaux des espaces verts dans les espaces urbains, le développement durable et territoires, traitements et présentent un état mental plus favorable conduisant à une accélération de la convalescence.
En France, L’ethnologue Anne Monjaret (2010) a étudié le rôle des végétaux dans les hôpitaux parisiens sous un aspect thérapeutique et de moyen d’accompagner la convalescence des malades, qu’au maintien de la cohésion des équipes médicales.
Au vue des aspects décrit peu dessus, nous pouvons donc dire que les espaces verts devraient être utilisé comme approche psychothérapeutique en cas de dépression. Dans le quartier Kassapa, caractérisé par une urbanisation rapide et des infrastructures limitées, les espaces verts peuvent jouer un rôle crucial comme lieux de détente, d’interaction sociale et de régulation émotionnelle, surtout pour les jeunes adultes confrontés à l’insécurité de l’emploi et au stress urbain.
FORCES ET LIMITES DE L’ETUDE
Points forts
Cette étude, bien qu’elle contient des limites elle contient d’une part des points fort nous pouvons citer donc :
- Cible d’étude (cas) Notre étude de prime abord a ciblé un groupe (2 cas) des
jeunes adultes vulnérables ou victimes de dépression qui est un trouble qui s’observe chez la plupart ou différentes tranches d’Age auxquelles certaines études se focalisent, mais quant à la nôtre elle s’est focalisée sur les états dépressifs des jeunes adultes dont l’âge varie entre 18 et 30 ans.
- Pertinence contextuelle : Cette étude apporte des données cliniques sur des
approches purement thérapeutiques basées sur l’exposition aux espaces verts dans un contexte particulier qui est celui de la République démocratique du Congo dans la province du haut-Katanga, ville de Lubumbashi et quartier Kassapa chez les jeunes adultes en proie des troubles dépressifs majeures ou sévères.
- Illustration clinique détaillée : la présentation des séances pré, in et post
exposition ou alors des séances des déroulements des interventions thérapeutiques au prêt de nos deux patients apporte une illustration concrète et détaille qui serve de lignes des conduites en termes d’élaboration ou de rédaction des futures rapports recherches dans les aspects du point de vue compréhension clinique des cas et élaboration des rapports scientifiques.
- Applicabilité : Et bien cette étude dans ses aspects procédures ou moyens ou
même alors techniques d’intervention outre les espaces verts il y a lieu de mentionner ici la présence des aspects motivationnels basés sur l’adhésion ou addition des paroles des motivations qui ont soutenues cette démarche psychothérapeutique.
![]() Limites
Limites
La présente étude comprend également des limites, nous soulignons ; bien qu’elle
peut renfermer tant d’autres limites qu’on ne sait à notre niveau dénicher, nous mettons en évidence ici les deux grandes limites que cette étude renferme, il s’agit du/de :
- Biais du chercheur : En tant que chercheur, il y a risque et possibilité qu’il y
est du biais soit dans l’usage des techniques ou encore dans l’interprétation des résultats.
- La causalité : Cette étude ne montre pas les facteurs des causalités du
phénomène étudié bien que quelques parts dans les anamnèses de maladies de nos deux patients montrent des facteurs déclenchants ou même des causalités.
3.4. CONTRIBUTION SCIENTIFIQUE
Nous épargnons les détails et littératures inutiles. D’emblée, en guise de
contribution scientifique de cette étude, nous disons que les résultats de cette étude contribuent à l’évolution scientifique des recherches en psychologie clinique en se basant sur ses aspects thérapeutiques. Il apporte dans une certaine mesure une approche thérapeutique de dépression basée sur l’exposition aux espaces verts accompagné d’un aspect motivationnel. Du point de vue déroulement ou séances d’intervention psychothérapeutiques cela est en quelque sorte une illustration de la part des futurs chercheurs, quant à la manière de se prendre ou simplement de la méthodologie ou la démarche méthodologique dans les recherches scientifiques en psychologie cliniques.
Par ce schéma, nous montrons que la dépression est un trouble qui se traite par
plusieurs moyens thérapeutiques, particulièrement pour cette étude un autre type ou moyen de traitement est mis en place qui va premièrement de l’identification et étude des facteurs étiologiques, puis la symptomatologie, le diagnostic enfin une psychothérapie basée sur l’exposition aux espaces verts de la victime appuyée également par les entretiens motivationnels.
Grosssomo pour conclure, la dépression est un trouble curable par la psychologie
clinique, ce travail renferme les résultats d’une étude exploratoire, qui s’est orientée dans le domaine de la psychopathologie et la psychologie clinique, en s’assignant come thème ; exposition aux espaces verts et réduction des symptômes dépressifs.
Comme toute autre étude, elle s’est servi d’une triangulation méthodologique ce qui veut dire : l’utilisation de deux ou plusieurs méthodes dans une recherche scientifique. Nous avons utilisé la méthode d’études des cas et la méthode clinique qui se sont appréhendées au travers les techniques : l’observation clinique, l’entretien, les questionnaires, l’analyse des contenus, l’échelle de mesure de dépression de Hamilton, l’inventaire de dépression de Beck (13 Items), l’analyse fonctionnelle SORC et l’analyse fonctionnelle de cercles vicieux.
Cette étude est partie des questions principales suivantes qui formulent la problématique :
Question 1. Quel est l’impact des espaces verts sur la réduction des
symptômes dépressifs ?
![]() Question 2. Faudra-t-il utiliser les espaces verts comme approche
Question 2. Faudra-t-il utiliser les espaces verts comme approche
thérapeutique en cas de dépression ?
Les réponses provisoires à ces questions sont les suivantes : HYPOTHESE 1 : Les espaces verts auraient un impact positif sur la dépression en diminuant respectivement les symptômes suivants : la perte d’intérêt, la fatigue ou la perte d’énergie, l’insomnie, la culpabilité, le sentiment de dévalorisation, les difficultés à penser ou à prendre de décision,
… brefs ils apporteront un bien être chez les victimes (une sérénité), la prise de courage. HYPOTHESE 2 : Les espaces verts devraient être utilisés dans le domaine clinique comme approche thérapeutique en un constant repère ou concordance ou symbiose de la Thérapie cognitivo-comportementale, passant par la technique de désensibilisation systématique.
Pour ce faire elle s’est assignée comme objectifs, d‘une part : Identifier, Décrire et déterminer, l’impact qu’a les espaces verts sur la réduction des symptômes dépressifs ; et d’autres part : Approuver l’utilisation des espaces verts comme approche thérapeutique en cas de dépression.
A l’issu d’analyse et interprétation des résultats, nous nous sommes rendu compte que les espaces verts appliqués comme stratégie psychothérapeutique ont de l’impact sur la réduction des symptômes de la dépression, ils réduisent respectivement les symptômes suivants :
L’humeur dépressif
Sentiments de culpabilité
Les idées suicidaires
Les insomnies
L’état de détresse
Manque d’intérêt dans les activités quotidiennes
Ralentissement dans le langage
Agitation
Anxiété
Prise de conscience
Le désespoir
Nous soulignons que cette recherche est le fruit d’une prise en charge
caractérisée par une répétition ou constance en termes d’intervention. C’est la raison pour laquelle en tant qu’étude des cas, l’aspect longitudinal est plus souhaité dans ce cadre. Nous avons effectué notre intervention en une période de 8 semaines pour dire simplement deux mois, parce que le premier mois a servi à accompagner le premier cas et le deuxième mois consacré tout entier l’accompagnement du deuxième cas.
Nous restons entièrement ouverts aux critiques et reproches des lecteurs ou
scientifiques à cette étude sur différents aspects non pris en compte ou qui nous échappé.
BIBLIOGRAPHIE
American Psychiatric Association. (2015). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders: DSM-5-TR. Arlington: American Psychiatric Publishing
Bardin, L. (1977). L’analyse de contenu. Paris : Presse Universitaire de France (PUF).
Barton, J., & Pretty, J. (2010). What is the best dose of nature and green exercise for improving mental health?
Environmental Science & Technology,.
Beauvais, C., & Lemoine, L. (2001). La recherche en pédagogie : une approche critique. Éditions du Cèdre
Beck, A. T., Ward, C. H., Mendelson, M., Mock, J., & Erbaugh, J. (1961). An Inventory for Measuring Depression.
Archives of General Psychiatry,
Beck, A. T., Steer, R. A., & Brown, G. K. (1996). Manual for the Beck Depression Inventory–II. Psychological Corporation
Berman, M. G., Jonides, J., & Kaplan, S. (2008). The cognitive benefits of interacting with nature. Psychological Science.
Blanchet, A., & Gotman, A. (2010). L’entretien (5e éd.). Armand Colin.
Bourque, P., & Beaudette, D. (1982). Étude psychométrique du questionnaire de dépression de
Beck auprès d’un échantillon d’étudiants universitaires francophones. Revue canadienne des sciences du comportement,
Bratman, G. N., Hamilton, J. P., & Daily, G. C. (2015). The impacts of nature experience on human cognitive function and mental health.
Annals of the New York Academy of Sciences,
Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology.
Caron, J. (1996). Une validation de l’échelle de dépression de Beck dans une population non clinique.
Santé mentale au Québec, 21(2), 447–468
Cicchelie, C. M., et al. (2001).
Les jeunes adultes, un débat scientifique et politique en France.
Clergeau, P. (2007). Une écologie du paysage urbain. Éditions Apogée
Collet, L., & Cottraux, J. (1986). Inventaire de dépression de Beck (BDI). L’Encéphale
Devereux, G. (1967). De l’angoisse à la méthode dans les sciences du comportement. Flammarion161616.
Dolto, F. (1985).
La cause des enfants..
Emond, J. (2017). Les espaces verts urbains et leur contribution à l’amélioration de la qualité de vie des résidents de la petite-patrie. (Mémoire de maîtrise). Université du Québec à Montréal.
Hempel, C. (2012). Éléments d’Épistémologie. p. 151-174
Jean-Pierre Aistolf and Call (2008). Mots-clés de la Didactique des Sciences. p. 23-33.
Jung, C. G. (1921). Psychologische Typen in œuvres complètes (CW6). Paris : Buchet-Chaste
Kaës, R. (1992). Le cas et la construction du cas en clinique. In Clinique et théorie psychanalytique. Dunod.
Kambulu Nshimba, J. (2020). Initiation ç la recherche scientifique. (Cours inédit). Université de Lubumbashi, Faculté de Psychologie et des sciences de l’éducation.
Kambulu Nshimba, J. (2025). Séminaires scientifiques en psychologie. Université de Lubumbashi, Faculté de Psychologie (Triangulation : Utilisation de deux ou plusieurs méthodes dans une recherche scientifique).
Kaplan, R., & Kaplan, S. (1989). Experience of nature: psychological perspective. Cambridge University Press.
Kaplan, S. (1995). The restorative benefits of nature: Toward an integrative framework. Journal of Environmental Psychology, 15(3), 169-182.
Kasongo Bwanagabo, O. (2022-2023). Le traumatisme psychique et vécu psychosocial. (TFC).
UNILU, Faculté de psychologie et des sciences de l’éducation.
Kazadi Ndjibu, A. (s.d.). Vécu psychosocial du phénomène Kidnapping. (Mémoire de recherche).
UNILU, Faculté de psychologie et des sciences de l’éducation.
Kellert, S. R., & Wilson, E. O. (1993). The Biophilia Hypothesis. Island Press.
Kuo, F. E., & Sullivan, W. C. (2001). Environment and crime in the inner city: Does vegetation reduce crime?
Environment and Behavior,
Lagache, D. (1949). Méthode clinique et méthode expérimentale..
Maas, J., van Dillen, S. M., Verheij, R. A., & Groenewegen, P. P. (2009). Social contacts as a possible mechanism behind the relation between green space and health. Health & Place,
Manusset, S. (2012). Impacts psycho-sociaux des espaces verts dans les espaces urbains. openEdition Journals, pp. 1-1433.
Mayer, F. S., Frantz, C. M., Bruehlman-Senecal, E., & Dolliver, K. (2009). Why is nature beneficial? The role of connectedness to nature. Environment and Behavior, 41(5), 607-643.
Mérin, M., & Sabourin, J. (1998). La méthodologie de la recherche. Paris : Éditions Eyrolles.
Mwele, T. (2020). [Non spécifié]..
Pretty, J., Peacock, J., Sellens, M., & Griffin, M. (2005). The mental and physical health outcomes of green exercise.
International Journal of Environmental Health Research, 15(5), 319-33737.
Robert, D., & Bouillaguet, A. (1997). L’Analyse de contenu. Paris : Armand Colin
Roger, A. (1997). Court traité du paysage. Gallimard.
Stake, R. E. (2006). Multiple Case Study Analysis. Guilford Press.
Sugiyama, T., Leslie, E., Giles-Corti, B., & Owen, N. (2008). Associations of neighborhood greenness with physical and mental health: Do walking, social coherence and local social interaction explain the relationships?
Journal of Epidemiology & Community Health, 62(5), e9.
Thompson Coon, J., Boddy, K., Stein, K., Whear, R., Barton, J., & Depledge, M. H. (2011). Does participating in physical activity in outdoor natural environments have a greater effect on physical and mental wellbeing than physical activity indoors? Environmental Science & Technology,
Ulrich, R. S. (1983). Aesthetic and affective response to natural environnements. In Behavior and the Naturel Environment (pp. 85-125). New York : Plenum Press
Ulrich, R. S. (1991). Effects of interior design on wellness: Theory and recent scientific research. Journal of Health Care Interior Design,
van den Berg, A. E., Maas, J., Verheij, R. A., & Groenewegen, P. P. (2010). Green space as a buffer between stressful life events and health. Social Science & Medicine, pp. 1203-1210
White, M. P., Alcock, I., Grellier, J., Wheeler, B. W., Hartig, T., Warber, S. L., et al. (2019). Spending at least 120 minutes a week in nature is associated with good health and wellbeing. Scientific Reports, p. 7730
Wilson, E. O. (1984). Biophilia. Harvard University Press.
Yin, R. K. (2018). Case Study Research and Applications. Sage Publications.
Webographie
Dictionnaire de l’Académie française+5Larousse+5Le Dictionnaire+5 https://chu–mondor.aphp.fr/wp–
content/blogs.dir/163/files/2014/08/PSYCOM_TroublePsy_TroubleDepressifs_WEB.pdf https://chu–mondor.aphp.fr/wp
content/blogs.dir/163/files/2014/08/PSYCOM_TroublePsy_TroubleDepressifs_WEB.pdf https://chu–mondor.aphp.fr/wp–
content/blogs.dir/163/files/2014/08/PSYCOM_TroublePsy_TroubleDepressifs_WEB.pdf
Wikipédia, l’encyclopédie libre
TABLE DES MATIERES
EPIGRAPHE……………………………………………………………………………………………………………. I
DEDICACE…………………………………………………………………………………………………………….. II
REMERCIEMENTS……………………………………………………………………………………………….. III
SIGLES ET ABREVIATIONS…………………………………………………………………………………… V
- INTRODUCTION …………………………………………………………………………………………………………. 1
- PROBLEMATIQUE ………………………………………………………………………………………………. 1
- HYPOTHESES …………………………………………………………………………………………………………… 3
- CHOIX ET INTERETS DE L’ETUDE…………………………………………………………………….. 4
- Choix de l’étude …………………………………………………………………………………………… 4
- Intérêts du sujet …………………………………………………………………………………………… 5
- Intérêt personnel ……………………………………………………………………………………………. 5
- Intérêt scientifique ………………………………………………………………………………………….. 5
- Intérêt social …………………………………………………………………………………………………… 5
- METHODES ET TECHNIQUES DE LA RECHERCHE …………………………………………. 6
- Méthodes ………………………………………………………………………………………………………….. 6
- Techniques ……………………………………………………………………………………………………….. 6
- DELIMITATION DE L’ETUDE ………………………………………………………………………….. 7
- Délimitation temporelle …………………………………………………………………………………….. 7
- Délimitation spatiale …………………………………………………………………………………………. 7
- Délimitation Typologique ………………………………………………………………………………….. 8
- STRUCTURE DU TRAVAIL ………………………………………………………………………………. 8
CHAPITRE PREMIER ………………………………………………………………………………………………. 9 CONSIDERATIONS THEORIQUES …………………………………………………………………………….. 9
1.1. DEFINITION DES CONCEPTS …………………………………………………………………………. 9
1.1.1. Exposition ……………………………………………………………………………………………………. 9
- Réduction ………………………………………………………………………………………………….. 10
- Symptômes ………………………………………………………………………………………………… 10
- Dépressifs ………………………………………………………………………………………………….. 11
- Jeunes-Adultes …………………………………………………………………………………………… 11
1.2. LES GENERALITES SUR LE TROUBLE DEPRESSIF ……………………………………. 12
- Classification des troubles psychiques …………………………………………………………. 12
- Symptômes de troubles dépressifs ………………………………………………………………. 13
- L’origine des dépressions ……………………………………………………………………………. 13
1.3. THEORIES EXPLICATIVES DE L’ETUDE …………………………………………………….. 14
- La théorie de la restauration de l’attention (Attention Restauration Theory – ART) 14
- La théorie de la réduction du stress (Stress Reduction Theory – SRT) ……………….. 14
- La théorie de la biophilie …………………………………………………………………………………. 15
- La théorie de la cohésion sociale ………………………………………………………………………. 15
- La théorie de l’activité physique et de la régulation émotionnelle ………………………. 16
1.4. ETUDES ANTERIEURES ………………………………………………………………………………… 17
DEUXIEME CHAPITRE ………………………………………………………………………………………………… 21
CADRE METHODOLOGIQUE ……………………………………………………………………………………… 21
- Présentation du champ d’investigation …………………………………………………………….. 21
- Situation Géographique …………………………………………………………………………………… 21
- Aperçu Historique …………………………………………………………………………………………… 21
- Situation socio-économique ……………………………………………………………………………… 22
- Situation éducationnelle ………………………………………………………………………………………… 22
- Situation sanitaire ………………………………………………………………………………………………… 22
- Situation socio-culturelle …………………………………………………………………………………. 22
- Organigramme du quartier Kassapa ……………………………………………………………….. 23
- POPULATION ET ECHANTILLON DE RECHERCHE ……………………………………….. 25
- METHODES ET TECHNIQUES ………………………………………………………………………………. 26
2.3.1. Méthodes ……………………………………………………………………………………………………………….. 26
A. La méthode d’études des cas ……………………………………………………………………………………….. 26
2.3.2. Techniques …………………………………………………………………………………………………………….. 31
1. Techniques de production des donnés ……………………………………………………………………….. 31
- L’observation clinique ……………………………………………………………………………………………… 31
- L’Observation participante ……………………………………………………………………………….. 32
- L’observation armée …………………………………………………………………………………………. 32
- L’Observation participante ……………………………………………………………………………….. 32
- L’entretien……………………………………………………………………………………………………………….. 32
- L’entretien structuré ou directif ………………………………………………………………………… 33
- L’entretien non structuré ou non directif ou libre ………………………………………………. 33
- L’entretien semi-Directif …………………………………………………………………………………… 34
- L’entretien non structuré ou non directif ou libre ………………………………………………. 33
- L’entretien structuré ou directif ………………………………………………………………………… 33
- Le questionnaire ………………………………………………………………………………………………………. 35
Déroulement de construction et administration du questionnaire …………………………… 35
- L’échelle de Hamilton ……………………………………………………………………………………….. 36 Interprétation des scores (HAM-D17) : ……………………………………………………………………… 37
- L’inventaire de mesure de dépression de Beck (13 items) ……………………………………. 38
Limites : …………………………………………………………………………………………………………………… 39
- La technique documentaire ……………………………………………………………………………….. 39
2. Technique de dépouillement des données …………………………………………………………… 40
L’analyse des contenus ………………………………………………………………………………………. 40
3. Techniques de traitement de données …………………………………………………………………….. 43 a. L’analyse fonctionnelle SORC …………………………………………………………………………… 43
- LES DIFFICULTES RECONTREES …………………………………………………………………….. 47
- LES VARIABLES ET INDICATEURS ……………………………………………………………… 48
TROISIEME CHAPITRE ……………………………………………………………………………………………….. 49
PRESENTATION DES RESULTATS ……………………………………………………………………………… 49
3.1. PRESENTATION ET ANALYSE DES DONNEES (CAS) ……………………………………… 49
3.1.1. Premier Cas ……………………………………………………………………………………………………. 49
3.1.1.1. Identification du patient…………………………………………………………………………………… 49
Anamnèse : ……………………………………………………………………………………………………….. 49 Faits observés : …………………………………………………………………………………………………. 50
3.1.1.2. Tableau clinique …………………………………………………………………………………………… 51
Diagnostic :……………………………………………………………………………………………………….. 51
3.1.1.3. ANALYSE FOCTIONNELLE SELLON LA GRILLE DE SORC ……………………… 51
3.1.2. Deuxième Cas……………………………………………………………………………………………………… 52
3.1.2.1. Identification du patient…………………………………………………………………………………… 52
Anamnèse : ……………………………………………………………………………………………………….. 52 Faits observés : …………………………………………………………………………………………………. 54
3.1.2.2. Tableau clinique …………………………………………………………………………………………… 54
Diagnostic :……………………………………………………………………………………………………….. 54
3.1.2.3. ANALYSE FONCTIONNELLE SELLON LA GRILLE DE SORC …………………… 55
3.1.3. Déroulement de l’intervention thérapeutique……………………………………………………….. 55
3.1.3.1. L’intervention thérapeutique avec le patient DANIEL NGOY ……………………….. 55
Objectif :………………………………………………………………………………………………………………….. 55
1ère Séance : …………………………………………………………………………………………………………………. 56
Date et heure : Le 01 mars 2025, à 14 H’50 …………………………………………………………………… 56
2ème séance …………………………………………………………………………………………………………………… 56
3ème séance ……………………………………………………………………………………………………………….. 56
4ème Séance ……………………………………………………………………………………………………………….. 57
Objectif : Mesure de l’état dépressif ………………………………………………………………………….. 57
5ème séance ……………………………………………………………………………………………………………….. 58
Date et Heure : Le 8 Mars 2025 à 14 h 15’ …………………………………………………………………. 58
6ème Séance ……………………………………………………………………………………………………………….. 58
7ème séances ………………………………………………………………………………………………………………. 59
Date et heure : Le 13 Mars 2025 à 14 h 15’ ………………………………………………………………… 59
8ème séance ……………………………………………………………………………………………………………….. 60
Date et Heure : Le 16 mars 2025 à 15 h 20’ …………………………………………………………………. 60
9ème séance ……………………………………………………………………………………………………………….. 60
Objectif : l’objectif post exposition de diminuer le symptôme du manque d’appétit ………….. 60
Date et heure : Le 18 Mars 2025 à 15 h 5 ‘ ………………………………………………………………….. 61
10ème séance ……………………………………………………………………………………………………………… 61
3.1.3.2. L’intervention thérapeutique avec le patient THIERRY SAMBA ………………………. 62
1ère Séance : ……………………………………………………………………………………………………………… 63
Objectif : Prise de contact avec le patient ……………………………………………………………………… 63
Date et heure : Le 25 mars 2025 à 14 h 00’ ………………………………………………………………… 63
2ème séance ……………………………………………………………………………………………………………….. 63
Objectif : Etablissement du diagnostic provisoire ………………………………………………………….. 63
Date et heure : Le 27 mars 2025 à 14 h’ …………………………………………………………………….. 63
3ème séance ……………………………………………………………………………………………………………….. 64
Objectif : Compréhension de la situation réelle du patient …………………………………………. 64
Date et heure : le 31 Mars 2025 à 14 h 30’ …………………………………………………………………… 64
4ème Séance ……………………………………………………………………………………………………………….. 64
Objectif : Mesure de son état dépressif ………………………………………………………………………… 64
Date et Heure : Le 5 Avril 2025 à 15 h 20’ …………………………………………………………………. 64
5ème séance ……………………………………………………………………………………………………………….. 65
6ème Séance ……………………………………………………………………………………………………………….. 65
Objectif : Vérification de la diminution des symptômes… ………………………………………….. 65
Date et Heure : Le 9 Avril 2025 à 14 H 15’………………………………………………………………….. 66
7ème séances ………………………………………………………………………………………………………………. 66
Objectif : Réduction de symptômes particuliers… …………………………………………………….. 66
Date et Heure : Le 11 avril 2025 à 15 h’ ……………………………………………………………………… 66
8ème séance ……………………………………………………………………………………………………………….. 67
Objectif : Amener le patient à faire confiance à son monde social ………………………………. 67
Date et heure : Le 13 avril 2025 à 15 h’ ……………………………………………………………………….. 67
9ème séance ……………………………………………………………………………………………………………….. 68
Objectif : Développement de la résilience ………………………………………………………………….. 68
Date et heure : Le 17 Avril 2025 à 15 h 0’ ………………………………………………………………….. 68
10ème séance ……………………………………………………………………………………………………………… 68
Objectif : Identification intacte de l’impact de notre intervention par l’exposition ……… 68
Date et heure : Le 20 Avril 2025 à 15 h’ ……………………………………………………………………… 68
3.2. INTERPRETATION DES RESULTATS ……………………………………………………………….. 70
3.3. DISCUSSIONS DES RESULTATS ………………………………………………………………………… 73 VERIFICATION DES HYPOTHESES …………………………………………………………………….. 74
- FORCES ET LIMITES DE L’ETUDE ……………………………………………………………………… 76
- Points forts ………………………………………………………………………………………………………………. 76
- Limites …………………………………………………………………………………………………………………….. 76
3.4. CONTRIBUTION SCIENTIFIQUE ………………………………………………………………………. 78
CONCLUSION GENERALE ………………………………………………………………………………………….. 79
BIBLIOGRAPHIE ………………………………………………………………………………………………………….. 81
LES ANNEXES …………………………………………………………………………………………………………………. I
ANNEXE 1. GUIDE D’ENTRETIEN …………………………………………………………………………….. II
ANNEXE II. LE QUESTIONNAIRE …………………………………………………………………………….. III
ANNEXE III. L’ECHELLE DE MESURE DE DEPRESSION D’HAMILTON ………………. IV
ANNEXE IV. INVENTAIRE DE DEPRESSION DE BECK (13 ITEMS) ………………………. VII
ANNEXE 1. GUIDE D’ENTRETIEN
Monsieur c’est dans le cadre de notre investigation scientifique qui porte sur « Exposition aux espaces verts et réduction des symptômes dépressifs chez les jeunes adultes du quartier kasapa à Lubumbashi », que nous voulons nous entretenir avec vous pour mieux comprendre votre situation afin de vous accompagner dans le processus de guérison de votre dépression.
Déroulement de l’entretien
- Cadre : Dans une salle de consultation
- Catégorie des patients : Personne en proie de la dépression
- Type d’entretien : Il s’agit de l’entretien, directif, non directif et semi-directif
- Thèmes d’entretien : Pour notre entretien, voici quelques thèmes qui seront abordés :
A. Catégorie de dépression : Dépression due aux manques d’emplois, et l’autre due aux déceptions amoureuses.
B. Fréquence et durée de la dépression
- Quantité/Durée
- Fréquence de symptômes actifs ou majeurs
C. Histoire et contexte de la dépression dans la vie du patient
- Début de la dépression
- Antécédents
D. Impact du comportement addictif sur la vie quotidienne
– Influence de la dépression sur le travail, les relations et la santé – Problèmes financiers, de santé liés à la dépression
E. Facteurs déclencheurs de la dépression – Déclencheurs de la dépression
– Facteurs étiologiques de la dépression
F. Motivations et objectifs de la demande d’aide
- Motivation de la recherche d’aide par le patient
- Objectifs du patient en matière de changement
- Ressources à mobiliser par le patient pour soutenir la démarche
- Stratégies à mettre en place par le patient pour éviter les rechutes
ANNEXE II. LE QUESTIONNAIRE
QUESTIONNAIRE DE RECHERCHE SUR LA REDUCTION DES SYMPTOMES DEPRESSIFS AU
TRAVERS L’EXPOSITION AUX ESPACES VERTS
Dites oui ou non, aux propositions ou questions suivantes
- Trouvez-vous de l’intérêt dans les choses que vous faites ?
OUI
NON
- Vous sentez-vous épuisé ?
OUI
NON
- Avez-vous d’insomnie ?
OUI
NON
- Vous sentez-vous coupable ? OUI
NON
- Vous sentez-vous dévalorisé ?
OUI
NON
- Avez-vous des difficultés à prendre des décisions ?
OUI
NON
- Avez-vous des difficultés à penser ?
OUI
NON
- Avez-vous du courage maintenant ? OUI
NON
- Avez-vous encore besoin de vous donner la mort ?
OUI
NON
- Que faites-vous lorsque : vous perdez l’intérêt à mener certaines activités, vous manquez le courage vous vous sentez coupable, vous perdez l’énergie, vous vous sentez dévalorisé, immotivé ?
ANNEXE III. L’ECHELLE DE MESURE DE DEPRESSION D’HAMILTON
| Echelle de dépression de Hamilton L’échelle de dépression de Hamilton est un test d’évaluation de l’intensité des symptômes dépressifs, utilisable pour toutes les personnes; y compris les personnes âgées (même si certaines questions concernent les activités professionnelles) Cette évaluation permet de coter une dépression et d’en assurer le suivi Plus la note est élevée, plus la dépression est grave : de 10 à 13: les symptômes dépressifs sont légers de 14 à 17: les symptômes dépressifs sont légers à modérés au dessus de 18: les symptômes dépressifs sont modérés à sévères Cet examen donne lieu à une cotation CCAM : Code = ALQP003 – Tarif = 69,12 € applicable 1 fois par an Remplissez le questionnaire ci-dessous. Le sigle « V » au dessus des numéros de questions permet de faire monter la page sans avoir à utiliser les barres de défilement Arrivé en fin de questionnaire vous trouverez l’analyse des réponses (note globale, interprétation) ainsi que le rappel des réponses apportées aux 17 questions. Vous pourrez – sélectionner le texte du rapport final pour le copier puis le coller dans votre dossier (bouton Sélectionner) imprimer un compte-rendu intégrant le nom du patient, votre cachet et signature (bouton Imprimer) |
| Le Test V 1. Humeur dépressive: Echelle de Hamilton file:///C:/APIMED/Thèmes/Antidépresseurs/Qestionnaire-echelle Ham… 4 sur 8 31/05/2017 14:17 La personne est-elle dans un état de tristesse, d’impuissance, d’auto dépréciation ? Non Oui. Etats affectifs signalés uniquement si on l’interroge (ex. pessimisme, sentiment d’être sans espoir) Oui. Etats signalés spontanément et de manière verbale ou sonore (ex. par des sanglots occasionnels). Oui. Etats communiqués de manière non verbale (ex. expression faciale, attitude, voix, tendance à sangloter). Oui. La personne ne communique pratiquement que ces états affectifs verbalement et non verbalement. V Sentiments de culpabilité de la personne N’a pas de sentiments de culpabilité S’adresse des reproches, et a l’impression d’avoir porté préjudice à des gens Idées de culpabilité et rumination sur des erreurs passées ou des actions condamnables La maladie actuelle est une punition. Idées délirantes de culpabilité Entend des voix qui l’accusent ou la dénoncent et/ou a des hallucinations visuelles menaçantes V Suicide N’a pas d’idée suicidaire A l’impression que la vie ne vaut pas la peine d’être vécue Souhaite être mort ou équivalent : toute pensée de mort possible dirigée contre lui-même. Idées ou geste de suicide Tentatives de suicide (coter toute tentative de suicide sérieuse) V Insomnie de début de nuit Pas de difficulté à s’endormir Se plaint de difficultés éventuelles à s’endormir Se plaint d’avoir chaque soir des difficultés à s’endormir V Insomnie en milieu de nuit Pas de difficulté Se plaint d’être agité ou troublé pendant la nuit Se réveille pendant la nuit (coter toutes les fois ou le patient se lève la nuit sauf si c’est pour aller aux toilettes) |
| V Insomnie du matin Pas de difficulté Se réveille de très bonne heure mais se rendort Incapable de se rendormir s’il se lève V Travail et activités Pas de difficulté Pensées et sentiments d’incapacité, fatigue ou faiblesse se rapportant à des activités professionnelles ou de détente Perte d’intérêt pour les activités professionnelles ou de détente, soit décrite directement par le malade soit indirectement par son apathie, son indécision et ses hésitations. (a l’impression de devoir se forcer) Diminution du temps d’activité ou diminution de la productivité Echelle de Hamilton file:///C:/APIMED/Thèmes/Antidépresseurs/Qestionnaire-echelle Ham… 5 sur 8 31/05/2017 14:17 A arrêté son travail en raison de sa maladie actuelle. V Ralentissement (lenteur de la pensée et du langage, baisse de la faculté de concentration et de l’activité motrice) Pensée et langage normaux Léger ralentissement à l’entretien Ralentissement manifeste lors de l’entretien Entretien difficile Entretien impossible (état de stupeur) V Agitation Aucune Crispations, secousses musculaires Joue avec ses mains, ses cheveux… Bouge, ne peut rester assis tranquille Se tord les mains, se ronge les ongles, s’arrache les cheveux, se mord les lèvres V 10 Anxiété psychique Aucune Symptômes légers – Tension subjective et irritabilité Symptômes modérés – Se fait du souci à propos de problèmes mineurs Symptômes sévères – Attitude inquiète, apparente dans l’expression faciale et le langage Symptômes très invalidants – Peurs exprimées sans que l’on pose de questions V Anxiété somatique (bouche sèche, troubles digestifs, palpitations, céphalées, pollakiurie, hyperventilation …) Aucun de ces symptômes Symptômes légers Symptômes modérés Symptômes sévères Symptômes très invalidants frappant le sujet d’incapacité fonctionnelle V Symptômes somatiques gastro-intestinaux Aucun symptôme Manque d’appétit, mais mange sans y être poussé A des difficultés à manger en l’absence d’incitations. Demande ou besoins de laxatifs, de médicaments intestinaux V Symptômes somatiques généraux Aucun Lourdeur dans les membres, le dos et la tête. Maux de dos, de tête, douleurs musculaires, perte d’énergie, fatigabilité. Un des symptômes apparaît clairement V Symptômes génitaux (perte de libido, troubles menstruels) Echelle de Hamilton file:///C:/APIMED/Thèmes/Antidépresseurs/Qestionnaire-echelle Ham… |
| Absents Légers Sévères V Hypochondrie Absente Attention concentrée sur son propre corps Préoccupations sur sa santé Convaincu d’être malade. Plaintes fréquentes et demandes d’aide… Idées délirantes hypochondriaques V Perte de poids A: D’après les renseignements apportés par le malade Pas de perte de poids Perte de poids probable Perte de poids certaine B: Si le poids est mesuré quotidiennement par le personnel soignant Perte inférieure à 500g par semaine Perte supérieure à 500g par semaine Perte supérieure à 1 kg par semaine V Prise de conscience Reconnaît être déprimée et malade Reconnaît être malade mais l’attribue à la nourriture, au climat, au surmenage, à un virus, au besoin de repos… Nie être malade |
| V accès au résultat |
| Résultat Nom du patient : (sera intégré dans le compte-rendu imprimé) v2.2 par B Deloffre p |
ANNEXE IV. INVENTAIRE DE DEPRESSION DE BECK (13 ITEMS)
[1] Mérin, Mathew. & Sabourin, J. (1998). La méthodologie de la recherche. Paris : Éditions Eyrolles.
[2] Beauvais, C., & Lemoine, L. (2001). La recherche en pédagogie : une approche critique. Éditions du Cèdre
[3] American Psychiatric Association. (2015). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders: DSM-5TR. Arlington: American Psychiatric Publishing
[4] IDME 3
[5] KAMBULU NSHIMBA 2020 Initiation à la recherche scientifique cours inédit, Fac de psychologie/UNILU
[6] KAMBULU NSHIMBA 2020, Cours inédit d’initiation ç la recherche scientifique, Université de Lubumbashi Fac. De Psychologie et des sciences de l’éducation
[7] KASONGO BWANAGABO Oscar TFC présenté en 2022-2023 portant sur le traumatisme psychique et vécu psychosocial, UNILU/ Fac de psychologie et des sciences de l’éducation P.1
[8] KAMBULU NSHIMBA 2020, Cours inédit d’initiation ç la recherche scientifique, Université de
Lubumbashi Fac. De Psychologie et des sciences de l’éducation
[9] KAMBULU NSHIMBA 2020, Cours inédit d’initiation ç la recherche scientifique, Université de
Lubumbashi Fac. De Psychologie et des sciences de l’éducation
[10] Carl Hempel (2012) p. 151-174 dans éléments d’Épistémologie
[11] Jean-Pierre Aistolf and Call (2008 p.23-33) dans : “Mots-clés de la Didactique des Sciences
[12] Clergeau, P. (2007. « Une écologie du paysage urbain. » Éditions Apogée
[13] Roger, A. (1997). « Court traité du paysage. » Gallimard.
[14] Dictionnaire de l’Académie française+5Larousse+5Le Dictionnaire+5
[15] Wikipédia, l’encyclopédie libre
[16] V Cicchelie, Claude M and all, les jeunes adultes, un débat scientifique et politique en France,2001
[17] OMS, 2001.
[18] INPES, Baromètre Santé 2010. 19 https://chu–mondor.aphp.fr/wp–
content/blogs.dir/163/files/2014/08/PSYCOM_TroublePsy_TroubleDepressifs_WEB.pdf
[19] https://chu–mondor.aphp.fr/wpcontent/blogs.dir/163/files/2014/08/PSYCOM_TroublePsy_TroubleDepressifs_WEB.pdf
[20] https://chu–mondor.aphp.fr/wp–
content/blogs.dir/163/files/2014/08/PSYCOM_TroublePsy_TroubleDepressifs_WEB.pdf
[21] Kaplan, S., & Kaplan, R. (1989). The Experience of Nature: A Psychological Perspective. Cambridge University Press.
[22] Kaplan, S. (1995). The restorative benefits of nature: Toward an integrative framework. Journal of Environmental Psychology, P. 15(3), 169-182.
[23] Berman, M. G., Jonides, J., & Kaplan, S. (2008). The cognitive benefits of interacting with nature. Psychological Science, P. 19(12), 1207-1212.
[24] Ulrich, R. S. (1991). Effects of interior design on wellness: Theory and recent scientific research. Journal of Health Care Interior Design, P. 3, 97-109.
[25] van den Berg, A. E., Maas, J., Verheij, R. A., & Groenewegen, P. P. (2010). Green space as a buffer between stressful life events and health. Social Science & Medicine, 70(8), P. 1203-1210.
[26] Wilson, E. O. (1984). Biophilia. Harvard University Press.
[27] Kellert, S. R., & Wilson, E. O. (1993). The Biophilia Hypothesis. Island Press.
[28] Mayer, F. S., Frantz, C. M., Bruehlman-Senecal, E., & Dolliver, K. (2009). Why is nature beneficial? The role of connectedness to nature. Environment and Behavior, P. 41(5), 607-643. 30 Kuo, F. E., & Sullivan, W. C. (2001). Environment and crime in the inner city: Does vegetation reduce crime? Environment and Behavior, 33(3), 343-367.
[29] Maas, J., van Dillen, S. M., Verheij, R. A., & Groenewegen, P. P. (2009). Social contacts as a possible mechanism behind the relation between green space and health. Health & Place, 15(2), 586595.
[30] Sugiyama, T., Leslie, E., Giles-Corti, B., & Owen, N. (2008). Associations of neighborhood greenness with physical and mental health: Do walking, social coherence and local social interaction explain the relationships? Journal of Epidemiology & Community Health, 62(5), e9.
[31] Pretty, J., Peacock, J., Sellens, M., & Griffin, M. (2005). The mental and physical health outcomes of green exercise. International Journal of Environmental Health Research, 15(5), 319-337.
[32] Thompson Coon, J., Boddy, K., Stein, K., Whear, R., Barton, J., & Depledge, M. H. (2011). Does participating in physical activity in outdoor natural environments have a greater effect on physical and mental wellbeing than physical activity indoors? Environmental Science & Technology, 45(5), 1761-1772.
[33] Barton, J., & Pretty, J. (2010). What is the best dose of nature and green exercise for improving mental health? Environmental Science & Technology, 44(10), 3947-3955
[34] Kaplan Rachelle et Kaplan Stéphane (1989), Cambridge university press sur experince of nature :
psychological perspective p.30,45-50
[35] Ulrich, R. S. (1983) Aesthetic and affective response to natural environnements. Dans Behavior and the Naturel Environment (pp.85-125) New York : Plenum press.
[36] JULIE EMOND (AOUT 2017) mémoire de maitrise présenté à l’université du QUEBEC A MONTREAL
portant sur « les espaces verts urbains et leur contribution à l‘amélioration de la qualité de vie des résidents de la petite-patrie, p. 47,100-157.
[37] IDEM 3. JULIE EMOND 2017
[38] Sandrine MANUSSET Décembre 2012 « Impacts psycho-sociaux des espaces verts dans les espaces urbains ; openEdition Journals ; p. 1-14. 41 IDEM Sandrine MANUSSET 2012 p.12
[39] IDEM Sandrine MANUSSET 2012 p. 13
[40] IDEM Sandrine MANUSSET 2012 p. 14
[41] Yin Robert K. (2018). Case Study Research and Applications: Design and Methods (6th ed.). Sage Publications.
[42] KAMBULU NSHIMBA JACQUES, dans les séminaires scientifiques en psychologie 2025 UNILU/Fac. De Psychologie (Triangulation : Utilisation de deux ou plusieurs méthodes dans une recherche scientifique).
[43] Kaës Régis. (1992). Le cas et la construction du cas en clinique. In Clinique et théorie psychanalytique.
Dunod
[44] IDEM Kaës Régis. (1992).
[45] Devereux, G. (1967). De l’angoisse à la méthode dans les sciences du comportement. Flammarion. 49 Blanchet, A, & Gotman, A. (2010). L’entretien (5e éd.). Armand Colin.
[46] KAZADI NDJIMBU ANDRE (2022) Mémoire de recherche, Vécu psychosocial du phénomène
Kidnapping, UNILU/FPSE, P. 29-30
[47] IDEM Notes 50
[48] (JEAN-PIERRE BIRANGUI 2024) cours inédit des techniques d’entretiens et d’interventions, UNILU/FPSE, P 4-10
[49] IDEM Notes 50
[50] ( TSHIBANGU LUSHIKU Pierre 2021-2022)54 Mémoire de licence : Effets de la toxicomanie sur le fonctionnement du système familial, UNILU/FPSE, P. 47 55 IDEM Notes 52
[51] IDEM Notes 54 ou 53 et 52
[52] IDEM Notes P.46
[53] ( TSHIBANGU LUSHIKU Pierre 2021-2022)58 Mémoire de licence : Effets de la toxicomanie sur le fonctionnement du système familial, UNILU/FPSE, P. 46
[54] Hamilton, M. (1960). A rating scale for depression. Journal of Neurology, Neurosurgery, and Psychiatry, 23(1), 56–62. https://doi.org/10.1136/jnnp.23.1.56
[55] Bagby, R. M., Ryder, A. G., Schuller, D. R., & Marshall, M. B. (2004). The Hamilton Depression Rating Scale: Has the gold standard become a lead weight? American Journal of Psychiatry, 161(12), 2163–2177.
[56] Zimmerman, M., et al. (2013). Why is the Hamilton Depression Rating Scale used so often? Journal of Nervous and Mental Disease, 201(3), 219–225.
[57] Williams, J. B. W., et al. (2008). The GRID-HAMD: Standardization of the Hamilton Depression Rating Scale. International Clinical Psychopharmacology, 23(3), 120–129.
[58] Beck, A. T., Ward, C. H., Mendelson, M., Mock, J., & Erbaugh, J. (1961). An Inventory for Measuring Depression. Archives of General Psychiatry, 4, 561–571.
[59] Bourque, P., & Beaudette, D. (1982). Étude psychométrique du questionnaire de dépression de Beck auprès d’un échantillon d’étudiants universitaires francophones. Revue canadienne des sciences du comportement, 14(3), 211–218.
[60] Collet, L., & Cottraux, J. (1986). Inventaire de dépression de Beck (BDI). L’Encéphale, 12, 77–79.
[61] Caron, J. (1996). Une validation de l’échelle de dépression de Beck dans une population non clinique. Santé mentale au Québec, 21(2), 447–468.
[62] Kazadi Ndjibu André, mémoire de recherche : Vécu psychosocial du phénomène Kidnapping, UNILU/Fac.
de psychologie et des sciences de l’éducation, P. 30
[63] IDEM Note 51
[64] BARDIN, Laurence. L’analyse de contenu. Paris : presse Universitaire de France (PUF), 1989. (Rééditions :
[65] , 2001, etc.) P.46
[66] ROBERT, Danielle et BOUILLAGUET, Annick. L’Analyse de contenu. Paris : Armand colin, 1997 ?
(Collection : cursus)
[67] Rachman, S. (1977). The conditioning theory of fear. Behavior Research and Therapy, P. 375-391.
[68] Goldiamond, I. (1974). Behavioral self-control: The functional analysis of behavior and its modification. New York: Pergamon Press.
[69] Jung, C.G. (1921). Psychologische Typen in œuvres complètes (CW6), paris : Buchet-Chastel.
[70] Jung, C.G. (1921). Psychologische Typen in œuvres complètes (CW6), paris : Buchet-Chastel.

 Naviguez vers congovirtuel
Naviguez vers congovirtuel Naviguez vers Kinkiesse
Naviguez vers Kinkiesse