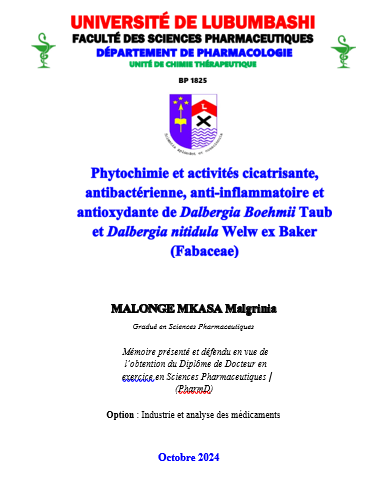
Gradué en Sciences Pharmaceutiques
Mémoire présenté et défendu en vue de l’obtention du Diplôme de Docteur en
exercice en Sciences Pharmaceutiques
(PharmD)
Option : Industrie et analyse des médicaments
Octobre 2024
Mémoire présenté et défendu en vue de l’obtention du
Diplôme de Docteur en exercice en Sciences Pharmaceutiques (PharmD) Option : Industrie et analyse des médicaments
Directeur : BASHIGE CHIRIBAGULA Valentin
Professeur associé
Année Académique 2023 – 2024 A mes très chers parents
LULONGA MKASA Ganelon et
WALENGA Rashidi
Réaliser un mémoire de fin d’études est un parcours semé d’embûches, ponctué de périodes d’espoirs et de découragements. Ce travail n’aurait pu aboutir sans la collaboration et le soutien de nombreuses personnes que nous tenons à remercier chaleureusement.
Nous tenons en premier lieu à exprimer nos vifs remerciements au professeur associé Bashige Chiribagula Valentin, PhD, directeur de ce mémoire, pour sa guidance et sa clairvoyance tout au long de ce travail.
Nous tenons également à remercier chaleureusement les professeurs : Phn TAMBWE Emmanuel, Phn TAMBWE Antoine et MSEMBWA NDALA, SENGA TCHOWE Jules, RUTH Sylvie et BOY MUALA Précieux, pour leurs conseils avisés durant la réalisation de ce travail et pour le développement de mes capacités de recherche.
Nous voulons aussi exprimer notre profonde reconnaissance à Ben BIAYI pour ses contributions lors de nos différentes manipulations en laboratoire.
Je reconnais aussi durant toute ma vie, les efforts et sacrifices consentis par mes grands-pères, KASINDI KATI Frederick et MALONGE MKASA Valentin. Ils se sont donné corps et âme pour supporter mes études malgré les différentes difficultés de la vie. Nous remercions également les participants :
Nous tenons également à remercier les co-signataires : Mwenebatu Eciba, Kibala Beni, Mutshingi Antoine, Kibangula Ben, Kasamba Olivier, Luhembwe Prince, pour avoir rendu nos moments d’expérimentation chaleureux ;
A mon amie, conseillère du tout moment MAUWA BAHARI BINTI Lysbie, nous vous remercions durant ce travail abouti à ce stade.
À nos frères et sœurs, KINTENGE Josué, KABEZA Pierre, IBUCWA Djuma, DJUMA Isaac, BINTU Consolate, LUENDU Esther, RASHIDI Bienfait, SAFI Lulondo, LUUNDO Lulondo, AMOS Jephté, RASHIDI Kati, SIMBA Emmanuel, MAYANI Claude, BRENDA Merveille, Joseph LOFO, Hervé DJUMA, en témoignage de toute affection et de profonds sentiments fraternels que nous portons à leur égard et à l’attachement qui nous unit. Leur présence et leurs encouragements nous ont été d’une aide précieuse.
Enfin, nous tenons à remercier tous les collègues et membres de la promotion.
Malgrinia Malonge Mkasa
Dalbergia boehmii et Dalbergia nitidula sont utilisés dans la médecine traditionnelle congolaise pour la prise en charge des plaies, malgré l’absence de preuves scientifiques confirmant leur efficacité biologique relative à cet usage. Cette étude a été réalisée non seulement en vue d’évaluer l’activité cicatrisante des extraits éthanoliques de leurs feuilles et écorces de tige, mais également pour évaluer leurs activités antioxydante, anti-inflammatoire et antibactérienne, et déterminer leurs paramètres physicochimiques.
Matériel et méthodes : l’activité cicatrisante a été évaluée par application locale de l’extrait sur une plaie chirurgicale induite par une entaille dorsale de 100,06 mm2 chez Mus musculus. L’activité anti-inflammatoire a été évaluée par un modèle d’œdème de la patte postérieure induit par le formol. L’activité antibactérienne a été évaluée grâce au test de diffusion sur disque et à la macro-dilution en tube, alors que l’activité antioxydante a été évaluée par le test au DPPH.
Résultats : tous les extraits ont montré un gain de cicatrisation de 3 à 9 jours, avec en tête DaBoRa, DaNiTi et DaNiRa au 15 J. Cependant, parmi ces trois derniers, DaNiTi dispose également d’une activité anti-inflammatoire. Au temps médian, 5 heures, la réduction de l’inflammation était de 61,0 ± 2,3 % contre 61,3 ± 2,1 % pour le contrôle positif à la dose de 500 mg/kg. Après 10 heures, la même dose a provoqué une élévation de plus de 100 % de l’inflammation, réduite. C’est DaNiTi qui est le plus actif, alors que les feuilles de ce taxon n’ont pas démontré une efficacité meilleure quant à la réduction du volume de la patte. Ces mêmes extraits ont notamment présenté une activité antibactérienne (CMI : 62,5 à 500 μg/mL
; DZI : 10 – 20 mm) sur E. coli, Salmonella, St Aureus, P. aeruginosa et K. pneumoniae. Ce sont les DaNiRa qui ont été actifs sur E. coli. Les deux extraits ont présenté une forte activité antioxydante (CI50 : 0,144 à 4,19 μg/mL) et c’est les DaNiFe qui sont les plus actifs avec 0,144 μg/mL par rapport au contrôle positif avec 1,127 μg/mL. Ces activités sont attribuées en partie aux flavonoïdes qui ont été identifiés en solution et quantifiés TFT : (0,17 ± 0,08 à 0,58 ± 0,03 mg EQGg-1). Les essais physico-chimiques indiquent que leurs poudres ont un taux de cendres totales de 3,42 et 15 %, un indice de gonflement de 3,91 ± 0,08 à 2,8 ± 0,06
cm.
Conclusion : Les résultats indiquent que ces plantes possèdent des propriétés significatives capable à favoriser la cicatrisation des plaies, à neutraliser les radicaux libres, à réduire l’inflammation et à combattre les infections bactériennes.
Ces recherches pourraient ouvrir la voie de nouvelles approches phytothérapeutiques, contribuant ainsi à une meilleure intégration des remèdes naturels dans les soins de santé contemporains.
Mots-clés : plaie, antioxydant, Mus musculus.
Dalbergia boehmii and Dalbergia nitidula are used in traditional Congolese medicine for wound management, despite the lack of scientific evidence confirming their biological efficacy for this use. This study was conducted not only to evaluate the healing activity of ethanolic extracts of their leaves and stem barks, but also to evaluate their antioxidant, anti-inflammatory and antibacterial activities, and determine their physicochemical parameters.
Materials and methods: The healing activity was evaluated by local application of the extract on a surgical wound induced by a dorsal cut of 100.06 mm2 in Mus musculus. The antiinflammatory activity was evaluated by a model of hind paw edema induced by formalin. The antibacterial activity was evaluated using the disk diffusion test and the tube macro-dilution, while the antioxidant activity was evaluated by the DPPH test.
Results: All extracts showed a healing gain from 3 to 9 days, with DaBoRa, DaNiTi and DaNiRa at 15 days leading the way. However, among these last three, DaNiTi also has antiinflammatory activity. At the median time, 5 hours, the reduction in inflammation was 61.0 ± 2.3% compared to 61.3 ± 2.1% for the positive control at the dose of 500 mg/kg. After 10 hours, the same dose caused an increase of more than 100% in inflammation, which was reduced. DaNiTi was the most active, while the leaves of this taxon did not demonstrate better efficacy in reducing the volume of the paw. These same extracts notably presented an antibacterial activity (MIC: 62.5 to 500 μg/mL; DZI: 10 – 20 mm) on E. coli, Salmonella, St Aureus, P. aeruginosa and K. pneumoniae. It was the DaNiRa that were active on E. coli. Both extracts presented a strong antioxidant activity (IC50: 0.144 to 4.19 μg/mL) and it was the DaNiFe that were the most active with 0.144 μg/mL compared to the positive control with 1.127 μg/mL. These activities are attributed in part to the flavonoids that were identified in solution and quantified TFT: (0.17 ± 0.08 to 0.58 ± 0.03 mg EQGg-1). Physicochemical tests indicate that their powders have a total ash content of 3.42 and 15%, a swelling index of 3.91 ± 0.08 to 2.8 ± 0.06 cm.
Conclusion: The results indicate that these plants have significant properties capable of promoting wound healing, neutralizing free radicals, reducing inflammation and fighting bacterial infections. This research could pave the way for new phytotherapeutic approaches, thus contributing to a better integration of natural remedies in contemporary health care.
Keywords: wound, antioxidant, Mus musculus
DEDICACE……………………………………………………………………………………………………………………………….. I
REMERCIEMENT …………………………………………………………………………………………………………………….. II
RÉSUMÉ ……………………………………………………………………………………………………………………………….. III
ABSTRACT ……………………………………………………………………………………………………………………………… V
TABLE DES MATIERES …………………………………………………………………………………………………………….. VI
ABREVIATIONS ET SYMBOLES UTILISES ………………………………………………………………………………………. I
LISTE DES FIGURES ………………………………………………………………………………………………………………….. II
LISTE DES TABLEAU………………………………………………………………………………………………………………… IV
INTRODUCTION ……………………………………………………………………………………………………………………… 1
Ière partie, Considérations bibliographiques ………………………………………………………………………………. 1
Chapitre 1er ……………………………………………………………………………………………………………………………. 3
Revue systématique des connaissances ethno médicaux, phytochimiques et biologiques de Dalbergia
boehmii Taub et Dalbergia nitidula welw ex baker (Fabaceae) …………………………………………………….. 3
1.1. Introduction …………………………………………………………………………………………………………….. 3 Dalbergia boehmii Taub …………………………………………………………………………………………………… 4
1.1.1.1. Dénomination internationales et locales ………………………………………………………….. 4
1.1.1.2. Taxonomie ……………………………………………………………………………………………………. 5
1.1.1.3. Synonymes……………………………………………………………………………………………………. 5
1.1.1.4. Description botaniques ………………………………………………………………………………….. 5
1.1.1.5. Distribution géographiques …………………………………………………………………………….. 6
1.1.1.6. Constituant chimiques ……………………………………………………………………………………. 6
1.1.1.7. Connaissances ethnomédicales ……………………………………………………………………….. 8
1.1.1.8. Connaissances ethnopharmacologiques …………………………………………………………… 9
1.1.1.9. Dénomination internationales et locaux …………………………………………………………. 11
1.1.1.10. Taxonomie ………………………………………………………………………………………………….. 12
1.1.1.13. Constituant chimiques ………………………………………………………………………………….. 13
1.1.1.14. Connaissances ethnomédicales ……………………………………………………………………… 15
1.1.1.15. Connaissances ethnopharmacologique…………………………………………………………… 15
IIème Partie Expériences personnelles …………………………………………………………………………………….. 3
Chapitre 2 ……………………………………………………………………………………………………………………………. 17
Cadre expérimental, matériel, méthodes et protocoles …………………………………………………………….. 17
2.1. Cadre experimental …………………………………………………………………………………………………….. 17
2.2. Matériels……………………………………………………………………………………………………………………. 18
2.2.1. Matériel végétal …………………………………………………………………………………………………… 18
2.2.2. Modèle animal ……………………………………………………………………………………………………… 19
2.3.3. Matériel biologique ………………………………………………………………………………………………. 19
2.3.3.1. Souches bactériennes …………………………………………………………………………………………. 19
2.3.4. Le DPPH (2,2-diphényl-1-picrylhydrazyl) ………………………………………………………………….. 20
2.3.5. Reference aux témoins ………………………………………………………………………………………….. 20
2.3. Méthodes et Protocoles expérimentaux ………………………………………………………………………… 21
2.3.1. Récolte, identification et traitement physique des échantillons………………………………. 21
2.3.2. Obtention d’extraits …………………………………………………………………………………………….. 22
2.3.3. Evaluation de l’activité cicatrisante …………………………………………………………………………. 22 Evaluation de l’aspect macroscopique ……………………………………………………………………………… 23
- Evaluation de la contraction de la plaie …………………………………………………………………….. 24
- Performance de cicatrisation (PC) …………………………………………………………………………….. 24
2.3.4. Evaluation de l’activité Anti-inflammatoire in vivo de l’œdème de la patte de rat
induite par le formol …………………………………………………………………………………………………….. 24
2.3.5. Evaluation de l’activité de l’activité antioxydante …………………………………………………….. 26
2.3.6. Evaluation de l’activité Antibactérienne ………………………………………………………………….. 26 - Preparation des milieu de culture …………………………………………………………………………….. 26
- Préparation de l’inoculum standard ………………………………………………………………………….. 27
- Détermination des diamètres des zones d’inhibition (DZI), CMI (concentration minimale inhibitrice), CMB (Concentration minimale bactéricide) et Effet de l’extrait …………………………. 27
2.3.7. Criblage phytochimique ………………………………………………………………………………………… 28
2.3.7.1. Identification des grands groupes phytochimiques ………………………………………………… 28 - Flavonoïdes ……………………………………………………………………………………………………………. 28
- Hétérosides cyanogènes………………………………………………………………………………………….. 28
- Quinones ………………………………………………………………………………………………………………. 28
- Saponines ……………………………………………………………………………………………………………… 29
- Stéroïdes et Terpénoïdes ………………………………………………………………………………………… 29
- Tannins …………………………………………………………………………………………………………………. 29
- Alcaloïdes………………………………………………………………………………………………………………. 30
2.3.7.2. Dosage de tannins totaux (TT) ………………………………………………………………………….. 30
2.3.7.3. Dosages des polyphénols totaux ………………………………………………………………………….. 31
2.3.7.4. Dosages des flavonoïdes totaux (FT) ……………………………………………………………………. 31
2.3.8. Essais physicochimiques sur la poudre du taxon de Dalbergia boehmii et Dalbergia
nitidula. ………………………………………………………………………………………………………………………… 31 - Examens visuels sur la poudre …………………………………………………………………………………. 32
- Matière sèche (MS) et perte à la dessiccation (PD) ………………………………………………………… 32
- Cendre Totale (CT) matière minérale (MM) …………………………………………………………………… 32
- Indice de Gonflement (IG) ……………………………………………………………………………………….. 33
- pH ………………………………………………………………………………………………………………………… 33
Chapitre 3 …………………………………………………………………………………………………………………….. 34
Résultats et discussion …………………………………………………………………………………………………… 34
3.1. Activité cicatrisante des extraits hydro-alcooliques de Dalbergia boehmii et Dalbergia
nitidula. ………………………………………………………………………………………………………………………… 34 - Evolution pondérale de la plaie ………………………………………………………………………………… 34
- Score de la plaie (SP), Temps de cicatrisation (TC), Index du temps de cicatrisation médian
(ITCM) …………………………………………………………………………………………………………………………… 35 - Surface de la plaie (SP), Taux de contraction de la plaie (TCP100), Jour de contraction de la
plaie a 50% (JCP50) et l’Indexe de de cicatrisation (ICM). ……………………………………………………… 39
3.2. .Activité Anti-inflammatoire …………………………………………………………………………………………. 41
3.3. Activité antimicrobienne ……………………………………………………………………………………………… 45
3.1. Sensibilité des germes aux extraits ……………………………………………………………………………. 45
2.2. Activité antibactérienne des extraits exprimée en CMI et CMB (µg/mL) et effets des
extraits. ………………………………………………………………………………………………………………………… 47 - 4. Activité antioxydante………………………………………………………………………………………………. 49
3.4.1. Quantification de l’activité antioxydante ……………………………………………………………. 49 - Criblage phytochimique preliminaire ……………………………………………………………………………. 53
4.1. Dosage colorimetriques……………………………………………………………………………………….. 54
4.1.1. Taux en polyphénols, flavonoïdes et tanins totaux de taxons sélectionnés. ……………. 54
4.2. Caracteristiques physico-chimique de poudre de D. boehmii et D. nitidula. ………………. 56 - Examen visuel sur la poudre …………………………………………………………………………………….. 56
- Caractères microscopiques des poudres des taxons sélectionnées ………………………………. 57
- Matière sèche, perte a la dessiccation, cendres, indice de gonflement et pH ………………… 60
CONCLUSION ……………………………………………………………………………………………………………………….. 63
REFERENCE BIBLIOGRAPHIQUES …………………………………………………………………………………………….. 65
Annexe I. Matériel et Appareils, Réactifs et solvants …………………………………………………….. 71
Annexe II. Courbe d’étalonnage de l’acide gallique et de la quercétine ……………………………….. 72
Annexe III. Identification des espèces et séchage de matières végétales ………………………………. 73
Annexe IV. Activité antibactérienne, activité bacterienne, cicatrisante et criblage phytochimique
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 74
A
AAI : Activité anti-inflammatoire
AAB : Activité anti bactérienne
C AAO : Activité antioxydante
CC : Cendre Chlorhydrique
CT : Cendre Totale
Cneg : Contrôle négatif
D CMI : Concentration Minimale Inhibitrice
CMB:Concentration Minimale Bactéricide
Cpos : Contrôle positif
DDPH : 2,2-Diphényl-1-picrylhydrazyl DaNit Fe (F) : Dalbergia nitidula feuille
DaNit Ti (ET) : Dalbergia nitidula écorce
DZI : diamètres de zones d’inhibition tige
DaBoFe : Dalbergia boehmii feuille DaNiRa (ET) : Dalbergia nitidula écorce racine
DaBoTi (ET) : Dalbergia boehmii écorce tige DaBo Ra (ER) : Dalbergia boehmii écorce
E racine
ER : Écorces des racines
ET : Écorces des tiges
F
F : Feuilles
H FIC : Concentration inhibitrice de fraction FT : Flavonoïdes totaux
H : Hygroscopique
I
IG : Indice de Gonflement
INERA : Institut National d’Etudes et Recherches Agronomiques
M
MH : Mueller Hinton NH : Non Hygroscopique
MS : Matière Sèche
N
pH : potentielle d’hydrogène
PA : Poids de drogue
PC : Performance de Cicatrisation
PCP : Pourcentage de Contraction des Plaies
PD : Perte à la Dessiccation
Figure 1. Morphologie de Dalbergia boehmii Taub (Fabaceae), (a) plante entières, (b) feuilles et (c) herbier. ……………………………………………………………………………………………………………… 4
Figure 2. Distribution géographiques de Dalbergia boehmii Taub (Fabaceae) (Source: https://powo.science.kew.org/taxon/urn:lsid:ipni.org:names:490106-1 ). …………………………… 6 Figure 3. Structures chimiques des composés isolés (identifié) chez Dalbergia boehmii Taub. 8 Figure 4. Morphologie de Dalbergia Nitidula Welw (Fabaceae), (a) plante entières, (b) feuilles et (c) herbier. ……………………………………………………………………………………………………………. 11
Figure 5. Distributions géographiques de Dalbergia nitidula Welw (Fabaceae) (source : https://powo.science.kew.org/taxon/urn:lsid:ipni.org:names:490106-1 ). …………………………. 13
Figure 6. Les structures chimiques des composées isolées (identifiés) chez Dalbergia nitidula
Welw. ……………………………………………………………………………………………………………………… 15
Figure 7. (a) feuilles, (b) écorces de tige, (c) écorces de racine, sont les matérielles végétales utilisées sur cette étude. ……………………………………………………………………………………………… 18
Figure 8. Mus musculus a ete utilisés comme modèle animale utilisées sur l’activité cicatrisante
et antiinflammatoire sur cette étude. ……………………………………………………………………………. 19
Figure 9. Réaction de réduction du DPPH par un antioxydant (Chimactiv, 2020) (a) DPPH au radical et (b) Réduction du DPPH. ………………………………………………………………………………. 20
Figure 10. Les témoins utilisées: (1) Amoxicilline, (2) Acide clavulanique, (3) Norfloxacine,
(4) Quercétine, (5) Diclofenaque, (6) Asiaticoside. ……………………………………………………….. 21
Figure 11. Traitements physiques de plantes récoltées. ………………………………………………….. 22
Figure 12. Profil de variation de poids pondéraux des Mus musculus lors de l’activité cicatrisante. ………………………………………………………………………………………………………………. 34 Figure 13. Jours des observations visuels de la cicatrisation des plaies. …………………………… 37 Figure 14. (a) Aspect macroscopique de score, (b) Gain de temps de cicatrisation, (c) temps de cicatrisation et (d) index du temps de cicatrisation median …………………………………………….. 38 Figure 15. (a) Surface de la plaie, (b) taux de contraction de la plaie, (c) jour de contraction de la plaie a 50% et (d) Index de cicatrisation median ……………………………………………………….. 40
Figure 16. Courbes de concentrations des organes à la réponse de la quercétine et activité antioxydante sous forme d’IC50. …………………………………………………………………………………. 52
Figure 17. (a) La poudre de DaBoFe, (b) la poudre de DaBo Ti, (C) La poudre de DaBo Ra, (d)
La poudre de DaNit Fe, (e) La poudre de DaNit Ti, (f) La poudre de DaNit Ra. ……………….. 57 Figure 18. Les éléments microscopiques de la poudre de feuilles de Dalbergia boehmii Taub
observés dans la solution d’hydrate chloral. …………………………………………………………………. 58
Figure 19. Les éléments microscopiques de la poudre d’écorces tige d’Dalbergia boehmii Taub
observés dans la solution d’hydrate chloral. …………………………………………………………………. 58
Figure 20 – Eléments microscopiques de la poudre des écorces de racine de Dalbergia boehmii
observés dans la solution d’hydrate chloral. …………………………………………………………………. 59 Figure 21 – Eléments microscopiques de la poudre des feuilles Dalbergia nitidula observés dans
la solution d’hydrate chloral. ………………………………………………………………………………………. 59
Figure 22 – Eléments microscopiques de la poudre des écorces tige Dalbergia nitida observés
dans la solution d’hydrate chloral ……………………………………………………………………………….. 59
Figure 23 – Eléments microscopiques de la poudre des écorces racine Dalbergia nitidula
observés dans la solution d’hydrate chloral. …………………………………………………………………. 59
Tableau 1. Dénomination internationales et locaux de Dalbergia boehmii Taub …………………. 4
Tableau 2. Constituants photochimiques identifié (isolés) au sein de Dalbergia boehmii Taub 7
Tableau 3. Usages médicaux de dalbergia boehmii Taub en médecine alternative. ……………… 9
Tableau 4. Activités pharmacologiques évaluées sur Dalbergia Boehmii Taub …………………. 10
Tableau 5. Appellations internationales et locaux de Dalbergia nitidula Welw …………………. 11
Tableau 6. Constituants phytochimique identifiés au sein de Dalbergia nitidula Welw. ……… 13
Tableau 7. Les usages médicinaux de Dalbergia nitidula en médecine alternative. …………… 15
Tableau 8. Les activités pharmacologiques évaluées sur Dalbergia nitidula Welw. …………… 15
Tableau 9. Répartition des échantillons en groupes sur l’activité cicatrisante. …………………… 22 Tableau 10. Critères d’évaluations de l’aspect macroscopique des plaies sur l’activité
cicatrisante. ………………………………………………………………………………………………………………. 23
Tableau 11. Répartition des échantillons en groupes sur l’activité anti-inflammatoire. ………. 25
Tableau 12. Examens visuels des poudres utilisées lors de cette etude. ……………………………. 32
Tableau 13. Classification des extraits sur l’étude de cicatrisation des plaiesErreur ! Signet non défini.
Tableau 14. Variaton du volume des rats irrités a la patte au formoles 1% et traités par les extraits de DaBo et DaNi. ………………………………………………………………………………………….. 42 Tableau 15. Effets des extraits sur l’oedem de la patte induite par le formol 1% ……………….. 43
Tableau 16. Diamètres d’inhibition (mm) des extraits sur les diffentes souches bactériennes 45
Tableau 17. Catégorisation d’effets des extraits en fonction des CMI et CMB. …………………. 48
Tableau 18. Profil phytochimique par des reactions en solution. …………………………………….. 53 Tableau 19. Contenu en polyphénol, flavonoïdes et tanins totaux des extraits de Dalbergia boehmii et Dalbergia nitidula. …………………………………………………………………………………….. 55 Tableau 20. L’examen visuel des poudres des plantes sélectionnées. ………………………………. 56
Tableau 21. Paramètres physico-chimiques de deux taxons sélectionnés………………………….. 60
1
La peau est un organe complexe qui remplit cinq fonctions essentielles, dont la première est la protection de l’organisme contre les agressions extérieures [1]. Toute perturbation de son intégrité entraîne une plaie. Selon l’ampleur du traumatisme subi par le derme, on distingue deux types de plaies:
- Les plaies aiguës, qui cicatrisent normalement sans complication majeure; Elles peuvent être causées par des blessures intentionnelles (comme des incisions chirurgicales, des brûlures ou des coupures). Les plaies chroniques ne cicatrisent pas dans le délai habituel et peuvent rester ouvertes pendant des semaines, voire des mois [1,2]. Malgré les progrès en matière de soins des plaies, celles-ci restent classées parmi les problèmes de santé publique [2], dont l’incidence va augmenter avec l’évolution de certaines maladies comme le pied diabétique, les portes d’entrée des maladies infectieuses, les stress oxydatifs et l’obésité [3]. Cela constitue donc un problème de santé publique. D’autre part, elles sont sources de gêne sociale et représentent un fardeau financier, impactant la qualité de vie [1,3]. , autant pour les pays industrialisés qu’en voies de développement où les infrastructures sanitaires sont insuffisantes et la grande majorité de la population est essentiellement rurale et démunie. Ces populations n’ayant pas souvent accès aux soins de santé primaires, aux médicaments modernes et aux moyens logistiques leur permettant de se déplacer, elles se trouvent donc contraintes de recourir à la médecine traditionnelle. À ce sujet, d’après l’OMS, près de 80 % de la population a recours à la médecine traditionnelle [4]. Celle-ci utilise les plantes à l’état brut comme matière première, ce qui permet de venir à bout de nombreux problèmes de santé, y compris les plaies. Fort de ce constat, nous avons décidé d’étudier deux plantes: Dalbergiae boehmii et Dalbergia nitidula.
La cicatrisation est un processus complexe et essentiel qui permet de restaurer l’intégrité de la peau après une blessure [3,4]. Elle comprend quatre phases principales: l’hémostase pour arrêter le saignement, l’inflammation qui nettoie la plaie, la prolifération qui reconstruit le tissu et le remodelage qui renforce la nouvelle peau [5]. Ce processus peut être influencé par divers facteurs, comme la présence d’une infection, les troubles oxydatifs, l’âge, la nutrition, etc. Actuellement, le traitement des plaies fait encore l’objet de nombreuses controverses. En cas de plaie chronique, on assiste toutefois à une simplification, avec une remise en cause de l’utilisation systématique des traitements médicamenteux [4,5].
Dans les régions à ressources limitées, la majorité des soins est assurée par la médecine traditionnelle [5], laquelle est dominée par les ressources végétales, et la prise en charge des
2
plaies ne fait pas exception. C’est notamment la raison pour laquelle des études ethnobotaniques antérieures ont rapporté les plantes utilisées en médecine traditionnelle pour la cicatrisation des plaies [6,7] et d’autres ont évalué l’activité cicatrisante de certaines d’entre elles [7], comme dans la perspective de la présente étude. Un rapprochement a été établi entre l’activité cicatrisante et la présence de certains groupes phytochimiques, tels que les tanins, les flavonoïdes, les quinones, les alcaloïdes, les terpénoïdes et les anthocyanes [6,7]. Les propriétés antioxydantes [6,7] et antibactériennes [7] ont contribué à justifier l’efficacité des recettes cicatrisantes.
Dans la même perspective que les études antérieures susmentionnées, nous avons réalisé cette étude dans le but d’évaluer l’activité cicatrisante de Dalbergia boehmii et Dalbergia nitidula (feuilles, tige et racine) sur une plaie chirurgicale d’une entaille de 100,06 mm2 réalisée sur mucu musculis. En plus de l’activité cicatrisante, nous avons également voulu vérifier si ces plantes disposaient d’un potentiel antioxydant et antibactérien contre Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli et Staphylococcus aureus, quatre germes étant les plus incriminés dans les infections de plaies. Les deux activités ont été évaluées respectivement par le test au DPPH [12] et par les méthodes de macro-dilution en tube (29) et de diffusion sur disque [8]. Les analyses chimiques [10] et physicochimiques, réalisées par des méthodes classiques [13], ont complété le tableau des investigations effectuées.
Ce travail est présenté en deux parties. La première partie aborde les considérations bibliographiques générales sur les deux taxons étudiés, alors que la deuxième partie présente les résultats de l’étude, précédés de la méthodologie suivie.
Dalbergia L.f. (Fabaceae) est un genre de plantes pantropicales contenant environ 270 espèces actuellement acceptées [9], qui poussent sous forme d’arbres, d’arbustes ou de lianes. Les espèces arborescentes sont utilisées dans la fabrication de meubles et d’objets en bois décoratifs et parfumés [9,8]). De nombreuses espèces sont utilisées dans les systèmes de médecine traditionnelle du monde entier pour le traitement de diverses maladies [9]Traditionnellement, elles sont également utilisées pour leurs activités analgésiques, antimicrobiennes, aphrodisiaques, vermifuges, antipyrétiques, anti-inflammatoires et larvicides [9,14]. Seules quelques espèces ont fait l’objet d’études pharmacologiques afin de rationaliser leurs utilisations traditionnelles. Plusieurs phytoconstituants tels que les isoflavonoïdes, les néoflavonoïdes, les glycosides, les cinnamylphénols, les quinones et les furanes ont été isolés à partir de différentes espèces [14]. Parmi les 270 espèces, les plus courantes sont incluses. Nous présentons ici deux nouvelles espèces de Dalbergia de la République démocratique du Congo, précisément dans la ville de Lubumbashi. Elles ont été publiées dans la revue par [10], et il s’agit de Dalbergia boehmii et Dalbergia nitidula.
Dans ce chapitre, nous présentons les monographies des deux taxons, D. boehmii et D. nitidula. Celle-ci concerne les aspects ci-après : les dénominations internationales et locales, la taxonomie et les synonymes ; les descriptions botaniques, les distributions géographiques, les constituants chimiques ; les connaissances ethno médicinales et ethnopharmacologiques ainsi que la toxicité et la standardisation de la drogue.
Dalbergia boehmii Taub
ⓐ ⓑ ⓒ Figure 1. Morphologie de Dalbergia boehmii Taub (Fabaceae), (a) plante entières, (b) feuilles
et (c) herbier.
Légende – Récoltées a Lubumbashi (la latitude: S11°29’10.58532 », la longitude: E 27°38’43. 80432 » et l’Altitude: 1177m a.s.l) le 10/ 02/ 2024 dans la ferme Mikembo du foret Miombo a 10h40’.
1.1.1.1. Dénomination internationales et locales
Divers noms vernaculaires sont attribués à Dalbergia boehmii selon la communauté où le taxon est utilisé (Tableau 1).
Tableau 1. Dénomination internationales et locaux de Dalbergia boehmii Taub
Pays Appellation Ethnie Source
RDC Mutetampuku Bemba [18,20]
Mungombe Swahili [23]
Katembomutshi Tshiluba [18]
Katembo Sanga et Zala [18,20,10]
Atatùlwa Bembe NR
Guinée
Bissau Ambrecome Tonda [19]
Godjoli Fula [39]
Bierequete Biafada [39]
Cameroun Ngalayhi Fufuldé [37]
Sénégal Kavéy Wolofs [5]
Kowéy Sereres [5]
Tanzanie Msuati Kihehe et Kipogoro [14]
Fifi Swahili [24]
Mninga Sukuma nyaturu [24]
NR : Non rapporté.
1.1.1.2. Taxonomie
Selon APG IV, la classification taxonomique de Dalbergia boehmii se présente comme suit :
Règne : Plantae ; Classe: Magnoliopsida ; Famille: Fabaceae ; Sous-famille : Faboidé ; Ordre :
Fabales ; Genre: Dalbergia ; Espèce: Dalbergia boehmii [25].
1.1.1.3. Synonymes
Dalbergia boehmii est rapporté dans la littérature sous 3 synonymes hétérotypiques suivants :
Dalbergia boehmii subsp, boehmii; Dalbergia elata Harms; Dalbergia harmsiana De Wild [25].
1.1.1.4. Description botaniques
Il s’agit d’un grand arbuste ou d’un arbre dont la hauteur est comprise entre 4,5 et 10(–21) m. Il présente une ramification lâche et une couronne ± étalée. Son écorce est grise ou brune et finit par se fendre en petits morceaux. Rameaux couverts d’un tomentum emmêlé jaunâtre ou blanc cassé, persistant ou évanescent, ou pratiquement glabre. Feuilles de 10 à 30 cm de long ; stipules oblongues de 8 à 15 mm longues, caduques ou plutôt persistantes ; folioles latérales au nombre de 4 à 8 par côté du rachis, elliptiques-lancéolées, elliptiques-oblongues ou ovales de 3 à 7,5 cm. Longues de 1,5 à 3,5 cm, carrées, pointues, largement cunéiformes à arrondies ou cordées à la base, glabres à tomenteuses ; nerfs latéraux ± 6–10 de chaque côté de la nervure médiane, finalement proéminents au-dessus. Panicules produites en abondance du stade précoce au stade feuille pleine, très ramifiées, étalées, mesurant environ 5–13 cm. Longues, à nombreuses fleurs; axes souvent avec un indumentum allant de tomenteux sur le pédoncule à sous-glabre sur les pédicelles, mais parfois légèrement poilu ou glabre dans l’ensemble; bractées linéaires-lancéolées à oblongues ou oblongues-oblancéolées, 1,5–3 mm. Longues et fugaces; bractéoles au sommet de 2–4(–6) mm. Pédicelle long, oblong à largement elliptique, de 1–2 mm. Long. Calice de 3,5 à 4,5 mm (–5). Longue, rougeâtre, glabre. Corolle de 5 à 7,5 mm. Long, blanc ou crème, virant au jaunâtre, parfumé; étalon oblong-ovale, ovale ou largement elliptique, avec une griffe bien développée et glabre; pétales tous pratiquement de la même longueur. Étamines (8–) 9–10, réunies ou très rarement en deux phalanges. Fruit oblong, rétréci à l’apex pointu ou légèrement arrondi, long de 8 à 12 mm. Longue tige, 6–11 cm. Longue, 1 à 2 cm. Large, papyracé, brun rougeâtre, glabre, vaguement veiné, contenant 1 à 3 graines [26]
1.1.1.5.Distribution géographiques
L’espèce D. boehmii est un peu partout en Afrique subtropicale, sa distribution géographique correspond aux pays suivants : Angola ; Benin ; Cameroun ; RCA, Ethiopie ; Guinée-Bissau ; Kenya ; Malawi ; Mozambique ; RD Congo ; Sénégal ; Soudan ; Tanzanie ; Togo ; Zambie ; Zimbabwe [26]
Figure 2. Distribution géographiques de Dalbergia boehmii Taub (Fabaceae) (Source: https://powo.science.kew.org/taxon/urn:lsid:ipni.org:names:490106-1 ).
1.1.1.6. Constituant chimiques
Divers groupes photochimiques et ou molécules bioactives qui entrent dans le profil phytochimique de Dalbergia boehmii ont été identifiés (isolées) dans ses différents organes. Ils sont consignés dans le Tableau 2.
Tableau 2. Constituants photochimiques identifié (isolés) au sein de Dalbergia boehmii Taub
PU Groupe phytochimique Composé (s) bioactif (s) Source
F Flavonoïde, Terpenoides et anthocyane. Dalbergine (1), carpachromene (2),
proanthocyanidine A-2 (3) ; picéatannol (4) ; biochanine A (5), homopterocarpine (6), angolensine (7), 2,7-dihydroxy-4,5-
dimethoxyisoflavone (8), 2methoxyformononetine (9) [37,38]
ET Terpenoides Dalbergiamide (10), Olean-12-ène-3,11-dione
(11) et Glucoside 3-0-β-D-sitostérol (12), Glucoside 3-0-β-D-stigmastérol (13) [37,38]
ER Anthocyane, Flavonoïde, quinones, tanin, NR [37,38]
NR : Non rapporté, PU : Partie utilisée, ER : écorces de racines, ET : écorces de tige, F : Feuilles, R : Racines.
3
1 2
4 6 5
8 9 7
12
11
13
Figure 3. Structures chimiques des composés isolés (identifié) chez Dalbergia boehmii Taub.
1.1.1.7. Connaissances ethnomédicales
La littérature accessible montre que Dalbergia boehmii est une espèce végétale utilisée dans de nombreuses communautés africaines pour ses vertus médicinales comme le paludisme, les IST, ainsi que les TGI (Tableau 3).
Tableau 3. Usages médicaux de dalbergia boehmii Taub en médecine alternative.
PU Indication Préparation Région (Pays) Source
F Paludisme, paies persistantes, cancers et l’infection dentaires Decoction et macération Lubumbashi
(RDC) [20, 21]
F Paludisme et Asthme Décoction Kagera (Tanzanie) [8]
F Paludisme et Epilepsie Décoction Kenya [22]
ET Eruptions cutanées et épilepsie Infusion Guinée-Bissau [37]
ET Syphilis, abcès, diarrhées, Plaies,
Anémie, menace d’avortement, règle douloureuses, douleurs abdominales, dysenterie amibienne. Decoction Poudre Lubumbashi
(RDC) [20,21]
ET Menace d’avortement et gonorrhée Décoction Ngaoundéré
(Cameroun) [37]
ER Paludisme et plaie Décoction Ngaoundéré
(Cameroun) [19]
ER Paludisme, disfonctionnement érectile, Plaie persistante et cancer Decoction et macération Lubumbashi
(RDC) [9]
ER Cancer Macération Munda
(Mozambique) [22]
ER Cancer et diarrhée Décoction Tanzanie [34]
PU : Partie utilisée, ER : écorces de racines, ET : écorces de tige, F : Feuilles, R : Racines, NR :
Non Rapporté.
1.1.1.8. Connaissances ethnopharmacologiques
Dalbergia boehmii est une plante largement connue et utilisée pour ses vertus médicinales sur le continent africain. Certaines de ces usages ethno médicaux ont fait l’objet d’études ethno pharmacologiques dans l’optique de leur validation et d’autres non (Tableau 4).
Tableau 4. Activités pharmacologiques évaluées sur Dalbergia Boehmii Taub
PU Activité Extrait (composé) Modèle expérimental Source
ET Antioxydante CH₃OH In vitro sur DPPH [10]
ET Anti plasmodiale CH₃OH In vitro sur P.
falciparum souche [10]
ET Antiinflammatoire CH20 In vivo [29]
ET Antibactérienne C6H60 In vitro sur
Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumonia & Salmonella typhi [26]
ER Antibactériennes C4H8O2
In vitro [24]
ER Antioxydante CH₃OH In vitro [25]
F Anti plasmodiale H2O In vitro P. falciparum [27]
F Antibactérienne C₃H₆O In vitro sur
Staphylococcus aureus, S. typhi, K.
pneumoniae & P.
aeruginosa [26]
F Antiinflammatoire CH20 In vivo sur l’œdème de la patte provoquée par le formol 1% [39]
Dalbergia nitidula Welw ex Baker
ⓐ ⓑ ⓒ Figure 4. Morphologie de Dalbergia Nitidula Welw (Fabaceae), (a) plante entières, (b) feuilles et (c) herbier.
Légende – Récoltées a Lubumbashi (la latitude: S11°36’18.97956 », la longitude: E27°23 »1. 91184 » et l’altitude: 1246m a.s.l) le 15/03/2024 a l’INERA KIPOPO à 15h 02’.à Lubumbashi.
1.1.1.9. Dénomination internationales et locaux
Divers noms vernaculaires sont attribués à Dalbergia nitidula selon la communauté ou le taxon est utilisés (Tableau 5).
Tableau 5. Appellations internationales et locaux de Dalbergia nitidula Welw
Pays Appellation Ethnie Source
RDC Kalongwe Bemba et lala [17,18,20]
Msindano Swahili [17,18,20]
Mulombwa Luba [17,18,20]
Mutombi Tetela [17,18,20]
Ndjabilonda Luba-Kat [10]
Tanzanie Mzezela Swahili sukuma [13]
Kafinulambasa Nyamwezi [30]
Mulengwe Kihehe [30]
Angola Tona Nyaneka [31]
Katete Kikongo [31]
Burundi Umuhogo Tutsis [32]
Sénégal Umuyigi Twas [32]
RCA Mfuufu Lusoga [37]
Mubago Nyankore [37])
NR : Non rapporté.
1.1.1.10. Taxonomie
Selon APG IV, la classification taxonomique de Dalbergia nitidula se présente comme suit : Règne : Plantae ; Classe : Magnoliopsida ; Ordre : Fabales ; Famille : Fabaceae ; sous famille : Faboidé ; Genre : Dalbergia. Espèce : dalbergia nitidula welw ex Baker [40]
Synonymes
Dalbergia nitidula est rapporté dans la littérature sous 1 synonymes homotypiques et 5 synonymes hétérotypiques suivants : Amerimnon nitidulum (Welw ex Baker) Kuntze, Dalbergia dekindtiana Harms, Dalbergia luluensis Harms, Dalbergia medicinalis De Wild,
Dalbergia swynnertonii Baker f et Pterocarpus elisabethvillensis De Wild [40]
1.1.1.11. Description botaniques
Dalbergia nitidula est un arbuste ou petit arbre atteignant 4–12 m. Grand; écorce gris-brun à rougeâtre, irrégulièrement craquelée même sur les branches fleuries, bientôt très rugueuse et fissurée ; bois de cœur violacé. Les branches avec un court tomentum jaunâtre ou gris emmêlé, généralement quelque peu persistant. Les Feuilles mesurent environs de 9–20 cm. Long; stipules oblongues ou elliptiques-oblongues, carrément pointues, de 3–6 mm. Longue, caduque ; folioles latérales, au nombre de 4–7 de chaque côté du rachis, ovales à ²elliptiques-oblongues ou largement elliptiques, de 3–8,5 cm. Longue, 1,5 à 5 cm. large, rétréci à l’apex pointu, arrondi ou émarginé, arrondi ou légèrement cordé à la base, sous-glabre à tomenteux avec des poils diversement droits ou croustillants ; nerfs latéraux primaires ± 6–10(–12) de chaque côté de la nervure médiane, souvent assez masqués par l’indumentum [40]
1.1.1.12. Distribution géographiques
Dalbergia nitidula welw est une espèce régionale tropical de l’Afrique sa distribution géographique correspond aux pays suivants : Angola, Burundi, RCA, KwaZulu-Natal, Malawi, Mozambique, Namibia, , Rwanda, Tanzanie, Uganda, Zambie, RD Congo, Zimbabwe [40]
Figure 5. Distributions géographiques de Dalbergia nitidula Welw (Fabaceae) (source : https://powo.science.kew.org/taxon/urn:lsid:ipni.org:names:490106-1 ).
1.1.1.13. Constituant chimiques
Divers groupes phytochimiques et ou molécules bioactives qui entrent dans le profil phytochimique de Dalbergia nitidula ont été identifiés (isolées) dans ses différents organes. Ils sont consignés dans le Tableau 6.
Tableau 6. Constituants phytochimique identifiés au sein de Dalbergia nitidula Welw.
PU Groupe phytochimique Composé (s) bioactif (s) Source
F Anthocyane et Flavonoïde, Nitidulan(1), Proanthocyanidine A(2), [42]
ET Flavonoïde Daljaneline A(3), B(4), C(5) ; D((6) [42]
ER Flavonoïde et, Terpenoides. Nitiducarpine(7), Nitiducol(8),
Hemileiocarpine(9), Heminitidulan(10) ; Homepterocarpine(11) [42]
NR : Non rapporté, PU : Partie utilisée, ER : écorces de racines, ET : écorces de tige, F : Feuilles.
2 3 1
6
4 5
7 9 8
10
11
Figure 6. Les structures chimiques des composées isolées (identifiés) chez Dalbergia nitidula Welw.
1.1.1.14. Connaissances ethnomédicales
La littérature accessible montre que Dalbergia nitidula est une espèce végétale utilisée dans de nombreuses communautés africaines pour ses vertus médicinales (Tableau 7).
Tableau 7. Les usages médicinaux de Dalbergia nitidula en médecine alternative.
PU Indication Préparation Région (Pays) Source
ET Indication de la gencive, plaie
persistante et l’anémie Macération Lubumbashi (RDC) [19,20]
ET Eruption cutanée et épilepsie Infusion Kagera (Tanzanie) [31]
ET Menace d’avortement et gonorrhée Décoction Zambie [32]
F Drépanocytose, paludisme, cancer et plaie Décoction et macération Lubumbashi [19]
F Diarrhée et rhume Macération Burundi [31]
E Morsure du serpent et paludisme Macération Mozambique [36]
ER Paludisme et plaie Décoction RCA [35]
ER Paludisme ; dysenterie et plaies persistantes, règle douloureuses, douleur abdominale Macération Lubumbashi (RDC) [19,20,21]
ER Cancer & plaie Macération Munda (Mozambique) [35]
ER Gastrique et diarrhée Macération Tanzanie [38]
PU : Partie utilisée, ER : écorces de racines, ET : écorces de tige, F : Feuilles, R : Racines, NR : Non Rapporté.
1.1.1.15. Connaissances ethnopharmacologique
Dalbergia nitidula est une plante largement connue et utilisée pour ses vertus médicinales sur le continent africain. Certaines de ces usages ethno médicaux ont fait l’objet d’études ethno pharmacologiques dans l’optique de leur validation (Tableau 8).
Tableau 8. Les activités pharmacologiques évaluées sur Dalbergia nitidula Welw.
PU Activité Extrait (composé) Modèle expérimental Source
F Antioxydante CH₃OH In vitro sur DPPH (Misar et al.,
2005)
PU Activité Extrait (composé) Modèle expérimental Source
F Anti plasmodiale CH₃OH In vitro sur P.
falciparum souche [28]
ET Antiinflammatoire H2O In vivo [43]
ET Anticancéreuse C4H8O2
In vitro [43]
ER Antidiabétique CH₃OH In vitro [28]
ER Anti plasmodiale H2O In vitro P. falciparum [28]
ER Antibactérienne C₃H₆O In vitro sur
Staphylococcus aureus, & P. aeruginosa [28]
Cette étude a été réalisée dans la ville de Lubumbashi, chef-lieu de la province du haut-Katanga, au Sud-Est de la RD Congo. Cette ville a une superficie de 747 km² et une population d’environ 1,794 million (205). Dans cette ville, la végétation caractéristique est la forêt Miombo [40]. Le climat est tropical avec température moyenne de 22,7 °C. Actuellement la ville est subdivisée en sept communes et 44 quartiers.
Quatre sites ont servi de cadres pour nos expérimentations à savoir le site KIPOPO, le laboratoire chimie thérapeutique et le laboratoire de pharmacognosie de l’UNILU.
INERA-KIPOPO a servi de lieu de récolte et de l’identification de Dalbergia boehmii Taub et Dalbergia Nitidula Welw. Cet institut est sis au village KIPOPO vers le nord à 25 km de la ville de Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga. Le relief y est caractérisé par de hauts plateaux d’environ 1187m d’altitude. La station de l’INERA/Kipopo est située en pleine zone climatique semi-aride [41].
Le laboratoire de chimie de l’ISP-Lubumbashi a servi de cadre pour la concentration de nos extraits. Ce laboratoire se situe au numéro 23 de l’avenue de la révolution dans la commune de Lubumbashi.
Le Laboratoire de Pharmacognosie et celui de Chimie thérapeutique de la Faculté des Sciences Pharmaceutiques de l’Université de Lubumbashi ont servi de cadre pour la réalisation de différents tests d’indentification de grands groupes de métabolites secondaires pour l’évaluation des activités cicatrisante, antiinflammatoire et antioxydante. Ainsi que pour les dosages des phénols, des flavonoïdes, des tanins totaux. Ces laboratoires sont situés au numéro 27 de l’avenue Kato dans le quartier Industriel de la commune de Kampemba, dans la ville de Lubumbashi en RD Congo.
Le grand laboratoire provincial de Lubumbashi a servi de cadre pour l’évaluation de l’activité antibactérienne sur les milieux solides et liquides. Il est situé au N°491 de l’avenue Likasi au quartier Camp Assistants, dans la commune et la ville de Lubumbashi.
2.2.1. Matériel végétal
Le matériel végétal utilisé au cours de cette étude a été constitué des feuilles, les écorces de tige, et des écorces de racine. Le choix de ce taxon est lié au fait qu’il est rapportée dans les études ethnobotaniques antérieures réalisées dans la région comme plante cicatrisante (Bashige et al., 2024). Notons que c’est la feuille et la racine qui est utilisée à Lubumbashi pour les propriétés cicatrisantes chez Dalbergia boehmii [20] tandis que chez Dalbergia nitidula c’est la tige et la racine. Toute fois par curiosité scientifique nous avons voulu savoir les écorces de tige ne possèderaient pas également d’activité cicatrisante chez Dalbergia boehmii et aussi la feuille chez Dalbergia nitidula [17].
Ce matériel végétal a été récolté dans la station INERA KIPOPO d’où Dalbergia boehmii (Lat S11°29’10.58532 », l’Altitude: 1177m et et Long E 27°38’43. 80432 ») et Dalbergia nitidula (Lat S11°36’18.97956 », l’altitude:1246m et Long E27°23 »1.91184 ») en compagnie d’un taxonomiste. A l’occasion, un herbier a été confectionné puis déposé à l’herbarium où l’identité du taxon végétal a été confirmée et un code herbier du spécimen déposé attribué (KIP309087776 pour Dalbergia boehmii) et (KIP447989393 pour Dalbergia nitidula).
ⓐ ⓑ ⓒ Figure 7. (a) feuilles, (b) écorces de tige, (c) écorces de racine, sont les matérielles végétales utilisées sur cette étude.
2.2.2. Modèle animal
Les etudes ont été réalisée sur Mus musculus ou souris blanche de poids élevés de 178,33 ± 10,27 g des mâles et les femelles héberger dans l’animalerie de la faculté des sciences pharmaceutiques de l’université de Lubumbashi, lors de l’évaluation de l’activité cicatrisante et anti-inflammatoire. Ces animaux sont utilisés dans les modèles expérimentaux antérieurs aussi bien pour l’activité cicatrisante [41] que pour l’activité antiinflammatoire [41].
Figure 8. Mus musculus a ete utilisés comme modèle animale utilisées sur l’activité cicatrisante et antiinflammatoire sur cette étude.
2.3.3. Matériel biologique
2.3.3.1. Souches bactériennes
Le préalable à la mise en œuvre des tests d’activités antibactériennes sur des extraits est l’évaluation de leur qualité microbiologique [43]. Dans cette étude, nous avons utilisé Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa et Staphylococcus aureus comme supports microbiens. Les germes utilisés lors de cette étude ont été choisis en fonction des usages anti-infectieux rapportés dans les travaux antérieurs issus de la littérature [42], en médecine traditionnelle ; Escherichia coli (pour les infections digestives), Pseudomonas aeruginosa et Staphylococcus aureus (pour les infections nosocomiales). En grosso modo, ces souches sont choisies en fonction de leur capacité à retarder la cicatrisation d’une plaie et on les retrouve généralement dans les infections des plaies [14,15]. Elles ont été fournies par le laboratoire provincial d’analyses biomédicales de Lubumbashi, l’un des structures de santé au niveau national et provincial en RD Congo.
2.3.4. Le DPPH (2,2-diphényl-1-picrylhydrazyl)
Le DPPH (2,2-Diphenyl-1-picylhydrazyl) est un radical libre stable qui possède un électron célibataire sur l’atome d’azote. Il est de couleur violacée et absorbe à 517 nm [30]. Il fut l’un des premiers radicaux libres utilisés pour étudier la relation entre la structure et l’activité antioxydante des composés phénoliques [31]. En présence d’un antioxydant, l’électron célibataire devient apparié, ce qui conduit à la décoloration du DPPH du violet (forme radicalaire DPPH) au jaune (forme réduite DPPH-H). Cette décoloration représente donc la capacité à extraire ce radical [31], repris par [12]Le DPPH utilisé dans la présente étude a été fourni par Sigma Aldrich (1898-66-4, UK). Il a servi à l’évaluation de l’activité antioxydante des extraits (sous forme d’évaluation du pouvoir anti radicalaire) selon la méthode décrite par[31] . Cette substance a été préparée à 0,002 % (m/v ; solvant : éthanol 95 %). Elle est utilisée comme substrat des substances anti radicalaires dans plusieurs criblages phytochimiques
[30,31]
(a) (b) Figure 9. Réaction de réduction du DPPH par un antioxydant (Chimactiv, 2020) (a) DPPH au radical et (b) Réduction du DPPH.
2.3.5. Reference aux témoins
Pendant notre expérience, Quatre substances ont été utilisées comme contrôles positifs au cours de cette étude : Augmentin® (acide clavulanique + amoxicilline) et Norfloxacine pour l’évaluation de l’activité antibactérienne, Diclofenaque pour l’activité anti-inflammatoire et enfin Madecassol ® (Asiaticoside) pour l’évaluation de l’activité cicatrisante. Ces témoins ont fait l’objet d’études antérieures.
3
1
4 5 6 Figure 10. Les témoins utilisées: (1) Amoxicilline, (2) Acide clavulanique, (3) Norfloxacine, (4) Quercétine, (5) Diclofenaque, (6) Asiaticoside.
2.3. Méthodes et Protocoles expérimentaux
2.3.1. Récolte, identification et traitement physique des échantillons
La récolte des feuilles, des écorces de tige et des écorces de racines de Dalbergia boehmii et Dalbergia nitidula a été réalisée en compagnie d’un botaniste. L’authenticité de la plante a été vérifiée à l’aide des herbiers de l’herbarium de la station Kipopo. Pour chaque organe récolté, les coordonnées GPS ont été relevées et les herbiers ont été constitués. Les drogues végétales ont été lavées à l’eau distillée, séchées à la température ambiante et à l’abri de la lumière actinique. Après séchage, le matériel végétal a été broyé à l’aide d’une machine à broyer, puis conditionné dans des sachets et conservé à l’abri de la lumière dans un réfrigérateur.
Figure 11. Traitements physiques de plantes récoltées.
2.3.2. Obtention d’extraits
Les extraits éthanoliques ont été obtenus par macération pendant 48h. En effet, 500g de poudre de la drogue végétale pulvérisés ont été macéré dans 1,5litres d’une solution hydro-alcoolique. Une filtration, puis un épuisement de la drogue par trois avec le même solvant organique ont permis de rentabiliser l’extraction. Les filtrats ont ensuite été réunis et concentrés entre 36°c et 40°c, sous pression réduite (130-80 mbar) à l’aide d’un évaporateur rotatif.
2.3.3. Evaluation de l’activité cicatrisante
L’activité cicatrisante a été évaluée en s’inspirant d’un protocole utilisé précédemment [32]. En bref, vingt souris (114,77 ± 35,30g) ont été acclimatées ensemble pendant 7 jours. Elles ont mangé à des heures bien précises et bu à volonté dans des cages métalliques de 0,75 x 1,5 m2, en présence d’une lumière régulée dans un cycle de 12 heures. Après acclimatation, les sujets soumis à l’expérimentation ont été préalablement répartis en 6 groupes de 3 animaux chacun (tableau 9).
Tableau 9. Répartition des échantillons en groupes sur l’activité cicatrisante.
Groupe Abréviation Traitement
Contrôle normalité Cnor Solution physiologique 0.9%
Contrôle positif Cpos Madécassol
Essai 1 DaBoF Extrait éthanolique des feuilles de Dalbergie boehmii
Essai 2 DaBoET Extrait éthanolique des écorces tige de Dalbergie boehmii
Essai 3 DaBoER Extrait éthanolique des écorces racine de Dalbergie boehmii
Essai 4 DaNiF Extrait éthanolique des feuilles de Dalbergie nitidula
Essai 5 DaNiET Extrait éthanolique des écorces tige de Dalbergie nitidula
Essai 6 DaNi ER Extrait éthanoliques des écorces racines de Dalbergia nitidula
Les Mus musculus ont ensuite été anesthésiés par une injection intramusculaire de Lidocaïne à 2 % à raison de 20 mg/kg. Une fois l’animal anesthésié, il a été placé en décubitus ventral sur la table d’opération. Le dos a ensuite été nettoyé à l’aide de savon antibactérien (Dettol®) pour faciliter le rasage. Ce dernier a été effectué avec une lame de rasoir (Dorco HQ®). La peau a ensuite été désinfectée à l’aide d’éthanol à 70 %, appliqué avec des compresses de gaze (10 × 10).
Une figure géométrique ronde de 11,29 mm de diamètre, soit une surface de 100,06 mm2, a été imprimée sur le dos de l’animal. Sur le lieu de l’excision marqué, un lambeau de peau a subi une incision dermique profonde avec réalisation de la plaie. Celle-ci a été traitée par application locale de l’extrait (100 %) selon le groupe testé une fois par jour jusqu’à la cicatrisation complète. Après deux jours, la surface de la plaie et le poids du cobaye ont été mesurés, précédés d’un examen visuel et de toutes les observations qui ont été notées en respectant les différents paramètres d’évaluation. Les analyses macroscopiques ont permis d’évaluer la cicatrisation.
Evaluation de l’aspect macroscopique
L’aspect macroscopique a été apprécié par un score d’évaluation basé sur la fermeture de la plaie et l’inflammation, hémostase, granulation et épithélialisation. La fermeture de la plaie a été évaluée par la surface apparente et l’inflammation par la tuméfaction, la rougeur et l’exsudat.
Une note de 0 à 3 a été attribuée selon l’appréciation de l’intensité de chaque paramètre (tableau 10), puis les quatre notes ont été additionnées. Un score de 0 indique une meilleure évolution de la plaie, tandis qu’un score maximal de 3 indique le pire [32].
Tableau 10. Critères d’évaluations de l’aspect macroscopique des plaies sur l’activité
cicatrisante.
Critère Score Signification
Tuméfaction 0 Absente
1 Faible
2 Modérée
3 Importante
Surface 0 Réduction Importante
1 Réduction Modérée
2 Réduction Faible
3 Absence de Réduction
Exsudat 0 Absence
1 Faible
2 Modérée
3 Importante
Rougeur 0 Absente
1 Faible
2 Modérée
3 Importante
- Evaluation de la contraction de la plaie
Nous avons évalué les surfaces des plaies au cours de notre expérimentation, en déterminant leurs moyennes et écarts-types. Cela nous a permis de calculer le pourcentage de contraction (TCP) des plaies selon la formule suivante :
TCP = x 100 % - Performance de cicatrisation (PC)
La performance de cicatrisation permet d’évaluer le gain en jours de cicatrisation procuré par l’application du produit testé. Il est calculé par la formule suivante :
(%) PC x100 %
Avec Jx = nombre des jours qu’a pris la plaie pour être cicatrisé après l’application du produit, Ja est le nombre de jours de cicatrisation observé avec le groupe de contrôle négatif.
Le temps de gain de cicatrisation (GTC) a été déterminé en faisant la différence entre le temps de cicatrisation complète du contrôle de normalité (TCNor) avec le temps de cicatrisation complète des essais (Tx).
GTC = 𝑇𝐶𝑛𝑜𝑟 − 𝑇𝑋
Le temps de contraction de la plaie (TCP50) à 50 %, la surface de contraction de la plaie au jour médian (SCPM) et l’indice de contraction de la plaie au jour Médian (ICPM) ont été déterminés graphiquement. Ils ont contribué à apprécier la cicatrisation et à classifier les extraits.
2.3.4. Evaluation de l’activité Anti-inflammatoire in vivo de l’œdème de la patte de rat
induite par le formol
L’activité anti-inflammatoire a été évaluée in vivo, par la méthode de l’œdème de la patte de souris induit par le formol 10 % en s’inspirant de la méthode développée par l’équipe d’Oppong [35]. Brièvement, les souris, réparties en 8 lots de 3 animaux chacun de poids 126,03 ± 40,85g, ont été pesées, puis mises à jeun pendant 12 heures avant l’expérimentation. Pour chaque souris, le volume initial (V0) de la patte postérieure gauche a été mesuré à l’aide d’un pied à coulisse ou pléthysmomètre à eau (APELEX 05-7150, Allinde, Bagneux, France), pour déterminer le volume d’œdème induit.
Ensuite, chaque souris a reçu une injection de 0,002 µL de solution de formol à 1 % sous le coussinet plantaire de la patte postérieure gauche. Chaque souris a ensuite reçu un traitement en fonction de son groupe (Tableau 11).
Tableau 11. Répartition des échantillons en groupes sur l’activité anti-inflammatoire.
Groupe Abréviation Dose (mg/Kg) Gavage
Contrôle de normalité
Contrôle positif
Groupes test 1
Groupe test 2
Groupe test 3
Groupe test 4
Groupe test 5
Groupe test 6 Cnor
Cpos
DaBoF
DaBoET
DaBoER
DaNiF
DaNiET
DaNiER
–
150
250 500
250 500
250 500 250
500 250
500
250
500 NaCl (0,9 %)
Diclofénac
Dalbergia boehmii F
Dalbergia boehmii ET
Dalbergia boehmii ER
Dalbergia nitidula F
Dalbergia nitidula ET
Dalbergia nitidula ER
Les volumes des pattes ont été mesurés 2, 4, 5, 6, 8 et 10 heures ou soit, 600 minutes après injection du formol, toujours à l’aide d’un Pied a coulisse ou Pléthysmomètre à eau (APELEX 05-7150, Allinde, Bagneux, France).
La variation de l’œdème a été appréciée par la détermination du pourcentage de diminution du volume de la patte de rat suivant la formule suivante:
%ΔL x 100 %
Avec Vt est le volume de la patte au temps t, L0 volume initial de la patte.
L’activité anti-inflammatoire a été évaluée par le calcul du pourcentage d’inhibition (%INH) de l’œdème selon la formule suivante :
% AAIx
Avec %ΔLCnég : taux de variation de volume du contrôle négatif et %ΔLx : taux de variation du volume du groupe essais AAIx est l’Activité anti-inflammatoire du groupe x (exprimée en %).
2.3.5. Evaluation de l’activité de l’activité antioxydante
L’évaluation de l’activité antioxydante a utilisé la méthode au DPPH telle que décrite précédemment par [12]. C’est une méthode Spectrophotométrique qui consiste à piéger le radical libre du DPPH par l’extrait à potentiel antioxydant puis à lire la quantité restante du DPPH et déduire le pouvoir anti radicalaire de l’extrait.
Pour ce faire, 50 µL d’extrait ou de contrôle positif ont été préparés à différentes dilutions d’ordre 2 et mis en interaction avec 1950 µL de solution méthanolique de DPPH à 0,002 % dans une plaque à 96 puits. Après le mélange et l’incubation à l’obscurité pendant 30 minutes, l’absorbance de la solution a été mesurée au spectrophotomètre à 492 nm. Les tests ont été effectués en triplicata. La solution du DPPH à 0,002 % a été utilisée comme témoin négatif. Le pourcentage d’activité antioxydante a été calculé comme suit :
AAO (%) =
Où, Ab = absorbance mesurée en présence du témoin négatif ; Ae = absorbance mesurée en présence de l’extrait, I (%) = Pourcentage d’inhibition.
2.3.6. Evaluation de l’activité Antibactérienne
L’objectif de cette etude est de déterminer parmi les extraits prépares, ceux qui ont une activité inhibitrice sur les bacteries. Levaluation de l’activité antibacteriennes a ete realisée par la méthode de diffusion de disque sur un milieu gelose [33].
- Preparation des milieu de culture
Pour tester l’activité antibactérienne de l’extrait brut sur les souches obtenues, les milieux solide et liquide Mueller-Hinton a été préparée et utilisés pour l’évaluation sur cette dernière. La préparation du bouillon de culture Mueller-Hinton (MH), a consisté à peser 2,10 g de milieu MH puis le dissoudre en ajoutant de l’eau distillée jusqu’à un volume de 100 mL.
Le mélange obtenu a ensuite été stérilisé à l’autoclave à 121 °C pendant 15 minutes, puis refroidi une nuit entre 2 et 8 °C ou dans un bain de glace.
Pour préparer le milieu solide Mueller-Hinton, 3,4 g du milieu de Mueller-Hinton agar ont été pesés puis une suspension a ensuite été réalisée dans 100 mL d’eau distillée puis stérilisée à l’autoclave à 121 °C pendant 15 minutes, laissée refroidir jusqu’à 50 °C, puis agitée, avant d’être coulée dans des boîtes de Pétri stériles. - Préparation de l’inoculum standard
Les inocula bactériens ont été standardisés selon la technique décrite par Perilla, (2003), en dispersant des souches pures dans du Bouillon thioglycolate et en les maintenant à 37 °C pendant 24 h. La turbidité de la suspension microbienne a été ajustée à l’aide d’un densitomètre à un standard de 0,5 Mc Ferland, équivalent à environ 1,5 × 108 cellules microbiennes. mL-1 [11] - Détermination des diamètres des zones d’inhibition (DZI), CMI (concentration minimale inhibitrice), CMB (Concentration minimale bactéricide) et Effet de l’extrait
Pour la détermination de la sensibilité, dans des boîtes de Pétri stériles, 20 mL de gélose MullerHinton ont été versés puis laissés au repos pendant 20 minutes. Après solidification, sur chaque milieu de culture, 1 mL de suspension bactérienne de 108 CFU (Colony Making Unit). Mb L–1 a été ensemencé sur toute la surface. Des disques de papier buvard (ø = 6 mm) ont été imprégnés d’un volume de 5 µL d’extraits (50 µg. mL–1) et déposés à la surface du milieu solidifié et infecté. Les boîtes de Pétri ont ensuite été incubées à 37 °C pendant 48 h à l’étuve. La sensibilité des germes aux extraits a été estimée en mesurant le diamètre (mm) de la zone d’inhibition induite par les différentes concentrations autour des disques et chaque expérience a été répétée trois fois (20;31).
Concernant la détermination de la CMI, de chaque extrait à 2 mg dissous dans 100 µL du méthanol, ont été mélangés 900 µL de milieu de culture. Cinq dilutions successives d’ordre 2 ont ensuite été réalisées pour chaque extrait et placées dans différents tubes aseptiques de 5 mL ; 1000 µL de l’inoculum standard ont ensuite été ajoutés dans chaque tube (1000 µg. mL-1 – 31,25 µg. mL-1) et le mélange a été incubé pendant 24 h à 37 °C. La croissance des microorganismes a été observée visuellement. La CMI considérée comme la concentration la plus faible à laquelle l’extrait a empêché la croissance visible des bactéries a été déterminée
(27).
Concernant la détermination de la concentration minimale bactéricide (CMB), le prélèvement a été effectué dans des tubes utilisés pour la détermination de la CMI. L’ensemencement a été réalisé en boîtes de Pétri sur milieu gélose Salmonella-shigella et l’incubation a été réalisée à 37 °C pendant 24 h. La croissance microbienne a été contrôlée visuellement et la CMB, définie comme la plus petite concentration à laquelle l’extrait a empêché la croissance visible des bactéries après repiquage, a été déterminée (10).
L’effet des extraits a été déterminé en effectuant le rapport CMB /CMI. Si le rapport est inférieur ou égal à 2, l’extrait est bactéricide, s’il est supérieur à 2, l’extrait est bactériostatique selon le cas (19).
2.3.7. Criblage phytochimique
2.3.7.1. Identification des grands groupes phytochimiques
Le criblage de grands groupes phytochimiques a porté sur les réactions en solutions. Elles sont basées sur la coloration, la précipitation ou la formation des mousses [53]. - Flavonoïdes
La mise en évidence des flavonoïdes a recouru à la réaction de Shinoda. Brièvement, 5 g du matériel végétal placé dans un erlenmeyer ont été infusés dans 50 mL d’eau distillée pendant 30 minutes. Après filtration, 5 mL de filtrat ont été traités par le réactif de Shinoda, puis 5 mL d’eau distillée, 5 mL d’acide chlorhydrique concentré, quelques gouttes d’alcool isoamylique et 0,5 g de copeaux de magnésium y ont été ajoutés successivement. La coloration rouge orangé (flavone), rouge ou rouge violet (flavonone) ou rouge cerise (flavonol) apparaissant dans la couche surnageant signe une réaction positive en flavonoïdes. De même, la réaction effectuée pendant deux minutes au bain-marie en l’absence de copeaux de magnésium permet de caractériser les anthocyanes lorsqu’apparaît une coloration rouge. - Hétérosides cyanogènes
La mise en évidence des hétérosides cyanogènes consiste à placer 5 g de poudre végétale dans un erlenmeyer avec 10 mL d’eau distillée. Fermez ensuite l’erlenmeyer avec un bouchon auquel est fixée une bandelette de papier picrosodé légèrement humectée d’eau. Chauffer légèrement la solution : le papier picrosodé jaune vire alors à l’orange ou au rouge si l’extrait végétal libère de l’acide cyanhydrique (30). - Quinones
Les quinones ont été identifiées par la réaction Bornträger en présence d’une base de KOH à
1%. Pour ce faire, 5g de poudre végétale ont été macérés pendant 24 h dans l’éther de pétrole.
Après filtration, 10 mL de filtrat éthéré ont été traités par 5mL de NaOH 1%. L’apparition d’une coloration rouge violacée dans la phase indique la présence des quinones libres et celle jaune ou orange indique les quinones liées (41) . - Saponines
La détection des saponines est basée sur leur pouvoir moussant. Pour une mousse non persistante, le filtrat en milieu acide en présence de dichromate de potassium donne une coloration vert sale ou violette virant au rouge (41). Dans un erlenmeyer contenant 1 g de matériel végétal broyé grossièrement, ajouter 100 mL d’eau distillée pour réaliser une décoction pendant 30 minutes. La solution est ensuite filtrée après refroidissement. 15 mL de décoctés sont introduits dans un tube à essai de 160 mm de haut et 16 mm de diamètre. Le contenu du tube est agité hermétiquement pendant une minute. Après agitation, laisser reposer la solution pendant 10 minutes puis mesurer la hauteur de la mousse.
En cas d’obtention d’une mousse de moins de 10 mm, tester la présence de saponines à l’aide des réactifs (Mélange d’acide sulfurique 1N et dichromate de potassium 10 %). L’apparition d’une coloration violette virant au rouge ou au vert indique la présence des saponines (41;33). - Stéroïdes et Terpénoïdes
Les stéroïdes et les terpénoïdes ont été identifiés comme suit : 5g de matériel végétal sont mis à macérer pendant 24 heures dans l’éther de pétrole. Après filtration, le solvant est évaporé à sec. Dans le résidu obtenu, ajouter successivement en agitant, 2 mL de chloroforme, 0,5 mL d’anhydride acétique et trois gouttes d’acide sulfurique concentré. L’apparition des colorations mauve ou verte indique la présence des stéroïdes.
En plus du test utilisé pour la recherche des stéroïdes, quelques gouttes du réactif de Hirschson (Acide trichloracétique 20 %) sont ajoutées à 4 ou 5 mL de la solution acidifiée. La coloration jaune virant au rouge indique la présence de terpénoïdes (41). - Tannins
Ils ont été identifiés suivant le protocole ci-après : 5 g de matériel végétal ont été infusés dans 50 ml d’eau contenue dans un erlenmeyer pendant 30 minutes. 5 ml de l’infusé ont été prélevés et additionnés de 1 ml de chlorure ferrique 1 % (p/v). Le test a été considéré positif lorsqu’un précipité ou une coloration bleu vert, bleu sombre ou verte apparaissait. 15 ml de réactif de Stiasny ont été ajoutés à 30 ml de l’infusé, le mélange a été porté au bain-marie à 90 °C. L’apparition d’un précipité indiquait la présence des tanins catéchiques. La solution a ensuite été filtrée, le filtrat a été saturé d’acétate de sodium avant d’y ajouter quelques gouttes de chlorure ferrique. La formation d’un précipité dans ce cas a révélé la présence de tanins galliques (41). - Alcaloïdes
La mise en évidence des alcaloïdes a consisté à les précipiter à l’aide de six réactifs de précipitation. Pour cela, 1g de poudre de matière végétale sèche a été macéré dans 10 mL de méthanol à température ambiante pendant 24 heures puis à l’étuve à 50 °C pendant 4 heures. La solution obtenue a été filtrée puis le marc lavé trois fois avec des portions de méthanol chaud. Le filtrat a été évaporé à sec à l’étuve à 50°C. Le résidu a été recueilli deux fois par 2 mL de solution chaude d’acide chlorhydrique 1 % (320331 Sigma aldrich, USA). La solution acide obtenue a été alcalinisée par l’ammoniac concentré (338818 Sigma-aldrich, UK) dans une ampoule à décanter (532-0007 VWR, Belgique) puis 15 mL de chloroforme (288306 Sigmaaldrich, USA) y ont été ajoutés et deux phases se sont formées. Après agitation et repos, les deux phases ont été reposées. Cette opération a été reprise trois fois. La phase organique a été évaporée à sec à l’air libre et le résidu obtenu repris par 0,5 mL de chloroforme et transféré dans un tube à essais auquel on a ajouté 0,5 mL de HCl 1 %. Les alcaloïdes ayant été protonés sont supposés se trouver dans la phase aqueuse. Celle-ci, qui est au-dessus a été prélevée à l’aide d’une pipette Pasteur. Six gouttes ont été déposées sur une lame porte-objet. Chacune de ces gouttes a été traitée par chacun des six réactifs de précipitations notamment Dragendorff, Mayer, Hager, Wagner, Bertrand et Sonnenschein. La présence d’alcaloïdes n’a été considérée comme certaine que si chacun des six réactifs donne un précipité. La méthode permet de détecter jusqu’à des teneurs d’alcaloïdes inférieures à 0,01 % sur une prise d’échantillon de 1g
(35).
2.3.7.2. Dosage de tannins totaux (TT)
La teneur en tannins totaux des extraits éthanoliques des feuilles, des écorces de tige et des écorces de racine de Dalbergia boehmii et Dalbergia nitidula a été estimée selon la méthode développée (11). Un volume de 50 µL d’extrait a été ajouté à 1500 µL de la solution vanilline/méthanol à 4 %, puis mélangé vigoureusement. Ensuite un volume de 750 µL de l’acide chlorhydrique concentré (HCl) a été additionné et le mélange obtenu a été laissé à température ambiante pendant 20 minutes. L’absorbance a été mesurée à 550 nm. Une solution témoin de l’acide gallique a été préparée à différentes concentrations (31,25 à 500 µg/mL), une courbe a été établie (y = ax + b, R2 = 0) et les résultats obtenus ont été exprimés en mg d’équivalent acide gallique (mg gallique / g d’extrait sec : mg EQ/g d’extrait sec).
𝑻𝑻 = 𝑷𝑻 − 𝑷𝑵𝑻
2.3.7.3. Dosages des polyphénols totaux
La teneur en polyphénol totaux des extraits ethanoliques des feuilles, des écorces de tige et des écorces de racine de Dalbergia boehmii et Dalbergia nitidula. Une solution à 1 % d’extrait de plante a été préparée dans du méthanol et les phénols totaux ont été détermines dans l’extrait par une méthode (24). Pour ce faire, 0,5 mL de l’échantillon a été prélevé dans une éprouvette puis mélangé avec 5 mL de réactif de Folin-Ciocalteu dilué au dixième. Après repos de 5 minutes, 2,5 ml de carbonate de sodium à 7,5% ont été ajoutés. Les tubes alors été recouverts de parafilm et gardés 40 minutes à température ambiante. Les absorbances ont été lues à 725 nm au spectrophotomètre (U-1800, Hitachi, Japon). Les résultats sont exprimés en équivalent acide gallique (mg/g EAG). Ce dernier est préparé à diverses concentrations en progression arithmétique de raison 0,01 (de 0,01 à 0,05 mg/mL dans le méthanol). Le réactif de FolinCiocalteu est sensible aux composés réducteurs, y compris polyphénols et produit une coloration bleue en leur présence.
2.3.7.4. Dosages des flavonoïdes totaux (FT)
La teneur en flavonoïdes totaux des extraits éthanoliques des feuilles, des écorces de tige et des écorces de racine de Dalbergia boehmii et Dalbergia nitidula a été estimée selon la méthode développée (11, 27). En effet, 1,0 mL de la solution aqueuse de l’extrait ont été mélangés avec 4,0 mL d’eau distillée, puis avec 0,30 mL d’une solution de NaNO₂ 10 %. Après 5 minutes,
0,30 mL d’une solution d’AlCl3 10 % ont été ajoutés, suivis de 2,0 mL d’une solution de NaOH 1 %. Immédiatement après avoir bien mélangé, l’absorbance a été mesurée à 510 nm par rapport au blanc. Une courbe standard de quercétine a été préalablement établie à partir d’une gamme de 5 solutions préparées par dilution d’ordre 2, allant de 0,1 à 1 mg/mL (y = ax + b, R2 = 0) et les résultats obtenus ont été exprimés en mg d’équivalent-quercétine/g d’extrait sec (mg EQ/g).
2.3.8. Essais physicochimiques sur la poudre du taxon de Dalbergia boehmii et Dalbergia nitidula.
Eu égard aux éléments qui devaient être pris en compte pour le contrôle qualité de la drogue végétale, les protocoles ont été élaborés en accord (38) et suivant les directives European Médicines Agency : EMA dans ses directives d’acceptance d’une drogue végétale ou un médicament traditionnel 25). Les analyses ont porté tant sur la poudre que sur l’extrait.
- Examens visuels sur la poudre
L’examen visuel a consisté en une observation minutieuse de la drogue pulvérisée des paramètres organoleptiques ci-après : texture, granulométrie, humidité apparente, couleur, odeur, saveur et hygroscopicité (Tableau 12).
Tableau 12. Examens visuels des poudres utilisées lors de cette etude.
Paramètres Possibilités Résultats
Granulométrie Impalpable, micronisé ou granuleuse +
Humidité apparente Sèche, très sèche, humide, très humide +
Couleur Recours à la table des couleurs A préciser
Odeur Caractéristique ou non A préciser
Saveur Caractéristique ou non A préciser
Hygroscopicité NH, H +
NH : non hygroscopique (-), H : hygroscopique (+), Résultats attendus.
- Matière sèche (MS) et perte à la dessiccation (PD)
La matière sèche est déterminée après dessiccation de chaque échantillon dans une étuve ventilée à 105 °C jusqu’au poids constant. La différence de poids corresponds à la perte d’humidité et le résidu représente donc la teneur en matière sèche (24).
Dans une capsule à fond plat d’un diamètre d’environ 50 mm et d’une hauteur d’environ 30 mm, pesez rapidement 0,50 g de la drogue sèche finement pulvérisée. Desséchez à l’étuve à 105 °C pendant 3 h. Laissez refroidir dans un dessiccateur sur du pentoxyde de diphosphore ou sur du gel de silice anhydre, puis pesez. Exprimez le résultat en % (28; 38).
PP = poids postérieur c’est-à-dire poids après séchage à l’étuve et PA= poids antérieur (poids avant le séchage).
- Cendre Totale (CT) matière minérale (MM)
Introduisez dans un creuset en porcelaine (Verset, UK), 1,00g de drogue pulvérisée. Distribuez uniformément la prise d’essai à l’intérieur du creuset. Desséchez à l’étuve pendant 1 h entre 100 et 105 °C, puis incinérez dans un four à moufle (CWF 1030, UK) à une température de 600
± 25 °C (l’échantillon ne doit s’enflammer à aucun moment de l’opération) jusqu’à masse constante. Après chaque incinération, laissez refroidir le creuset au dessiccateur, puis peser à l’aide d’une balance analytique (Radwag AS 220/C/2, Allemagne). Calculer la teneur en cendre totale par la formule ci-après (28; 38) :
CT(%)= Où CT (%) : pourcentage de cendres totales ; PA : poids après
incinération ; PV : poids du creuset vide et Pe : prise d’essai. - Indice de Gonflement (IG)
Dans une éprouvette graduée de 25 mL à bouchon rodé dont la graduation est divisée en 0,5 mL occupe une hauteur de 125 ± 5 mm, introduisez 1,0 g de drogue entière ou dans l’état de division prescrit dans la monographie. Humectez la drogue avec 1,0 mL d’alcool 90° et ajoutez 25 mL d’eau distillée. Bouchez l’éprouvette. Agitez énergiquement toutes les 10 min pendant 1 h. Laissez reposer pendant 3 h. 90 min après le début de l’essai, éliminez par rotation autour de l’axe vertical la plus grande partie de liquide retenu au niveau de la drogue et les particules de celle-ci flottant à la surface du liquide. Mesurez le volume occupé par la drogue, y compris le mucilage qui y adhère. Effectuez 3 essais simultanément. L’indice de gonflement est donné par la moyenne des 3 essais (32). - pH
Mesurer le pH de la solution à 1%, 5% et 10 %. Les valeurs de pH sont déterminées par potentiomètre à l’aide des pH-mètres (Memmert, USA). Sa détermination consiste à préparer préalablement une solution à 20 % (solvant : l’eau exempte de CO2). Les électrodes sont ensuite plongées dans la solution à examiner. Il s’en suit la lecture de la valeur affichée à l’écran de l’appareil après stabilisation. Cette lecture s’effectue dans les mêmes conditions que pour les solutions tampons (18 ; 35; 41; 17).
Chapitre 3
Résultats et discussion
3.1. Activité cicatrisante des extraits hydro-alcooliques de Dalbergia boehmii et
Dalbergia nitidula.
L’évaluation de l’activité cicatrisante des extraits de DaBo et DaNi sont appuyée sur les paramètres planimétriques ci-après : (i) Evolution pondérale, (ii) Temps de cicatrisation : TC, (iii) Score de la plaie ; SP, index du temps de cicatrisation médian : ITCM, (iv) Surface de contraction de la plaie : SCP, (v) Taux de contraction de la plaie : TCP, Temps de contraction de la plaie à 50% : TCP50 et (vi) performance de cicatrisation PC.
- Evolution pondérale de la plaie
L’application quotidienne des différents extraits au niveau des plaies des souris a perturbé considérablement l’état général de leur poids tout au long de l’expérimentation. Aucune mortalité n’a été observée. En outre, quelques signes cliniques ont été relevés. Nous pouvons également noter quelques comparaisons prolongées entre les groupes. Le groupe de contrôle normal a montré une diminution de poids entre J3 et J12 avant de connaître une ascension, le groupe positif a montré une diminution de poids au J3 et J12 avant d’évoluer normalement, et le groupe de DaNi F a montré une diminution au J3 mais une augmentation au J21. Il en est de même pour les groupes essais. DaBoFe, DaNi F, DaNiET et DaNi ER ont montré une variation pondérale similaire : augmentation au J3 et J9, puis diminution au J12.
Figure 12. Profil de variation de poids pondéraux des Mus musculus lors de l’activité cicatrisante.
- Score de la plaie (SP), Temps de cicatrisation (TC), Index du temps de cicatrisation
médian (ITCM)
Cette étude a duré 24 jours. La cicatrisation de la plaie, évaluée sous la forme d’un score, a évolué de manière décroissante de 12 à 0. Au jour 12, tous les extraits ont présenté un score deux fois plus élevé que celui obtenu par le contrôle négatif. DaBoR, DaNiR et DaNiT ont ainsi présenté un score moins élevé que les autres, y compris les contrôles positifs.
Le temps de cicatrisation totale de la plaie a varié entre 15 et 24 jours, le meilleur score ayant été observé pour DaBoR, DaNiR et DaNiT. Notons que Madécassol (contrôle positif) a présenté une cicatrisation totale aux 18 jours, de même que DaNiF et DaBoFe. Seul le groupe contrôle négatif a cicatrisé au 24ᵉ jour. Ainsi, l’administration des extraits a favorisé un gain de temps de cicatrisation variant entre 7,5 et 12 jours. .
36
J Contrôle (-) Contrôle (+) DaBoF DaBoET DaBoER DaNiF DaNiET DaNiER
0
3
1
2
37
1
5
1
8
2
4
Figure 13. Jours des observations visuels de la cicatrisation des plaies.
Figure 14. (a) Aspect macroscopique de score, (b) Gain de temps de cicatrisation, (c) temps de cicatrisation et (d). Score de cicatrisation de plaie.
SCPM et TC sont deux paramètres métriques basés sur les observations visuelles qui qualifient l’évolution macroscopique de la cicatrisation à mi-temps de l’observation et à la fin de l’observation et le gain de temps de cicatrisation est un variable qui dérive du temps de contraction complète de la plaie.
- Surface de la plaie (SP), Taux de contraction de la plaie (TCP100), Jour de
contraction de la plaie a 50% (JCP50) et l’Indexe de de cicatrisation (ICM). La contraction progressive de la surface de la plaie est observée à partir de la première semaine, correspondant à la période inflammatoire, dans tous les types de plaies. Au jour zéro, toutes les plaies avaient le même diamètre de 11,29 mm et présentaient les mêmes signes d’inflammation. L’observation des plaies traitées avec les différents extraits a montré une diminution de leurs surfaces au fil du temps. Cette réduction est variable d’un extrait à l’autre et se produit à des rythmes différents. La surface a évolué de 100,06 mm2 à 0 mm2 dans l’intervalle de temps d’observation (24 jours). Le taux de contraction de la plaie (TCP) a varié entre 0 et 100 % en fonction de la cinétique propre à chaque extrait. Au jour médian d’expérimentation (J12), le TCPM a varié entre 57,53 % (DaBo Ti) et 47,6 % (Cpos). Le temps nécessaire pour réaliser une contraction de 30 % de la plaie (TCP50) a varié entre 7 J (DaBoTi) et 12 J (Cnég), et l’index de cicatrisation (ICM) a varié entre 0,16 et 1 pour les extraits, contre 0,1428 pour le contrôle de normalité.
Figure 15. (a) Surface de la plaie, (b) taux de contraction de la plaie, (c) jour de contraction de la plaie a 50% et (d) Index de cicatrisation median
Les résultats obtenus dans cette étude montrent que les extraits éthanoliques DaBo Ra, DaNi Ti et DaNiRa (15J) possèdent un pouvoir cicatrisant supérieur à celui du contrôle positif (Madecassol®), tandis que les extraits DaBo Fe et DaNi Fe (18J) ont le même pouvoir cicatrisant que ce dernier et que l’extrait DaBoTi (21J) possède un pouvoir cicatrisant inférieur.
Aucune étude n’est rapportée sur l’effet cicatrisant de ces deux plantes, cependant certaines plantes de la même région climatique tropicale, où l’étude a été réalisée, ont fait l’objet d’une évaluation de l’activité cicatrisante par le passé, comme l’espèce Dalbergia saxatilis Hook, au Mozambique (37) montre que l’extrait méthanolique des écorces et tiges de Dalbergia saxatilis a un effet cicatrisant au bout de 18 jours, contre 20 jours pour le témoin positif (L-MESITRAN), et Dalbergia spinosa (Fabaceae) en Inde (22), une autre étude de Coma et al., 2021, sur Dalbergia pinnata, dont les feuilles avaient une activité cicatrisante au bout de 15 jours, contre 17 jours pour le contrôle positif (Madecassol). La même plante a été évaluée (13), dont l’activité a été de 12 jours pour l’écorce de la tige. Il est toutefois difficile de classer les plantes faisant l’objet de cette étude par rapport aux plantes susmentionnées, car les paramètres d’évaluation de la cicatrisation ne sont pas les mêmes.
Cette étude rapporte pour la première fois l’activité cicatrisante de Dalbergia boehmii et de Dalbergia nitidula. Cette activité cicatrisante pourrait être justifiée par la présence de tanins et de flavonoïdes, qui sont réputés antigéniques et peuvent empêcher la nécrose (36).
L’évaluation de l’activité anti-inflammatoire a été réalisée par irritation de la patte postérieure de la souris au formol 2%. Elle s’est basée uniquement sur la variation du volume de la patte avant et après exposition en fonction du temps.
Les résultats obtenus montrent une régression importante du volume de la patte avec le DaNiT et le DaNiFe par rapport aux autres extraits, à la dose de 250 mg kg⁻¹, et même à la dose de 250 mg kg⁻¹. L’étendue de l’activité varie de 1,5 à 3,5 et l’extrait d’DaNiT a démontré une réduction du volume de la patte supérieure par rapport aux autres allant de 25,86 ± 1,6 % à 4,2 ± 0,4 % à la dose de 250 mg kg⁻¹, tandis qu’à 500 mg kg⁻¹, l’extrait de DaNiT montre une efficacité allant de 21,9 ± 1,7 % à 0,0 ± 0,0 %. Ces résultats sont quasi équivalents à ceux du diclofénac (témoin positif).
Tableau 13. Variaton du volume des rats irrités a la patte au formoles 1% et traités par les
extraits de DaBo et DaNi.
Groupe (mg/kg %
ΔL1H ΔL2H ΔL5H ΔL6H ΔL8H ΔL10H
Cnég 39,5 ± 1,5 30,5 ± 1,6 25,9 ± 1,2 20,8 ± 0,8 12,9 ± 0,5 6,3 ± 0,3
Diclofenaque 250 23,4 ± 1,3 19,01 ± 1,4 15,08 ± 1,9 10,76 ± 1,3 6,87 ± 1,9 4,9 ± 1,2
Diclofenaque 500 23,4 ± 1,3 22,8 ± 1,9 17,3 ± 1,2 11,81 ± 1,1 6,3 ± 0,2 0,0 ± 0,0
DaBoFe250 37,3 ± 1,8 30,4 ± 1,6 21,5 ± 1,4 17,6 ± 1,1 11,7 ± 0,8 8,8 ± 0,5
DaBoFe500 37,3 ± 1,8 38,4 ± 1,8 33,6 ± 1,9 27,5 ± 1.8 22,1 ± 0,8 16,5 ± 0,9
DaBoTi250 39,3 ± 1,6 30,48 ± 1,4 23,5 ± 1,2 17,78 ± 1,1 13,2 ± 0,9 10,1 ± 0,5
DaBoTi500 39,3 ± 1,6 32,8 ± 1,9 27,3 ±1,6 21,8 ± 1,2 16,3 ± 0,1 10,8 ± 0,5
DaBoRa250 27,5 ± 1,9 23,05 ± 1,7 22,06 ± 1,5 17,01 ± 1,2 11,0 ± 1,0 10,1 ± 0,8
DaBoRa500 27,5 ± 1,9 32,5 ± 1,5 27,1 ± 1,3 21,4 ± 1.08 15,6 ± 0,4 9,7 ± 0,6
DaNiFe250 34,4 ± 1,7 29,7 ± 1,5 24,9 ± 1,3 19,02 ± 1,1 17,4 ± 0,9 11,0 ± 0,7
DaNiFe500 34,4 ± 1,7 14,8 ± 1,8 10,3 ± 1,6 6,8 ±1,02 4,35 ± 0,5 1,07 ± 0,2
DaNiT250 25,8 ± 1,6 20,7 ± 1,4 15,8 ± 1,2 10,23 ± 1,0 6,01 ± 0,7 4,2 ± 0,4
DaNiT500 25,8 ± 1,6 21,9 ± 1,7 18,2 ± 1,5 12,06 ± 0,5 6,3 ± 0,2 0,0 ± 0,0
DaNiRa250 33,01 ± 1,8 28,6 ± 1,6 25,01 ± 1,4 20,87 ± 1,2 16,5 ± 0,9 13,4 ± 0,6
DaNiRa500 33,01 ± 1,8 17,8 ± 1,9 13,8 ± 1,6 8,55 ± 1,3 5,1 ± 1,0 1,08 ± 1,0
L’extrait éthanolique de la tige de Dalbergia nitidula, de même que le diclofénac, ont montré à la dose de 250 mg kg^(-1) après 5 heures un taux de réduction de plus de 60 % du volume de patte postérieure et à 500 mg kg^(-1) une réduction à 100,0 ± 0,0 % à 10 heures. L’analyse statistique a été réalisée par une analyse de la variance d’un test de comparaisons multiples de Tukey-Kramer. Toutes les valeurs sont exprimées comme la moyenne ± l’écart-type.
Tableau 14. Effets des extraits sur l’oedem de la patte induite par le formol 1%
Extraits/
Témoins %
ΔL H1 ΔL H2 ΔL H5 ΔL H6 ΔL H8 ΔL H10
CNég 5,1 ± 1,5 10,9 ± 1,2 41,6 ± 1,1 54,2 ± 0,9 66,2 ± 0,7 75,4 ±0,5
Diclo 25 10,4 ± 1,8 29,1 ± 1,6 51,8 ± 1,2 57,1 ± 1,1 79,5 ± 0,8 88,6 ± 0,4
DaBoFe250 11,1 ± 1,8 20,1 ± 1,6 42,5 ± 1,2 59,9 ± 1,1 76,0 ± 0,8 90,2 ± 0,4
DaBoFe500 15,9 ± 2,9 23,5 ± 2,5 50,6 ± 2,1 53,4 ± 2,0 74,2 ± 1,5 91,8 ± 0,9
DaBoTi250 11,6 ± 1,6 18,8 ± 1,5 38,2 ± 1,2 50,9 ± 1,0 58,9 ± 0,5 74,7 ± 0,3
DaBoTi500 15,9 ± 2,8 23,5 ± 2,4 50,6 ± 2,1 53,4 ± 2,0 74,2 ± 1,6 91,8 ± 1,1
DaBoRa250 13,2 ± 1,9 17,5 ± 1,6 45,1 ± 1,4 53,5 ± 1,2 62,3 ± 0,9 78,9 ± 0,6
DaBoRa500 15,1 ± 2,7 18,7 ± 2,5 45,3 ± 2,3 52,9 ± 2,3 59,0 ±1,4 80,0 ± 1,0
DaNiFe250 10,3 ± 1,7 15,2 ± 1,5 45,0 ± 1,2 51,5 ± 1,0 63,2 ± 0,8 89,3 ± 0,4
DaNiFe500 17,0 ± 1,9 21,6 ± 1,5 40,7 ± 1,2 54,8 ± 1,0 69,4 ± 0,8 85,4 ± 0,4
DaNiTi250 8,2 ± 1,6 15 ± 1,4 42,9 ±1,2 52,2 ± 1,0 68,5 ± 0,8 98,4 ± 0,4
DaNiRa250 11,9 ± 1,8 16,1 ± 1,5 43,9 ± 1,1 53,9 ± 0,9 76,6 ± 0,5 92,1 ± 0,2
DaNiRa500 16, ± 1,6 22,5 ± 1,4 45,7 ± 1,2 54,9 ± 0,8 66,9 ± 0,4 81,5 ± 0,4
Figure 16. Taux d’inhibition de la dilatation (%)
Aucune littérature ne rapporte l’activité anti-inflammatoire de ces plantes. Néanmoins, des études ont été réalisées sur des espèces du genre Dalbergia. En l’occurrence, celle effectuée en Algérie sur les extraits éthanoliques d’écorce et de tige de Dalbergia sissoo a permis d’observer un taux de réduction de l’inflammation allant de 44,66 à 77,43 % après 15, 30 et 60 minutes. À la dose de 500 à 1 000 mg/kg, un pourcentage d’inhibition de l’inflammation plus élevé a été observé après 60 et 120 minutes (19).
De même, l’extrait méthanolique de Dalbergia saxatilis montre un taux d’inhibition à 100 % après 9 heures et son contrôle positif à la même heure à la dose de 500 mg/kg (43). La même plante a été étudiée (29), qui montrent que les écorces et tige sont inhibitrices à 100 % après 10 heures à la dose de 500 mg/kg, de même manière que notre extrait. L’extrait de feuille montre quant à lui un taux d’inhibition de 35,85 % (37). Les extraits éthanoliques de Dalbergia melanoxylon sur les écorces de tige montrent aussi un taux d’inhibition décrit par (16 ; 34) sur Dalbergia odorifera : son taux d’inhibition est de 100 % à la 10^e heure pour les extraits éthanoliques de tige. Les extraits éthanoliques de Dalbergia lanceolaria inhibent la patte à 79,89 % après 6 heures, selon l’étude anti-inflammatoire (26) sur Dalbergia panuculata, et à
47,83 % selon l’étude sur les propriétés anti-inflammatoires (23). À 3 heures, évalué (39), il avait présenté un taux d’inhibition allant de 50 à 80 % après 4 heures à la dose de 300 à 500 mg/kg. Par contre, il a été démontré dans cette étude que l’extrait de tige de Dalbergia nitidula a un pouvoir anti-inflammatoire de 80,0 ± 1,0 % à une dose de 500 mg kg-1 après 8 heures, mettant en évidence une activité plus marquée que les espèces antérieurement évaluées.
Parmi les facteurs qui peuvent empêcher une bonne cicatrisation, les infections bactériennes figurent en bonne place (18 ; 40). C’est dans cette optique que nous avons tenu à coupler l’activité cicatrisante à l’activité antibactérienne sur les germes les plus incriminés dans les plaies infectées au cours de cette étude.
Les résultats obtenus en rapport avec l’activité antibactérienne sont consignés dans ce point, où ladite activité est exprimée sous forme de diamètre de zone d’inhibition et de CMI.
3.1. Sensibilité des germes aux extraits
Le diamètre de la zone d’inhibition a été évalué entre 32,25 et 500 µg/mL. Les contrôles positifs ont présenté des DZI ≥ 21 mm alors que le DZI de nos extraits a varié entre 10 et 20 mm suivant les germes. Ainsi l’extrait de PhMuel a présenté les meilleurs diamètres d’inhibition d’aumoins 18 mm chacun à 500 µg/mL sur tous les germes, et 20 mm à 500 µg/mL sur S. aureus (Tableau 16).
Tableau 15. Diamètres d’inhibition (mm) des extraits sur les diffentes souches bactériennes
Conc S. aureus P. aeruginosa K. pneumoniae E. Coli (µg/mL)
Augmentin ≥24 ≥21 ≥24 NA
Norfloxacin NA NA NA ≥ 22 Cnég 0 0 0 0 0
DaBoFe 500 15 14 19 19
250 18 15 17 15
125 16 13 – 14
62,5 – – – 13
31,25 – – – –
Conc
(µg/mL) S. aureus P. aeruginosa K. pneumoniae E. Coli
DaBoTi 500 18 14 – 20
250 16 15 15 18
125 13 – 13 16
62,5 15 – – –
31,25 – – – –
DaBoRa 500 17 14 20 19
250 13 13 – 17
125 – – – –
62,5 – – – 13
31,25 – – – –
DaNiFe 500 14 16 19 19
250 13 14 18 14
125 – – 16 15
62,5 – – – –
31,25 – – – –
DaNiTi 500 17 12 15 –
250 15 – – –
125 10 – – 18
62,5 – – – 16
31,25 – – – –
DaNiRa 500 15 13 15 19
250 13 – 13 17
125 – – – – 62,5 – – – 13
Conc
(µg/mL) S. aureus P. aeruginosa K. pneumoniae E. Coli
31,25 – – – –
Cnég : Contrôle positif ; DZI : Diamètre de zone d’inhibition.
D’autre part, des études antérieures ont proposé une classification de l’activité antibactérienne des extraits en fonction de leurs diamètres de zone d’inhibition. Cette classification se présente comme suit : extrait inactif si DZI≤ 8 mm, extrait modérément actif si 8< DZI ≤ 12 mm, extrait actif si 12< DZI < 20 mm et extrait très actif si DZI ≥ 20 mm (41 ; 31). Suivant cette classification, la sensibilité évaluée entre 250 et 500 µg/mL au cours de cette étude a varié différemment selon les germes. Les contrôles positifs utilisés lors de cette étude ont présenté des DZI ≥ à 12 mm, ils sont donc actifs. Selon cette classification, la sensibilité évaluée entre 31,25 et 500 µg/mL au cours de cette étude a varié différemment selon les germes. Les contrôles positifs utilisés lors de cette étude ont présenté de DZI ≥ 22 mm, ils sont donc très actifs. Les résultats extraits de DaBo Ra (DZI : 20 mm) exercent un effet antibactérien très actif à une concentration de 500 µg/mL sur le germe E. coli, tandis qu’à 31,25 µg/mL tous les germes ont été insensibles aux extraits. Aucune étude accessible n’est rapportée sur l’activité antibactérienne des extraits éthanoliques de ces deux taxons. Néanmoins, des études ont démontré l’activité antibactérienne sur certaines espèces du genre Dalbergia. C’est le cas notamment de l’étude réalisée au Laos dans la province de Khammuan (21 ; 29) sur l’extrait éthanolique de feuille de Dalbergia sissoo dont les résultats montrent son activité sur S. aureus (DZI : 25,38 ± 0,21 mm), K. pneumoniae (DZI : 13,56 ± 0,89 mm) et E. coli (DZI : ≤ 8,56 ± 0,41 mm) ainsi que P. aeruginosa (DZI : ≤ 9,33 ± 0,32 mm). De même, l’étude réalisée (15 ; 23 et 34), au Maroc sur l’extrait éthanolique de l’écorce des racines de Dalbergia nigra s’est révélée active sur S. aureus (DZI ≥ 18 mm), K. pneumoniae (DZI ≥ 14 mm), E. coli (DZI ≥ 19 mm) et P. aeruginosa (DZI ≥ 16 mm). Cependant, nos extraits, quoiqu’actifs, ont une activité modeste en comparaison avec les taxons précités. 2.2. Activité antibactérienne des extraits exprimée en CMI et CMB (µg/mL) et effets des extraits. Les CMI des extraits ont varié entre 62,5 et 500 µg/mL, E. Coli et K. pneumoniae sont les germes le plus sensible car 90 % des extraits ont présenté une CMI de 62,5 µg/mL (DaNit Ra, DaNit Ti, DaBo Ra, DaNit Fe et DaBo Ti). Tous les extraits ont présenté le ratio CMB/CMI ≤ 2 ainsi ils sont tous bactéricides. Tableau 16. Catégorisation d’effets des extraits en fonction des CMI et CMB. Extraits Bactéries CMI (µg/mL) CMB (µg/mL) CMB/CMI Effets DaBoFe E. Coli 125 125 1 BC K. pneumoniae 250 500 1 BC P. aeruginosa 500 500 1 BC S. aureus 500 500 2 BC DaBoTi E. Coli 62,5 125 2 BC K. pneumoniae 125 250 2 BC P. aeruginosa 250 500 2 BC S. aureus 250 500 2 BC DaBoRa E. Coli 125 250 2 BC K. pneumoniae 62,5 125 2 BC P. aeruginosa 250 500 2 BC S. aureus 250 500 2 BC DaNiFe E. Coli 62,5 125 2 BC K. pneumoniae 125 250 2 BC P. aeruginosa 125 250 2 BC S. aureus 500 500 1 BC DaNiTi E. Coli 62,5 125 2 BC K. pneumoniae 62,5 125 2 BC P. aeruginosa 125 250 2 BC S. aureus 250 500 2 BC DaNiRa E. Coli 62,5 250 2 BC K. pneumoniae 62,5 125 2 BC P. aeruginosa 250 250 1 BC S. aureus 62,5 125 2 BC BC : bactéricide. L’activité antibactérienne des extraits peut être catégorisée en fonction de la valeur de CMI. Au cours de cette étude, nous avons utilisé une classification antérieure (11). Cette classification catégorise les extraits comme suit : i) extraits à très forte activité, si CMI ≤ 5 μg/mL ; ii) extrait à forte activité, si 5 μg/mL < CMI ≤ 50 μg/mL ; iii) extrait actif, si 50 μg/mL < CMI ≤ 100 μg/mL ; iv) extraits modérément actifs, si 100 μg/mL < CMI ≤ 625 μg/mL ; v) extrait à faible activité, si CMI > 625 μg/mL.
En vertu de cette classification, aucun extrait n’a été très fortement ni fortement actif ; cependant, certains extraits ont été actifs et d’autres modérément actifs selon les germes. La proportion d’extraits actifs sur les germes se présente comme suit : E. coli (4/6) DaBoTi, DaNiFe, DaNiTi sur K. pneumoniae (3/6) DaNiTi, DaNiRa, DaBoRa en fin sur S. aureus (1/6) DaNiRa à la dilution de 62,5 µg/mL. Parmi ces trois derniers, c’est DaNiRa qui répond normalement à l’activité antibactérienne en CMI et en CMB.
Aucune étude n’a été trouvée concernant l’activité antibactérienne de ces deux taxons. Cependant, une étude réalisée au Laos par Chen et al. , de 500 mg/mL (E. coli), 500 mg/mL (K. pneumoniae) et 500 mg/mL (S. aureus) et 500 mg/mL (P. aeruginosa). Une autre étude réalisée (27) au Maroc sur l’extrait éthanolique des feuilles de Dalbergia melanoxylon Guill, a révélé son activité antibactérienne avec des CMI respectifs de : 6,25 μg/mL (E. coli), 11,83 μg/mL (K. pneumoniae) et 3,35 μg/mL (S. aureus) ainsi que 6,25 μg/mL (P. auriginose).
Il est important de souligner que nos deux taxons ont une activité antibactérienne supérieure à celle de Dalbergia sissoo de 250 et 500 µg/ml sur E. coli et K. pneumoniae (24) et aussi chez Dalbergia saxatilis Hook de 125, 1 000 et 250 µg/ml (31).
Cette activité antibactérienne pourrait être due à la présence des groupes phytochimiques identifiés au sein de ces deux plantes, notamment des flavonoïdes, des saponines, des tanins et des polyphénols, d’autant plus qu’ils figurent parmi les groupes antimicrobiens communs aux deux taxons (39).
Dans cette partie, nous présentons les résultats obtenus de l’activité antioxydante des extraits éthanolique de Dalbergia boehmii et Dalbergia nitidula. Nous présentons les résultats d’activité qui est quantifiée en exprimant sous forme de CI50.
3.4.1. Quantification de l’activité antioxydante
L’analyse par piégeage du DPPH est une méthode utilisée pour mesurer l’activité antioxydante d’une substance. Dans ce cas, six extraits des différentes parties de la plante de deux taxons ont été testés. Cependant, tous les extraits éthanoliques des feuilles, des écorces de tiges et écorces de racines des plantes étudiées ont significativement inhibé le radical DPPH˙ proportionnellement à la dose. Cependant, à 4,5 µg/mL, tous les extraits ont présenté une activité d’au moins 50 %.
Au cours de notre étude, nous avons observé un modèle d’interaction logarithmique entre les extraits et le DPPH. L’extrait de feuille de Dalbergia nitidula a présenté la plus faible CI50
(0,114 μg/mL), tandis que la quercétine a présenté la plus grande valeur d’CI50 (1,127 μg/mL).
Figure 17. Courbes de concentrations des organes à la réponse de la quercétine et activité antioxydante sous forme d’IC50.
Nous avons catégorisé les extraits selon une classification utilisée antérieurement (Bashige et al., 2021), qui se présente comme suit : très forte si la CI50 ≤ 5 µg/mL ; forte si 5 ≤ CI50 ≤ 50 ; modérée si 50 ≤ CI50 ≤ 325 μg/mL et faible : CI50 > 325 μg/mL (11).
Suivant cette classification, tous les extraits ont présenté une très forte activité anti-radicalaire, y compris le contrôle positif.
Les extraits de Dalbergia nitidula feuille et racine se sont démarqués avec les plus faibles valeurs de CI50, soit 0,144 et 0,855 μg/mL, respectivement.
Des études antérieures (32) réalisées à Madagascar ont également rapporté une forte activité de l’écorce de Dalbergia stevensonii avec des CI50 plus faibles que celle rapportée dans cette étude (0,019 µg/mL et 0,125 µg/mL respectivement). Une autre étude réalisée (21), a rapporté une activité antioxydante faible chez Dalbergia Spruceana avec une CI50 plus grande que celles rapportées dans cette étude (7,5 µg/mL et 9,76 µg/mL). L’étude de (22) a évalué une activité antioxydante plus élevée avec une CI50 de 9,2 ± 1,8 µg/mL par rapport à nos extraits de Dalbergia odorifera et de Dalbergia spinosa. Une autre étude a montré que D. paniculata possède une activité antioxydante plus élevée avec des CI50 de 69,3 et 80,2 µg/mL par rapport à nos extraits de (24 ; 18 et 33).
Aucune littérature accessible n’a rapporté l’activité antioxydante de ces deux taxons. Ces résultats sont donc rapportés pour la première fois.
Le criblage de grands groupes phytochimiques a porté sur les réactions en solutions. Elles sont basées sur la coloration, la précipitation ou la formation de mousses (11).
Les groupes polyphénols sont cités comme ceux ayant un potentiel cicatrisant. Les anthocyanes ont été recherchées pour leur pouvoir antioxydant. Les hétérosides cyanogènes ont été recherchés pour nous renseigner sur une éventuelle toxicité due à la libération du cyanure.
L’analyse phytochimique a révélé l’absence d’hétérosides cyanogènes, d’alcaloïdes et de coumarines. Cependant, elle a permis de détecter la présence d’anthocyanes, de flavonoïdes, de quinones, de saponines, de stéroïdes, de tanins (TG et TC) et de terpénoïdes dans tous les organes des deux plantes sélectionnées.
Tableau 17. Profil phytochimique par des reactions en solution.
Groupes DaBoFe DaBoTi DaBoRa DaNiFe DaNiTi DaNiRa
Alcaloïdes – – – – – –
Coumarines – – – – – –
Flavonoïdes + + + + – +
Hétérosides cyanogènes – – – – – +
Anthocyanes – + + + + +
Quinones + – + + +
Saponines + + + + + +
Stéroïdes + + – + – +
Tanins catéchiques + + + + + +
Tanins galliques + + + + + –
Terpénoïdes + – + + – +
Présence : + ; absence : – .
Comme le montre le tableau 18, nous avons recherché 10 groupes phytochimiques dans trois organes issus de deux plantes, ce qui représente un total de 66 tests, dont 40 (60,60 %) étaient positifs. Ces derniers ont mis en évidence les feuilles (37,14 %), l’écorce de tige (25,71 %) et l’écorce de racine (34,28 %). Le choix de l’organe à cribler, autre que ceux utilisés en médecine traditionnelle, a été lié à la disponibilité lors de la récolte.
Cette répartition des groupes de substances pourrait justifier l’usage fréquent de ces trois organes (F, ET, ER). Le criblage chimique des deux plantes a également permis de mettre en évidence l’abondance relative globale de chaque groupe phytochimique, qui étaient abondamment présents dans au moins trois organes, à l’exception des hétérosides cyanogènes, qui étaient absents des deux plantes et de leurs organes. À titre illustratif, les tanins et les saponines étaient relativement abondants dans trois organes des deux plantes (100 %), les flavonoïdes, les anthocyanes et les quinones dans trois des deux plantes (83,33 %), les terpénoïdes (66,66 %), les stéroïdes (66,66 %) ainsi que les hétérosides (0 %).
Dans l’étude de criblage chimique des deux plantes étudiées, la présence d’anthocyanes, de flavonoïdes, de quinones, de saponines, de terpénoïdes, de stéroïdes ainsi que de tanins G et C dans D. Boehmii et Nitidula, mais aussi l’absence d’hétérosides cyanogènes, d’alcaloïdes et de coumarines sont en accord avec l’étude de (33 ; 40). La présence de tanins, d’anthocyanes, de quinones et de flavonoïdes pourrait justifier les différentes activités observées : cicatrisante (29), anti-inflammatoire (23 ; 19), antibactérienne (36) et antioxydante (41).
Cette étude est en quasi-collusion avec les travaux de (25 ; 31) sur la présence de flavonoïdes, anthocyanes, quinones, stéroïdes, terpénoïdes et tanins G et C, mais aussi sur l’absence d’hétérosides cyanogènes, d’alcaloïdes et de coumarines. Elle entre aussi en collusion avec les travaux de (18; 20) sur Dalbergia nigra et Dalbergia sissoo au Cameroun. En Algérie, l’étude de (43) est aussi en l’absence de coumarine et d’alcaloïdes, mais en contradiction avec les hétérosides cyanogènes sur Dalbergia monetaria.
Les fortes fréquences des groupes de phytochimiques recherchés dans les feuilles, tiges et racines peuvent s’expliquer par le fait que globalement, les feuilles sont le lieu de synthèse des substances chimiques de la plante, tandis que d’autres organes servent de réservoirs (Lumbu et al., 2005).
4.1. Dosage colorimetriques
4.1.1. Taux en polyphénols, flavonoïdes et tanins totaux de taxons sélectionnés.
Dans cette étude, le ratio CPT-CTT est de 21,40 en moyenne avec une amplitude de 13,07 et 29,15. Les teneurs en polyphénols totaux et tanins totaux exprimées en milligramme équivalent acide gallique par gramme d’extrait ont respectivement varié entre 228,8 ± 0,1 et 432,42 ± 0,35 mg EAG.g-1 et 12,09 ± 0,9 mg EAG.g-1 et 21,54 ± 0,8 mg EAG.g-1. Quant à celles de flavonoïdes exprimées en milligramme équivalent quercétine par gramme d’extrait, varient entre 110,48 ± 0,09 et 412,48 ± 0,05 mg EQ. g-1.
Tableau 18. Contenu en polyphénol, flavonoïdes et tanins totaux des extraits de Dalbergia
boehmii et Dalbergia nitidula.
Extraits CPT (mg EAGg-)1 CFT (mg EQGg-1) CTT (mg EAGg-1) CPT/CTT
DaBoFe 0,42 ± 0,35 0,48 ± 0,05 0,25 ± 0,3 0,17
DaBoTi 0,39 ± 0,71 0,58 ± 0,03 0,30 ± 0,05 0,67
DaBoRa 0,42 ± 0,26 0,56 ± 0,01 0,93 ± 0,9 0,45
DaNitFe 0,73 ± 0,39 0,17 ± 0,08 0,54 ± 0,08 1,35
DaNitTi 0,55 ± 0,26 0,27 ± 0,07 0,45 ± 0,05 1,35
DaNitRa 0,83 ± 0,15 0,48 ± 0,09 0,35 ± 0,19 2,37
CPT : Concentration en polyphénol totaux ; CTT : Concentration Tanins Totaux. CFT : Concentration en Flavonoïdes Totaux
Nous avons remarqué que nos extraits de Dalbergia boehmii et Dalbergia nitidula présentaient une teneur plus élevée en polyphénols, allant de 0,39 ± 0,71 à 0,83 ± 0,15 mg EAG.g-1 par rapport aux extraits. La racine de Dalbergia sissoo présente quant à elle une teneur de 0,35 ± 0,42 mg EAG.g-1 pour les extraits aqueux et de 0,79 ± 0,27 mg EAG. La même plante avait présenté une teneur en flavonoïdes plus faible dans les extraits méthanoliques de 49,41 ± 0,49 mg EAG.g-1. Nous remarquons que nos extraits ont une teneur de 0,48 ± 0,09 et 0,17 ± 0,08 mg EAG.g-1, plus élevée que celle de Dalbergia sissoo selon une étude réalisée en Égypte par Roy et al. (2011) et Sofidiya et al. (2006). (2011) et Sofidiya et al., (2006). L’étude de Roy et al., (2011) Comparativement à d’autres extraits, nos extraits possèdent une teneur en polyphénols plus élevée que celui de Dalbergia saxatilis (0,47 ± 0,01 mg EAG.g-1) selon Sofidiya et al. (2006). En Algérie, les études de Cheng et al. (1998) ont révélé que les extraits de l’éther de pétrole de Dalbergia odorifera possèdent une teneur en flavonoïdes plus faible, soit 0,99 ± 0,6 et 0,1 ± 1,6 mg EAG.g-1, et une faible teneur en polyphénols, soit 0,53 ± 1,4 et 1,30 ± 1,8 mg EAG.g-1.
Aucune étude n’est rapportée dans la littérature accessible sur les taux de phénols et flavonoïdes totaux de Dalbergia boehmii et nitidula. Les résultats contenus dans cette étude constituent donc le premier rapport y afférent. Des études antérieures ont rapporté la relation entre l’activité antioxydante et les composés phénoliques (Aksoy et al., 2013 ; Donno et al., 2016). Dès lors, la forte activité antioxydante serait due à la présence de polyphénols dans les extraits.
4.2. Caracteristiques physico-chimique de poudre de D. boehmii et D. nitidula. Les essais pharmacognostiques effectués sur DaBo et DaNi sont susceptible de constituée des paramètres de base pour un contrôle qualité ultérieure pour cette drogue végétal. Ils ont porté sur les observations organoleptiques, des essais physico-chimiques.
- Examen visuel sur la poudre
Les examens visuels sur les poudres de différents organes montrent que les poudres de feuilles de D. Boehmii sont de couleur verte, tige grise et enfin la racine brun-rouge et D. Nitidula montrent qu’elles les feuilles sont de couleur verte citron, la tige couleur grise et racine brun claire. Cependant, les poudres de ces organes n’ont presque pas d’odeur ni des saveurs caractéristiques mais présentent une texture cristalline, Elles sont non hygroscopiques sur leurs Hygroscopicité (Tableau 20).
Tableau 19. L’examen visuel des poudres des plantes sélectionnées.
Paramètres Dalbergia boehmii Dalbergia nitidula
DaBoFe DaBoTi DaBoRa DaNiFe DaNiTi DaNiRa
Couleur Vert Grise Chocolat Vert foncé Blanche Grise
Odeur NC NC NC NC NC NC
Saveur NC NC NC NC NC NC
Hygroscopicité NH NH NH NH NH NH
Texture Cristalline Cristalline Cristalline Cristalline Cristalline Cristalline
Humidité apparente Humide Humide Humide Humide Humide Humide
N C : Non caractéristique ; NH Non hygroscopique ; H : Hygroscopique
A B C
D E F Figure 18. (a) La poudre de DaBoFe, (b) la poudre de DaBo Ti, (C) La poudre de DaBo Ra, (d) La poudre de DaNit Fe, (e) La poudre de DaNit Ti, (f) La poudre de DaNit Ra.
- Caractères microscopiques des poudres des taxons sélectionnées
Les examens microscopiques effectués au grossissement x100 sur les poudres des plantes sélectionnées montrent que les feuilles d’Dalbergia boehmii contiennent parenchyme et la fibre. DaBo Ti possède des grains d’amidon et cellule bombé. DaBo Ra a des poils tecteurs, tissus parenchymateux. DaNiFe présente de fibres fusionne, et poils testeurs. DaNiTi montre le l’amidon, xylème et les fibres. DaNiRa présente de Fibre, suber et le poil. Cellule épidermique avec stomate Fibre
Figure 19. Les éléments microscopiques de la poudre de feuilles de Dalbergia boehmii Taub observés dans la solution d’hydrate chloral. Cellule Bombée épidermique Épiderme Grains d’amidon
Figure 20. Les éléments microscopiques de la poudre d’écorces tige d’Dalbergia boehmii Taub observés dans la solution d’hydrate chloral.
Tissus parenchymateux
L’amidon Poils tecteurs vascularisé
Figure 21 – Eléments microscopiques de la poudre des écorces de racine de Dalbergia boehmii observés dans la solution d’hydrate chloral.
Parenchyme chlorophilien Parenchyme Fibre fusionner Figure 22 – Eléments microscopiques de la poudre des feuilles Dalbergia nitidula observés dans la solution d’hydrate chloral.
Xylème Amidon
Poils protecteurs unicellulaires
Figure 23 – Eléments microscopiques de la poudre des écorces tige Dalbergia nitida observés dans la solution d’hydrate chloral
Poil Fibre
Figure 24 – Eléments microscopiques de la poudre des écorces racine Dalbergia nitidula
observés dans la solution d’hydrate chloral.
- Matière sèche, perte a la dessiccation, cendres, indice de gonflement et pH Les résultats de quelques paramètres physicochimiques et de la composition chimique de la plante étudiée sont résumés dans le tableau ci-dessous. Ils sont présentés sous forme de teneur moyenne de trois essais ± l’écart type. La poudre de feuilles de Dalbergia boehmii présente le plus grand taux de cendres totales (15 %), différent de celui de Dalbergia nitidula et d’une autre plante. La poudre des feuilles de Dalbergia nitidula présente la plus forte teneur en cendre chloridrique (4,6 %). L’indice de gonflement le plus important (3,91 ± 0,08 mL) est celui de la poudre de feuilles de Dalbergia nitidula. Par ailleurs, toutes les poudres présentent une humidité inférieure à 2,5 %, celle de la matière sèche est la plus importante (98,67) pour Dalbergia boehmii. Le test spécifique de pH, réalisé entre (1,5 et 10 %), est positif. Le pH de la poudre des organes des plantes à l’étude en milieu aqueux à 1,5 et 10 % est légèrement acide. Cela pourrait être compatible avec le pH du tube digestif et éviter d’éventuelles irritations gastriques
(37).
Tableau 20. Paramètres physico-chimiques de deux taxons sélectionnés.
Paramètre DBF DBT DBR DNF DNT DNR
MS % 97,3 96,57 98,67 96,67 98,43 96,79
PD % 2,08 2,10 2,09 2,07 2,11 2,06
CT % 15 13,26 14 13,33 12,6 10,97
CC % 4,38 4,28 4,30 4,58 4,47 4,55
IG Cm 3,5 ± 0,14 2,9 ±0,09 3,8 ± 0,18 3,9 ± 0,08 2,8 ± 0,06 2,6 ± 0,04
pH 1%
6,1 ± 0,01 6,1 ± 0,1
5,6 ± 0,03
6,6 ± 0,06
6,1 ± 0,01
5,1 ± 0,02
pH 5%
6,1 ± 0,11
6,1 ± 0,04
5,2 ± 0,04
6,5 ± 0,11
6 ± 0,04
5,2 ± 0,01
pH 10% 6,04 ± 0,06 5,9 ± 0,05 5,3 ± 0,01 6,03 ± 0,03 5,9 ± 0,02 5,2 ± 0,01
Les paramètres physico-chimiques font partie des éléments de contrôle qualité des plantes médicinales. Étant donné qu’ils ne sont pas décrits dans la littérature pour ces deux taxons, les résultats de cette étude pourraient servir de base pour une évaluation de la qualité ultérieure. La perte à la dessiccation des plantes étudiées a varié entre 2,11 % et 2,0 %. Une faible teneur en perte à la dessiccation (inférieure à 10 %) signifie que la drogue peut éviter les réactions d’oxydation, de fermentation et le développement des moisissures, qui sont des phénomènes susceptibles d’altérer la qualité du principe actif lors d’une conservation sur le long terme (21; 30).
Les cendres totales renseignent sur le contenu en matière inorganique et les cendres chlorhydriques sur la présence de quantités non acceptables de certains minéraux (Ph Eur, 2017 – 2.8.1). Les normes proposées par la pharmacopée européenne sont les suivantes : – 12 %, ≤ 14 %, < 2 %. Les résultats obtenus avec les drogues Dalbergia boehmii et Dalbergia nitidula sont conformes à la norme (18) en ce qui concerne les teneurs en cendres totales.
Les paramètres physico-chimiques font partie des éléments de contrôle qualité de plantes médicinales. Etant donné qu’ils ne sont pas décrits dans la littérature pour ces deux taxons, les résultats de cette étude pourraient servir de soubassement pour une évaluation qualité ultérieure. La perte à la dessiccation des plantes étudiées a varié entre 2,11 % et 2,0 %. Une faible teneur en perte à la dessiccation (inférieure à 10 %) signifie que la drogue peut éviter les réactions d’oxydation, de fermentation et le développement des moisissures qui sont des phénomènes capables d’altérer la qualité du principe actif lors de la conservation sur une longue période (19; 37).
Les cendres totales renseignent sur le contenu en matière inorganique et les cendres chlorhydriques sur la présence de quantités non acceptables de certains minéraux (Ph Eur, 2017 – 2.8.1). Les normes proposées par la pharmacopée européenne sont respectivement les suivantes: ≥ 12 %, ≤ 14 %, < 2 %. Les résultats obtenus avec les drogues Dalbergia boehmii et Dalbergia nitidula sont en conformité avec la norme (18) en rapport avec les teneurs en cendres totales.
Les indices de gonflement des différentes drogues examinées au cours de cette étude varient entre 2,8 ± 0,06 et 3,91 ± 0,08 cm. Les écorces tige de Dalbergia nitidula ont donné un indice de gonflement de 2,8 ± 0,06 cm, alors que la feuille du même taxon donne un indice de gonflement d’environ 3,91 ± 0,08 cm. L’indice de gonflement renseigne sur les propriétés éventuelles de la drogue à absorber un solvant (l’eau dans le cas présent), ce qui est une indication sur la présence d’hydro-colloïdes et de mucilages dans la drogue (18). Nos deux taxons présentent donc une teneur intéressante en hydro colloïdes et mucilages. Des études ultérieures devraient se consacrer à les identifier et les quantifier.
La littérature accessible ne rapporte aucune investigation des paramètres physicochimiques recherchés dans cette étude de manière spécifique pour toutes les espèces étudiées. C’est pourquoi cette étude présente pour la première fois les informations relatives aux paramètres physico-chimiques des espèces étudiées, qui constituent des éléments pouvant être mis à profit pour l’élaboration d’une pharmacopée locale ou d’une monographie de référence concernant ces espèces.
Cette étude a été menée en vue d’évaluer l’activité cicatrisante des extraits éthanoliques de Dalbergia boehmii et Dalbergia nitidula, deux taxons utilisés dans la médecine traditionnelle congolaise en général et katangaise en particulier pour la prise en charge des plaies. Outre cette activité principale, l’étude a évalué l’activité antioxydante et l’activité inflammatoire in vivo. Le profil phytochimique préliminaire a également été dressé et des polyphénols, des flavonoïdes et des tannins ont été dosés, avant de dresser un profil physico-chimique des poudres de ces deux plantes.
L’activité cicatrisante a été évaluée sur Mus musculus, sur lequel une plaie chirurgicale de 100,06 mm2 a été provoquée. Cela a montré que tous les extraits offraient un gain de temps de cicatrisation de 3 à 9 jours, avec en tête DaBoR, DaNitT et DaNitR (9 jours chacun). Cependant, parmi ces trois dernières, seules DaNiTi disposent également d’une activité anti-inflammatoire, avec un temps médian TM de 50 %, 5 heures, permettant une réduction de l’inflammation de 61,0 ± 2,3 % à la dose de 500 mg/kg. Après 10 heures, la même dose provoque une hausse de plus de 100 % de l’inflammation, réduite. C’est DaNiTi qui est la plus active, alors que les feuilles de ce taxon n’ont pas fait preuve d’une efficacité meilleure quant à la réduction du volume de la patte.
Tous les extraits ont présenté une activité antimicrobienne modérée (CMI : 62,5 – 500 μg mL-1 ; DZI : 10 – 22 mm) ; DaBoRa a été la plus active (CMI : 62,5 μg mL-1) sur E. coli.
Cette activité est attribuée en partie au dosage en flavonoïdes totaux, qui ont été identifiés et quantifiés au cours de cette étude (0,17 ± 0,08 à 0,58 ± 0,03 mg EQG g-1), et en partie au dosage en polyphénols (0,39 ± 0,71 à 0,83 ± 0,15 (mg EAG g-)1 totaux etc. Bien que tous les extraits aient présenté une forte activité anti radicalaire (0,144 à 4,19 μg/mL), c’est la DaNiFe qui présente l’activité la plus élevée avec 0,144 μg/mL par rapport au contrôle positif avec 1,127 μg/mL. Leur profil physico-chimique indique qu’ils présentent des taux de cendres totaux situés entre 3,42 et 15 %, et un indice de gonflement compris entre 3,91 ± 0,08 et 2,8 ± 0,06 cm.
Les résultats indiquent que ces plantes possèdent des propriétés significatives qui pourraient être exploitées dans le développement de médicaments traditionnels améliorés contre les plaies. Leur capacité à favoriser la cicatrisation des plaies, à neutraliser les radicaux libres, à réduire l’inflammation et à combattre les infections bactériennes souligne leur valeur en médecine traditionnelle et moderne. Toutefois, des études supplémentaires sont nécessaires pour isoler les composés actifs responsables de ces effets et évaluer leur sécurité et leur efficacité dans des applications cliniques.
[1] Akpona T, Glèlè Kakaï R, Akpona A. Ethnobotanique et structure des peuplements d’espèces de brosse végétale au\nSud et au Centre du Bénin. Bull la Rech Agron du Bénin 2009;63(1):1–12.
[2] Toafode CNM, Bekoe OE, Vissiennon Z, Ahyi V, Vissiennon C, Fester K. Ethnomedicinal Information on Plants Used for the Treatment of Bone Fractures, Wounds, and Sprains in the Northern Region of the Republic of Benin. Evidence-based Complement Altern Med 2022;2022:8619330.
[3] Yusuf A, Abdullahi M, AA M. Ethnobotany, Phytochemistry and Pharmacology of Ochna Schweinfurthiana: a Review. Univers J Pharm Res 2020;4(6):75–79.
[4] Messi AN, Ngo Mbing J, Ndongo JT, Nyegue MA, Tchinda AT, Yemeda FL, et al. Phenolic compounds from the roots of Ochna schweinfurthiana and their antioxidant and antiplasmodial activities. Phytochem Lett 2016;17(7):119–125.
[5] Bruschi P, Morganti M, Mancini M, Signorini MA. Traditional healers and laypeople: A qualitative and quantitative approach to local knowledge on medicinal plants in Muda (Mozambique). J Ethnopharmacol 2011;138(2):543–563.
[6] Moshi MJ, Otieno DF, Mbabazi PK, Weisheit A. The ethnomedicine of the haya people of bugabo ward, Kagera region, north western Tanzania. J Ethnobiol Ethnomed 2009;5:24.
[7] Ndongo JT, Issa ME, Messi AN, Ngo Mbing J, Cuendet M, Pegnyemb DE, et al. Cytotoxic flavonoids and other constituents from the stem bark of Ochna schweinfurthiana. Nat Prod Res 2015;29(17):1684–1687.
[8] Danmusa UM, Nasir IA, Abdullahi MI, Ahmad AA, Abdulkadir IS. Phytochemical analysis and antimicrobial activities of methanolic stem extracts of Ochna schweinfurthiana F. Hoffm. J Pharm Pharmacogn Res 2015;3(6):171–182.
[9] Muya K, Tshoto K, Cioci CC, Aseho MM, Kalonji M, Byanga K, et al. Survol ethnobotanique de quelques plantes utilisées contre la schistosomiase urogénitale à Lubumbashi et environs. Phyothérapie 2014. doi:10.1007/s10298-014-0877-z.
[10] Bashige C, Bakari A, Okusa N, Kahumba B, Lumbu S. Phytochemical screening and antioxidant activity of methanolic extracts of 53 antimalarial plants from Bagira in Eastern DR Congo. GSC Biol Pharm Sci 2020;12(2):099–118.
[11] Bashige CV. Étude ethnobotanique , phytochimique et pharmacologique de plantes médicinales antimalariques de Bukavu : intérêt majeur de Dialium angolense Welw ex Oliv ( Fabaceae ). [Thèse PhD en Sci Pharm (Spécialité Pharmacogn Fac des Sci Pharm – Univ Lubumbashi, Lubumbashi, RDC 2021;1:225.
[12] Bashige C V, Bakari AS, Kahumba BJ, Lumbu SJ. Activité antioxydante de 53 plantes réputées antimalariques en République Démocratique du Congo. Phytothérapie 2021;19(5–6):355–371.
[13] Dougnon. In Vitro Antibacterial Effects of Crateva adansonii, Vernonia amygdalina and Sesamum radiatum Used for the Treatment of Infectious Diarrhoeas in Benin. J Infect Dis Ther 2016;4(3). doi:10.4172/2332-0877.1000281.
[14] Puca V, Marulli RZ, Grande R, Vitale I, Niro A, Molinaro G, et al. Microbial Species Isolated from Infected Wounds and Antimicrobial Resistance Analysis : Data Emerging from a Three-Years Retrospective Study. 2021.
[15] Bouharb H, Badaoui K El, Zair T, El J, Chakir S, Alaoui T. Sélection de quelques plantes médicinales du Zerhoun ( Maroc centrale ) pour l ’ activité antibactérienne contre Pseudomonas aeruginosa. 2014;:6685–6693
[16] Chiribagula V. B., Amuri S. B., Kalonji S. M., Byanga J. K., Duez P., Simbi J. B. L., 2017. Étude ethnobotanique, phytochimique et évaluation de l’activité antiplasmodiale de 13 plantes réputées antipaludéennes dans la commune du Kenya (Lubumbashi, RDC). Phytothérapie, https://doi.org/10.1007/s10298-017-1152
[17] Kalonda E. M., Mbayo M., Muhume S. K., Kasereka M., Mulamba J. M., Mboni M., et al., 2014. Ethnopharmacological survey of plants used against malaria in Lubumbashi city (D.R. Congo). Journal of Advanced Botany and Zoology, 1 (2): 1-8. https://pdfs.semanticscholar.org/dcf2/21824f3d63d28188196d7b18be0b7ab0e30c.pdf
[18] Manya M. H., Keymeulen F., Ngezahayo J., Bakari A. S., Kalonda M. E., Kahumba B. J., et al., 2020. Antimalarial herbal remedies of Bukavu and Uvira areas in DR Congo: An ethnobotanical survey. Journal of Ethnopharmacology, 249: 112422. https://doi.org/10.1016/j.jep.2019.112422.
[19] Mbayo K. M., Kalonda M. E., Tshisand T. P., Kisimba K. E., Mulamba M., Kalunga R. M., et al., 2016. Contribution to ethnobotanical knowledge of some Euphorbiaceae used in traditional medicine in Lubumbashi and its surroundings (DRC). Journal of Advanced
Botany and Zoology, 4 (2): 1-16. https://www.researchgate.net/profile/MarsiMbayo/publication/304806040_Contribution_to_ethnobotanical_knowledge_of_some_Eupho rbiaceae_used_in_traditional_medicine_in_Lubumbashi_and_its_surroundings_DRC/links/57 7bb8a508ae355e74f16071/Contribution-to-ethnobotanical-knowledge-of-some-
Euphorbiaceae-used-in-traditional-medicine-in-Lubumbashi-and-its-surroundings-DRC.pdf
[20] Mbuyi K. S., Kalunga M. R., Kalonda M. E., Cimanga C. C. B., Numbi I. E., Kahumba B. J., et al., 2019. Aperçu ethnobotanique de plantes réputées antipaludéennes utilisées dans la ville de Lubumbashi et ses environs, dans le Haut-Katanga en RD Congo.
Ethnopharmacologia, 61 : 75-84. http://www.ethnopharmacologia.org/wpcontent/uploads/2019/07/ETHNOPHARM-61-Mbuyi.pdf
[21] Muya K., Tshoto K., Cioci C. C., Aseho M. M., Kalonji M., Byanga K., et al., 2014. Survol ethnobotanique de quelques plantes utilisées contre la schistosomiase urogénitale à Lubumbashi et environs. Phytothérapie,12 : 213-228. https://doi.org/10.1007/s10298-0140877-z
[22] Abdou JP, Momeni J, Adhikari A, Tsabang N, Tchinda AT, Choudhary MI et al. New coumestan and coumaronochromone derivatives from Dalbergia boehmii Taub.
(Fabaceae). Phytochem Lett. 2017;21:109-13. doi: 10.1016/j.phytol.2017.06.014.
[23] Saha S, Shilpi JA, Mondal H, Hossain F, Anisuzzman MD, Hassan MDM et al. Ethnomedicinal, phytochemical, and pharmacological profile of the genus Dalbergia L. (Fabaceae). Phytopharmacol. 2013;4(2):291-346.
[24] Zhao X, Mei W, Gong M, Zuo W, Bai H, Dai H. (2011). Antibacterial activity of the flavonoids from Dalbergia odorifera on Ralstonia solanacearum. Molecules 16, 9775-9782.
[25] Yu X, Wang W, Yang M. (2007). Antioxidant activities of compounds isolated from Dalbergia odorifera T. Chen and their inhibition effects on the decrease of glutathione level of rat lens induced by UV irradiation. Food Chemistry 104, 715-720.
[26] Wink M, Mohamed GIA. (2003). Evolution of chemical defense traits in the Leguminosae: mapping of distribution patterns of secondary metabolites on a molecular phylogeny inferred from nucleotide sequences of the rbcL gene. Biochemical Systematics and Ecology 31, 897-917.
[27] Umehara K, Nemoto K, Kimijima K, Matsushita A, Terada E, Monthakantirat O, De-Eknamkul W, Miyase T, Warashina T, Degawa M, Noguchi H. (2008). Estrogenic constituents of the heartwood of Dalbergia parviflora. Phytochemistry 69, 546-552.
[28] Khan IA, Avery MA, Burandt CL, Mikell JR, Nash TE, Azadegan A, Walker LA. (2000). Antigiardial activity of isoflavones from Dalbergia frutescens bark. Journal of Natural Products63, 1414-1416.
[29] Martínez-Sotres C, López-Albarrán P, Cruz-de-León J, García-Moreno T, Rutiaga-Quiñones JG, Vázquez-Marrufo G, Tamariz-Mascarúa J, Herrera-Bucio R. (2012). Medicarpin, an antifungal compound identified in hexane extract of Dalbergia congestiflora Pittier heartwood. International Biodeterioration & Biodegradation 69, 38-40.
[30] Misar AV, Kale M, Joshi M, Mujumdar AM. (2005). Analgesic activity of
Dalbergia lanceolaria bark extract in Swiss Albino mice. Pharmaceutical Biology 43, 723-725.
[31] Kumari A, Kakkar P. (2008). Screening of antioxidant potential of selected barks of Indian medicinal plants by multiple in vitro assays. Biomedical and Environmental Sciences 21, 24-29
[32] Ismail HF, Zezi AU, Hamza YA, Habib DU (2015) Analgesic, anti-infammatory and antipyretic activities of the methanol leaf extract of Dalbergia saxatilis Hook.F in rats and mice. J Ethnopharmacol 166:74–78. https://doi.org/10.1016/j.jep.2015.03.007
[33] Yemitan OK, Adeyemi OO (2017) Mechanistic assessment of the analgesic, antiinfammatory and antipyretic actions of Dalbergia saxatilis in animal models. Pharm Biol 55:898–905. https://doi.org/10.1080/13880209.2017.1283706.
[34] Kale M, Misar AV, Dave V, Joshi M, Mujumdar AM (2007) Anti-infammatory activity of Dalbergia lanceolaria bark ethanol extract in mice and rats. J Ethn opharmacol 112:300–304. https://doi.org/10.1016/j.jep.2007.03.024?
[35] Najeeb TM, Issa TO, Mohamed YS, Ahmed RH, Maknawi AM, Khider TO (2018) Phytochemical Screening, antioxidant and antimicrobial activities of Dalberegia melanoxylon tree. World Appl Sci J 36:826–833. https://doi.org/10.5829/idosi.wasj.2018.826.833.
[36] Shrestha SP, Amano Y, Narukawa Y, Takeda T (2008) Nitric oxide production inhibitory activity of favonoids contained in trunk exudates of Dalbergia sissoo. J Nat Prod 71:98–101. https://doi.org/10.1021/np070478h.
[37] Kanerva L, Estlander T, Alanko K, Jolanki R (2001) Patch test sensitization to compositae mix, sesquiterpene-lactone mix, compositae extracts, laurel leaf, chlorophorin, mansonone A, and dimethoxydalbergione. Am J Contact Dermat 12:18–24. https://doi.org/10.1053/ajcd.2000.9547
[38] Sharma, U.S., Sharma, U.K., Sutar, N., Singh, A., and Shukla, D.K.(2010). Antiinflammatory activity of Cordiadichotomaforst f. seeds extracts. International Journal of Pharmaceutical Analysis, 2(1): 01-04.
[39] Saha, S., Shilpi, J.A., Mondal, H., Hossain, F., Anisuzzman, M., Hasan, M. and Cordell, G.A. (2013). Ethnomedicinal, phytochemical, and pharmacological profile of the genus Dalbergia L. (Fabaceae). Phytopharmacology; 4(2), 291-346
[40] Van Dyke TE (2020) Shifting the paradigm from inhibitors of infammation to resolvers of infammation in periodontitis. J Periodontol 91:S19–S25. https://doi.org/10.1002/JPER.20-0088
[41] Kim YC (2018) Heme oxygenase-1-inducing activity of 4-Methoxydalbergione and 4’-Hydroxy-4-methoxydalbergione from Dalbergia odorifera and their anti-infammatory and cytoprotective efects in murine hippocampal and BV2 microglial cell line and primary rat microglial cells. Neurotox Res 33:337–352. https://doi.org/10.1007/s12640-017-9796-8.
[42] Wang MF, Liu RH, Shao F, Zhang PZ, Mei DY, Yang L, Meng XW (2020)
Chemical constituents of Dalbergia melanoxylonHeatwood. J Chin Med Mater 43:1883–1887
[43] Kumar S.M, Kumud U. (2010). Anti-inflammatory activity of root of Dalbergia sissoo (Rox.b) in carrageenan-induced paw edema in rats. Pharmacognosy Journal 2, 427-430.
[44] Kuroyanagi M, Ueno A, Hirayama Y, Hakamata Y, Gokita T, Ishimaru T, Kameyama S, Yanagawa T, Satake M, Sekita S. (1996). Anti-androgen active constituents from Dalbergia cochinchinensis Pierre. Natural Medicines 50, 408-412.
Annexe I. Matériel et Appareils, Réactifs et solvants
I.1. Matériel & Appareils
Ampoules à décanter (100 mL)
Ballon à fond plat (250mL) Pipette gradué (10 ;20 ;50 ; et 100mL)
Pied à coulisse Pipette pasteur
Bistouris
Gants en vrac Portoir
Micropipette
Pied gradué Béchers (50 mL, 100 mL et 250 mL)
Pissette Erlenmeyer (50 et 520mL,
Spectrophotomètre UV (HUK261,
BAOSHISHAN) Lampe UV
Tube à essai (Oxh : 18x150mm) Boite de pétrie (BR452005-480EA, Brand)
Lame Creusets
Microscope (Swift sw 350T, Swift-EU) Incubateur (TempLab)
Etuve (Memmert) Four électrique
Balance analytique (Sartorius)
Latte
Ouate
I.2. Réactifs et Solvants Frigo
Alcool iso amylique p.a (Merck) Ethyle acétate
Hydroxyde de sodium (NaOH) Chloroforme P. a (Aldrich)
Quercétine (Q4951-100G, Sigma-Aldrich) Dichlorométhane p. a (Aldrich)
Chlorure ferrique (Merck) Acide formique P. a 100%
DPPH (D9132-1G, Sigma-Aldrich, USA) Acide acétique P.a (Merck)
Acide chlorhydrique p. a a 63% (Merck) Acétate de sodium P.a (Merck)
Acide acétique p. a (Merck) Ethanol P. à (Aldrich)
Copeaux de Magnésium (Merck) Eau distillée
Acide picrique (Merck) Toluène (424511-2L, Sigma-Aldrich)
Ether de pétrole (Sigma-Aldrich)
Méthanol P. à (Aldrich) Acide acétique glacial
Formol 1%
Annexe II. Courbe d’étalonnage de l’acide gallique et de la quercétine
Annexe III. Identification des espèces et séchage de matières végétales
Photo des herbiers des plantes (Photos prises lors de l’identification des taxons à l’herbarium de l’INERA-Kipopo).
Annexe IV. Activité antibactérienne, activité bacterienne, cicatrisante et criblage phytochimique
C
(µg/ml) QC DaBo F DaBo Ti DaBo Ra DaNit F DaNit Ti DaNit Ra
100 99,15±0,49 97,18±1,02 98,41±0,40 97,84±3,11 99,35±2,92 96,03±2,82 95,45±0,88
50 94,61±0,61 96,57±1,09 95,11±1,17 93,45±1,74 87,25±3,78 95,43±2,07 89,45±2,82
25 89,39±0,46 92,92±0,39 90,41±3,20 89,96±4,05 81,74±5,15 89,61±0,30 90,10±2,53
12,5 75,42±1,39 82,58±1,48 80,88±2,83 80,07±2,29 75,21±1,95 80,43±4,09 80,28±2,38
6,25 66,32±6,01 68,74±4,06 68,69±0,24 64,95±5,59 67,75±0,25 64,32±11,25 68,90±2,02
3,125 54,88±2,70 62,09±2,08 58,85±0,75 55,69±11,5 54,61±1,45 55,80±11,73 58,53±2,10
1,562 50,84±6,23 53,13±2,13 52,98±1,06 49,47±10,96 43,18±2,14 49,15±7,97 51,96±2,58
0,781 39,39±1,44 33,58±3,05 41,15±1,30 32,10±8,47 34,29±2,16 41,12±3,92 34,64±1,36
0,39 14,64±2,15 15,66±2,85 15,10±0,69 29,86±9,6 15,84±2,49 15,87±1,64 29,30±0,77
0,195 5,38±1,69 9,40±1,45 9,55±2,22 18,67±10,77 9,07±1,65 9,91±10,42 17,36±1,45
QC : Quercétine ; C : Concentration

 Naviguez vers congovirtuel
Naviguez vers congovirtuel Naviguez vers Kinkiesse
Naviguez vers Kinkiesse