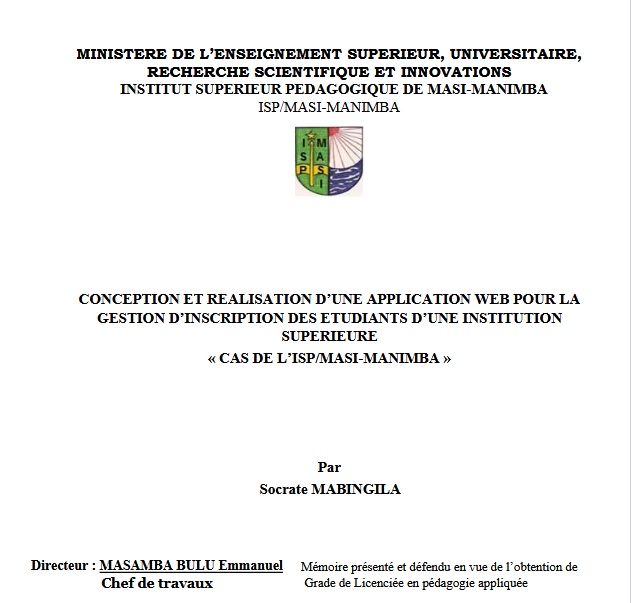
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, UNIVERSITAIRE,
RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET INNOVATIONS
INSTITUT SUPERIEUR PEDAGOGIQUE DE MASI-MANIMBA
ISP/MASI-MANIMBA
CONCEPTION ET REALISATION D’UNE APPLICATION WEB POUR LA GESTION D’INSCRIPTION DES ETUDIANTS D’UNE INSTITUTION SUPERIEURE
« CAS DE L’ISP/MASI-MANIMBA »
Par
Socrate MABINGILA
EPIGRAPHE
Fort aujourd’hui ne veut pas dire fort tous les jours ! Que celui qui pensé être debout, prenne garde à ne pas tomber.
Jacque Rousseau
IN MEMORIAM
A mes très chers parents, MABINGILA NGIDISA Jean-bosco et KISIDIKA Rose, que leurs âmes reposent en paix.
DEDICACES
A mon épouse Silamite Mumba, Maman Kisidika Patience et son mari Michel Makwaka, mon grand frère Lubu Boma et son épouse Christine Mpey Ainsi que nos frères (sœurs) Historia Mabingila, Mabingila Louange ; Amida Mabingila et son mari Nzazi Platini, Lastane Kifoto,Gosdoly Kifoto, Stive Kifoto, Kapita Stana, Doty Kikweta, Bety Kikweta, Angel Mwanakunda, Navy Kifoto et son mari Papy Matata et à ma belle-famille Mumba.
Pour tout l’effort consentis afin que je sois aujourd’hui concepteur aux systèmes des informations. Que Dieu voit vos sacrifices En attendant, que ce diplôme soit une source d’encouragement pour votre dur labeur ! A tous ma famille, mes cinq frères et qui nous connaitrons à travers cette œuvre, nous leurs dédions ce travail.
Je dédier ce travail
REMERCIEMENT
La réalisation de notre travail de fin de cycle a été rendu possible grâce au soutien de plusieurs personnes ainsi, nous exprimons notre gratitude à tous ceux qui ont contribuées de près au loin à sa réalisation.
En premier lieu, nous témoignons notre reconnaissance à notre Dieu tout puissant pour tout ce qu’il a été pour nous durant ce temps de formation ;
Nos sincères gratitudes vont droit à monsieur le chef de travaux Masamba Emmanuel qui, en dépit de ses multiples occupations, a accepté la direction de ce travail, aussi, pour sa bonne volonté de nous apprendre la science.
Nous sommes redevables envers le professeur, chefs de, travaux et assistants des instituts supérieurs pédagogiques et des universités Benjamin Sidiboy ; Butela Rosard Esther Bebisa Mukolo, Ri Muambachard Kapile Wa, Lupi ; Kamidi Herve, Ndonga Dieu Merci Et Bengila Platini pour leur contribution à la réalisation de ce travail.
Nos remercions particuliers s’adressent aux autorités académiques de l’institut supérieur pédagogique de Masi-manimba, à celles de la section technique et sciences exactes pour la formation complétée dont nous avons été bénéficières.
A mes coaches ingénieur Divin Badidi & ingénieur Bienne pour leur contribution à la réalisation de ce travail.
A vous mes très chers collègues enseignants de l’institut Kibuka 1 et de l’école d’application de ISP-MASI(EDAP) à mes sœurs et frères Faustin Kiziamina, Bienvenu Tamumbanda, Faride Mavula, Nazireen Kabuabu, Couple Babwa Celestin, Petit Papa Mumba, Philiph Tulengi, Bunduku Makola, Ir Kalau Guelor, Ir Takamba Bientot, Sampaio Mbuyi et couple Blaise Muwalala et tous et ceux dont les noms ne sont pas cités dans cette ouvre trouvent notre gratitude.
Pour leur contribution à la réalisation de notre travail. Nous n’oublierons pas nos camarades étudiants, avec qui nous avons lutté durant notre parcours : Muzama Eudoxie, Edjouku Cédric. Également à tous ceux qui n’ont pas été cites de près ou de loin, qui nous ont assisté pour arriver au bout de la rédaction de ce travail, qu’ils acceptent toutes nos excuses et sachant que nous leurs resterons toujours reconnaissant. Je vous remercie.
MABINGILA SOCRATE
INTRODUCTION GENERALE
1. PRESENTATION DU SUJET
Dans un contexte académique en constante évolution, la gestion des inscriptions au sein d’un établissement d’enseignement supérieur s’impose comme une nécessité. Les méthodes traditionnelles de gestion, souvent caractérisées par un traitement manuel, une perte de temps, un accès limité aux informations.
À l’ISP/Masi-Manimba, comme dans de nombreuses institutions similaires, les défis rencontrés dans la gestion des inscriptions concernent notamment la lenteur du traitement des dossiers, les erreurs humaines fréquentes, la difficulté d retrouver rapidement les données des étudiants, ainsi que le manque d’un système fiable de sécurisation des données académiques.
Avec l’essor des technologies numériques, il devient indispensable de moderniser ces processus en mettant en place une solution informatique adaptée, capable d’automatiser les tâches, de centraliser les informations et d’assurer un meilleur service aussi bien aux étudiants qu’au personnel administratif.
Dans cette optique, notre travail portera sur le sujet suivant :
« Conception et réalisation d’une application web pour la gestion des inscriptions des étudiants dans une institution supérieure – Cas de l’ISP/Masi-Manimba ».
Ce projet vise à concevoir une plateforme numérique qui permettra d’enregistrer, de gérer et de suivre efficacement les inscriptions des étudiants, tout en répondant aux exigences d’accessibilité, de fiabilité et de la sécurité des données.
2. PROBLEMATIQUE
Au cours de notre étude sur le terrain, nous avons constaté que la gestion des inscriptions des étudiants à l’ISP/Masi-Manimba est encore largement basée sur des méthodes cahier bloc note manuelles. Les informations sont généralement recueillies sur papier ou à travers des outils numériques non interconnectés, ce qui entraîne un l’afflux de futurs étudiants dans le site universitaire.
Cette approche engendre plusieurs conséquences néfastes : lenteur du processus d’inscription, surcharge administrative, difficulté à retrouver rapidement les données d’un étudiant, et risque d’erreurs ou de perte d’informations. De plus, l’absence de l’informatisation du processus rend difficile la coordination entre les services académiques, administratifs et financiers.
À une époque où les technologies de l’information offrent des possibilités d’automatisation, de décentralisation et de sécurisation des données, il devient impératif pour les établissements d’enseignement supérieur comme l’ISP/Masi-Manimba de s’adapter à cette évolution. L’intégration d’un système d’information moderne peut améliorer considérablement la qualité du service offert aux étudiants et l’efficacité du travail administratif.
Face à ces constats, une question essentielle se pose :
Comment concevoir et mettre en œuvre un système d’information décentralisé permettant une gestion efficace, rapide et sécurisée des inscriptions des étudiants à l’ISP/Masi-Manimba ?
3. HYPOTHESE
Nous pensons que la mise en place d’une solution informatique dédiée à la gestion des inscriptions des étudiants à l’ISP/Masi-Manimba constituerait une solution efficace pour améliorer considérablement le système actuel.
4. CHOIX ET INTERET DU SUJET
4.1. CHOIX DU SUJET
Le choix de ce sujet est motivé par le désir d’apporter une solution informatique aux multiples difficultés liées à la gestion manuelle des inscriptions à l’ISP/Masi-Manimba. La conception d’un application web permettrait de moderniser ce processus et de répondre efficacement aux besoins des étudiants comme de l’administration. La conception d’une application web qui va permettre aux étudiants de s’inscrire à distance au lieu de venir au site.
4.2. INTERET DU SUJET
Ce sujet présente trois grands intérêts :
- Intérêt personnel : Il permet de mettre en pratique les connaissances théoriques acquises au cours de la formation, notamment en développement web, gestion de base de données et analyse des systèmes d’information.
- Intérêt social : Il vise à doter l’ISP/Masi-Manimba d’un outil numérique moderne capable de fluidifier et d’automatiser le processus d’inscription des étudiants, tout en améliorant la transparence, l’accessibilité et la qualité du service.
- Intérêt scientifique : Ce travail constitue une référence pour toute personne souhaitant concevoir un système d’information académique similaire.
Il peut également servir de base pour des recherches futures dans le domaine de la digitalisation des processus administratifs dans l’enseignement supérieur.
5. METHODOLOGIE DE TRAVAIL
- Méthode Analytique : Elle nous a permis d’analyser les données reçues pendant notre descente sur terrain.
Méthode Fonctionnelle : Elle nous a permis de savoir le fonctionnement de différents postes de travail ou du système à utiliser.
6. TECHNIQUE UTILISEES
Dans le cadre de notre étude, nous avons utilisés les techniques ci-après :
- Technique documentaire : Elle nous a permis d’obtenir et de recenser des données à partir des documents utilisés concernant.
- Technique d’observation : cette technique nous a permis d’obtenir et de récolter les informations nécessaires par simple vue.
- Technique d’Interview : cette technique est un procédé d’investigation scientifique utilisant un processus d’échange verbal pour recueillir des informations.
7. DÉLIMITATION DE L’ÉTUDE
7.1. DELIMITATION DANS L’ESPACE
Notre espace du travail et le service de l’inscription de l’Institut Supérieur Pédagogique (ISP) de Masi-Manimba. Plus précisément au service d’inscription.
7.2. DELIMITATION DANS LE TEMPS
La période couverte, par cette étude s’étend de 2020 à 2025, qui constitue notre cadre temporel de référence pour la conception, la mise en œuvre et l’évaluation de la solution proposée.BUTELA R.(2023-2024).
8. OBJECTIFS DE L’ÉTUDE
8.1. OBJECTIF GLOBAL
L’objectif principal de ce travail est de concevoir et réaliser une application web permettant de gérer efficacement les inscriptions des étudiants à l’ISP/Masi-Manimba. Cette plateforme offrira un accès décentralisé et sécurisé aux informations, tout en simplifiant les démarches pour les étudiants et le personnel administratif.
7.2. OBJECTIF SOCIAL
Ce projet vise à contribuer à la modernisation du système académique à travers la digitalisation des inscriptions. Il permettra à l’institution de gagner en efficacité, en transparence, et offrira un meilleur service aux étudiants, réduisant les longues files d’attente et les erreurs liées aux méthodes manuelles et surtout à bien archivées les informations d’inscription pour une utilisation future.
9. DIFFICULTÉS RENCONTRÉES
Comme tout travail scientifique, ce projet n’a pas été exempté de difficultés. Parmi les principaux obstacles rencontrés, nous pouvons citer :
- L’instabilité de l’électricité, qui a perturbé nos séances de travail ;
- Le manque de ressources financières pour certaines phases du développement ;
- L’accès limité à une connexion internet stable ;
- Et d’autres contraintes techniques et logistiques.
10. SUBDIVISION DU TRAVAIL
En dehors de l’introduction et de la conclusion générale, notre travail est structuré autour de quatre chapitres :
Chapitre I : les concepts de base : est basé sur les définitions de concepts liés à notre travail.
Chapitre II : Etude préalable : lie à l’existence du système qui est ISP-MASI voir comment fonctionne le processus d’inscription en fin la critique et donner solutions.
Chapitre III Conception et implémentation du nouveau système : décrit la manière donc ont modélisé notre système avec UML et conception ;
Chapitre IV. Application : Présente l’application c’est-à-dire les différents page web qui permet aux utilisateurs(candidat) de s’inscrire et leur code.
CHAPITRE I. CONCEPTS DE BASE [1]
I.1. INTRODUCTION
Ce chapitre établit les bases théoriques nécessaires pour comprendre les concepts et technologies au cœur de notre projet. Dans un contexte marqué par l’évolution rapide des outils numériques, il est essentiel de maîtriser les notions fondamentales liées au web, aux bases de données et à la modélisation logicielle. Ces concepts fourniront une structure claire et cohérente pour le développement de notre plateforme.
Nous abordons les applications web, les architectures logicielles, ainsi que les bases de données et leurs systèmes de gestion. Ces outils, essentiels à la conception d’un système fiable et performant, seront analysés en détail.
I.2. L’INFRASTRUCTURE RESEAU AU SERVICE DU WEB
I.2.1. Objectif
Le développement d’un site web d’inscription en ligne ne peut se concevoir indépendamment de la couche réseau sur laquelle il repose. En effet, le Web est un service qui fonctionne grâce à une infrastructure réseau, à savoir l’Internet. Ce point présente les notions fondamentales du réseau nécessaires au fonctionnement d’un site web, avec une attention particulière sur la communication client-serveur, les protocoles web, ainsi que l’infrastructure d’hébergement.
I.2.2. Le Web et le réseau : une relation étroite
Le World Wide Web (WWW) est une application qui utilise le réseau Internet comme infrastructure de transport. Il permet l’échange d’informations à travers des pages web, grâce au protocole HTTP (HyperText Transfer Protocol).
Selon Tanenbaum et Wetherall (2011), « Le Web est une application de l’Internet qui repose sur une architecture client-serveur, utilisant HTTP comme protocole principal de communication ».
I.2.3. LES COMPOSANTS RESEAUX ESSENTIELS AU SITE WEB
a) Le modèle client-serveur
Le site web d’inscription fonctionne sur le principe du modèle client-serveur.
- Le client est l’utilisateur (l’étudiant) qui accède au site via un navigateur.
- Le serveur héberge le site et traite les requêtes HTTP.
b) Le protocole HTTP/HTTPS
- HTTP est le protocole de communication entre le navigateur (client) et le serveur.
- HTTPS (HTTP Secure) ajoute une couche de sécurité via TLS/SSL, ce qui est indispensable pour la sécurité des données sensibles des étudiants.
Selon Kurose & Ross (2017) : « Le protocole HTTP définit comment les messages sont formatés et transmis, et comment les serveurs et les navigateurs réagissent à différentes commandes. »
I.2.3.4. L’infrastructure réseau locale de l’isp/manimba
Pour héberger un site web localement ou sur Internet, l’ISP/MANIMBA doit disposer d’une connexion stable à Internet, d’un serveur web (local ou distant), d’un nom de domaine (ex. : inscriptions-ispmanimba.cd), et éventuellement d’un certificat SSL pour sécuriser les échanges.
Une étude de cas locale pourrait inclure un schéma du réseau de l’institut, les équipements utilisés (routeur, modem, switch), et le mode d’hébergement (local ou cloud).
I.2.3.5. Sécurité et fiabilité du réseau
La disponibilité du site web dépend directement de la stabilité du réseau. Des problèmes comme des coupures de connexion Internet ou un réseau local mal configuré peuvent empêcher les inscriptions.
Par conséquent, il est crucial d’implémenter :
- Une connexion Internet fiable
- Des systèmes de sauvegarde
- Des protocoles de sécurité réseau
I.3. GENERALITE SUR LE WEB
Le web a été créé en 1989 comme application de partage d’informations puis est devenu une plate-forme à part entière sur laquelle sont développées régulièrement des nouvelles technologies. Les bases de ces technologies sont le protocole réseau HTTP, normalisé par l’IETF, et le format de document HTML, normalisé par le World Wide Web Consortium (W3C). Ce dernier organisme est l’organe central de normalisation des technologies web.
Destiné par son créateur Tim Bernes-Lee, en Suisse, au CERN, à lier un document à un autre via une balise de texte renvoyant vers une autre page, selon le principe de l’hypertexte, le web est devenu l’un des protocoles d’échange les plus utilisés.
I.3.1. Définition du Web et Internet
- World Wide Web
Le World Wide Web ; littéralement la « toile (d’araignée) mondiale », abrégé www ou le Web, la Toile mondiale ou la Toile, est un système hypertexte public fonctionnant sur Internet. Le Web permet de consulter, avec un navigateur, des pages accessibles sur des sites. L’image de la toile d’ara ignée vient des hyperliens qui lient les pages web entre elles.
- L’Internet
Figure I. 1: Aperçu de la représentation du web
L’Internet est un réseau informatique mondial accessible au public. Il s’agit d’un réseau de réseaux, à commutation de paquets, sans centre névralgique, composé de millions de réseaux aussi bien publics que privés, universitaires, commerciaux et gouvernementaux, eux-mêmes regroupés en réseaux autonomes ;
L’information est transmise via Internet grâce à un ensemble standardisé de protocoles de transfert de données, qui permet des applications variées comme le courrier électronique, le World Wide Web, la messagerie instantanée, le partage de fichiers en pair-à-pair, le streaming, le podcasting, la téléconférence.
Figure I.2. : Aperçu de la représentation du web
I.3.3. HEBERGEMENT WEB
Figure I. 3 : Aperçu du fonctionnement d’un hébergeur
L’hébergement est un service qui vise à rendre un site ou une application web accessible sur internet.
Afin que les pages soient visibles par tout le monde, il faut qu’elles soient stockées sur un ordinateur connecté en permanence à l’internet (serveur).4
Un hébergeur web est une entité ayant pour vocation de mettre à la disposition des internautes des sites web conçus et gérés par des tiers.
Types d’hébergement
Les types d’hébergement se distinguent par ergonomie et leur mode d’emploi. On distingue en outre :
b) Les hébergements Dédiés
Figure I. 4 : Aperçu de l’illustration d’un serveur dédié
L’hébergement dédié consiste à louer auprès d’un hébergeur web un serveur complet qu’il est ensuite possible de configurer selon ses besoins (choix du système d’exploitation, choix de la configuration et des applications…).
c) Les hébergements Nuragique ou Cloud
Figure I. 5: Aperçu de l’illustration d’un hébergeur
Contrairement à l’hébergement mutualisé et l’hébergement dédié, l’hébergement Cloud ne repose pas sur un serveur mais sur une multitude de serveurs et le client paye pour qu’il utilise vraiment, ce qui permet une flexibilité accrue.
d) Les hébergements Mutualisé.
Figure I. 6: Aperçu de l’illustration d’un hébergeur Mutualisé
L’hébergement mutualisé consiste à se partager à plusieurs un seul et même serveur.
I.3.4. NOTION DES PROTOCOLES ET PORTS
I.3.4.1. NOTION DE PORTS
Lors d’une communication entre deux ordinateurs en réseau, les informations destinées à plusieurs applications sont échangées. Chaque information transite par la mêmepasserelle et transférée selon l’application qu’il la concerne. On attribue donc chaque port à son application. Un port est codé sur 16 bits donne, en général il y a 65536 ports. Parmi ces ports, 1024 sont utilisés pour le service web qui sont à la base de l’architecture client/serveur.
I.3.4.2. NOTION DES PROTOCOLES
Un protocole est une série d’étapes à suivre pour permettre une communication harmonieuse entre plusieurs ordinateurs. L’Internet est un ensemble de protocoles ? regroupés sous le terme « TCP-IP » (Transmission Control Protocol/Internet Protocol).
I.3.5. Pages web, site web et serveur web
Une page Web est un document destiné à être consulté avec un navigateur Web.
Figure I. 7: Aperçu du fonctionnement d’un serveur web
Le serveur web est un ensemble de matériel (ordinateur et logiciel) paramétré pour pouvoir traiter des pages contenant la programmation. Il reconnaît ces pages grâce à l’URL qu’il reçoit.
Il effectue les traitements demandés et transmet le résultat au format html au browser de l’internaute.
I.4. APPLICATIONS WEB
En informatique, une application web est une application manipulable directement grâce à un navigateur web et qui ne nécessite donc pas d’installation sur les machines clientes, contrairement aux applications mobiles et desktop. De la même manière que les sites web, une application web est généralement installée sur un serveur web et se manipule en actionnant des widgets à l’aide d’un navigateur web, via un réseau informatique (Internet, intranet, réseau local, etc.).
Exemples : Des messageries web, les systèmes de gestion de contenu, les wikis et les blogs sont des applications web.
Les moteurs de recherches, les logiciels de commerce électronique, les jeux en ligne, les logiciels de forum, les agrégateurs peuvent être sous forme d’application web.
I.5. NOTIONS DE BASE DES DONNEES
La base de données a plusieurs définitions, mais nous nous se focalisons sur ceci : « une base de données est une entité dans laquelle il est possible de stocker des données de façon structurée et avec le moins de redondance possible ».
Ensemble cohérent, intégré, partagé de données structurées défini pour les besoins d’une application.
- Base de données informatisée : est un ensemble structuré de données enregistrées sur de supports accessibles par l’ordinateur, représentant des informations du monde réel et pouvant être interrogées et mise à jour pour une communauté d’utilisateurs.
- Banque de données : est un système utilisé pour le reporting et l’analyse des données. Elle centralise les informations provenant de différentes sources en vue d’aider à la prise de décision.
Amazon Redshift : qui est une de banque de données qui permet d’analyser des quantités massives de données provenant d’applications variées pour générer des rapports et des analyses.
Google BigQuery : est un service de data warehouse entièrement géré par Google cloud. Il propose une version gratuite qui te permet d’exécuter des requêtes sur un certain volume de données chaque mois.
I.5.1. Critères d’une base de données relationnelle
Une base de données se caractérise par des critères suivants :
- Se rapporter à un seul objet précis (exemple : personne d’une entreprise, articles d’un magasin, étudiants d’un établissement d’enseignement supérieur,) ;
- Exhaustivité : elle doit contenir tous les renseignements (absolument tous) sur le sujet concerné ;
- Non redondance : chaque information doit figurer une et une seule fois dans sa base : ce qui permet d’économiser de la place sur le support informatique (exemple : le nom d’un client ne peut figurer que dans un seul fichier de la base) ;
- Structure : les données doivent être stockées dans la base de manière à accéder rapidement et sûrement à celles qu’on recherche en établissant des relations (ou liens de chaînage) entre données de la base, grâce à des clés d’accès ou pointeurs ;
- Indépendance de la structure des données par rapport à la structure des traitements (possibilité de modifier les programmes sans modifier l’organisation des données ou de changer la structure de la base sans devoir intervenir au niveau des programmes) ;
- Partage simultanée des données entre plusieurs programmes d’application ;
- Accès interactif à la base ;
- Confidentialité de toutes ou certaines données de la base (il y a possibilité de verrouiller certaines données qui ne peuvent être accédées que grâce à un mot de passe).
I.5.3. Utilité d’une base de données
Une base de données permet de mettre des données à la disposition des utilisateurs pour une consultation, une saisie ou bien une mise à jour, tout en s’assurant des droits accordés à ces derniers. Cela est d’autant plus utile que les données informatiques sont de plus en plus nombreuses.
Une base de données peut être locale, c’est-à-dire utilisable sur une machine par un utilisateur ; ou bien répartie, c’est-à-dire que les informations sont stockées sur des machines distantes et accessibles par réseau.
L’avantage majeur de l’utilisation de bases de données est la possibilité de pouvoir être accédées par plusieurs utilisateurs simultanément.
Fig. 3: Utilité d’une base de données I.5.4. Module de la base de données
Il existe cinq modèles de SGBD, différenciés selon la représentation des données qu’elles contiennent.
- Le modèle hiérarchique
Les données sont classées hiérarchiquement selon une arborescence descendante. Ce modèle utilise des pointeurs entre les différents enregistrements. Il s’agit du premier modèle de SGBD.
Figure I. 8: Modèle Hiérarchique
- Le modèle réseau
Comme le modèle hiérarchique ce modèle utilise des pointeurs vers des enregistrements. Toutefois la structure n’est plus forcément arborescente dans le sens descendant.
| Figure I. 9 : modèle réseau |
- Le modèle relationnel
Les données sont enregistrées dans des tableaux à deux dimensions (lignes et colonnes). La manipulation de ces données se fait selon la théorie mathématique des relations.
Figure I.10: Modèle relationnel
Les données sont représentées sous forme de table, mais leur manipulation se fait par calcul de prédicat.
- Le modèle objet
Les données sont stockées sous forme d’objets, c’est-à-dire de structures appelées classes présentant des données membres. Les champs sont des instances de ces classes[2].
Figure I.12: Modèle objet
A la fin des années 90 les bases relationnelles sont les bases de données les plus répandues (environ trois quarts des bases de données). Il est très avantageux d’organiser les informations en base de données, aussi en voici les avantages :
- La saisie unique des données ;
- Une mise à jour unique ;
- Un gain de place important au niveau du stockage ;
- Un accès plus facile à l’information ;
- La possibilité d’évaluer la base de données
Ceci est d’autant plus avantageux pour notre démarche d’informatisation qui touche un domaine aussi important qu’est la gestion des passagers, les passagers qu’il faudra recenser au fur et à mesure que s’accroitrons, on l’espère, les statistiques ou l’effectif.
I.6. SYSTEME DE GESTION DE BASE DE DONNEES « SGBD »
Le Système de Gestion de Base de Données (SGBD) est un logiciel qui permet l’implantation et l’exploitation d’une base de données. Le SGBD joue le rôle une interface entre ladite base de données et l’utilisateur. Il est caractérisé par :
- Indépendance physique : le niveau physique peut être modifié indépendamment du niveau conceptuel.
- Cela signifie que tous les aspects matériels de la base de données n’apparaissent pas pour l’utilisateur, il s’agit simplement d’une structure transparente de représentation des informations.
- L’implantation des données :
Un SGBD possède un langage de description de données (LDD) qui permet la description des types d’objets qui seront utilisées. Le SGBD se charge de l’implémentation physique de données.
- La gestion du dictionnaire de données
Les informations relatives à la description, à l’implémentation et à l’utilisation de données sont mémorisées dans une base de données spécifique appelée Meta base. Cette méta base contient des dictionnaires et est gérée à l’aide du SGBD lui-même.
- Les langages d’interrogation et de manipulation
Les SGBD disposent de langages spécifiques pour l’interrogation des données. SQL est l’un le plus connus. En général, les SGBD ne disposent, pour la manipulation des données (procédure et calcul), que d’un langage hôte (COBOL, C, ADA, PL1). On parle, pour ces langages, de langage de manipulation de données (LMD).
- Optimiseur de requêtes
Dans certains SGBD (en particulier, les SBGD relationnels), il Ya plusieurs façons d’arriver à la sélection de données répondant à une requête considérée. L’optimiseur choisit la façon la moins couteuse.
- L’intégrité et la confidentialité
L’effet que la donnée soit facilement accessible à tous (d’un point de vue technique), nécessite l’existence d’un système de confidentialité. Seuls les utilisateurs autorisés seront habilités à consulter certains partis de la base. D’autre part, l’effet que beaucoup des personnes utilisent la base nécessite des contrôles fréquents sur la validité de données. Le système d’intégrité a pour but d’assurer en permanence la cohérence de donnée.
I.7. UML[3]
UML est un langage formel et normalisé : il permet un gain de précision et stabilité. UML est aussi un support de communication performant : il permet grâce à sa représentation graphique, d’exprimer visuellement une solution objet, de faciliter la comparaison et l’évolution de solution.
Créé dans les années 1990 pa Grady Booch, Ivar Jacobson et James Rumbaugh, qui sont connus sous le nom des « trois amigos ». Ils ont voulu unifier les différentes méthodes de modélisation existantes à l’époque pour créer un langage cohérent et standardisé et vise à fournir un moyen de visualiser, spécifier, construire et documenter les artefacts d’un système.
- Indépendance logique : Le niveau conceptuel doit pouvoir être modifié sans remettre en cause le niveau physique, c’est-à-dire que l’administrateur de la base doit pouvoir la faire évoluer sans que cela gêne les utilisateurs.
- Manipulabilité : des personnes ne connaissant pas la base de données doivent être capables de décrire leur requête sans faire référence à des éléments techniques de la base de données.
- Rapidité des accès : Le système doit pouvoir fournir les réponses aux requêtes le plus rapidement possibles, cela implique des algorithmes de recherche rapides.
- Administration centralisée : Le SGBD doit permettre à l’administrateur de pouvoir manipuler les données, insérer des éléments, vérifier son intégrité de façon centralisée.
- Limitation de la redondance : Le SGBD doit pouvoir éviter dans la mesure du possible des informations redondantes, afin d’éviter d’une part un gaspillage d’espace mémoire mais aussi des erreurs.
- Vérification de l’intégrité : Les données doivent être cohérentes entre elles, de plus lorsque des éléments font référence à d’autres, ces derniers doivent être présents.
- Partageabilité des données : Le SGBD doit permettre l’accès simultané à la base de données par plusieurs utilisateurs.
- Sécurité des données : Le SGBD doit présenter des mécanismes permettant de gérer les droits d’accès aux données selon les utilisateurs.
Les principales fonctionnalités des SGBD sont :
Il modélise les différents aspects du système en utilisant différents axes :
Figure I. 13: Axes de modélisation d’UML
UML comprend un total de 14 Types de diagrammes, qui se divisent en deux grandes catégories :
- Les diagrammes structurels
Cette catégorie de diagramme comprend 9 diagrammes :
- Diagrammes de classes : Montre les classes du système et leurs relations.
- Diagramme d’Objets : Représente les objets d’un système et leurs relations à un moment donné.
- Diagramme de composants : Illustre l’organisation des composants logiciels et leurs dépendances.
- Diagramme de déploiement : montre comment les composants sont déployés sur le matériel.
- Diagramme de structure composite : visualise la structure interne d’une classe ou d’un composant.
- Diagramme de packages : organise les éléments du modèle en groupes logiques appelés packages.
- Diagramme de profils : permet d’étendre UML pour des domaines spécifiques à l’aide de stéréotypes.
- Diagramme d’architecture : montre l’architecture globale du système, incluant les différents sous-systèmes et leurs interactions.
- Diagramme de classes d’interaction : montre comment les classes interagissent entre elles dans un scénario particulier.
- Les diagrammes comportementaux
Cette catégorie de diagramme comprend 5 diagrammes :
- Diagrammes de cas d’utilisation : représente les fonctionnalités du système du point de vue des utilisateurs.
- Diagramme de séquence : illustre comment les objets interagissent dans le temps pour réaliser une fonctionnalité.
- Diagramme de collaboration : montre comment les objets collaborent pour accomplir une tâche.
- Diagramme d’activité : représente le flux de travail ou le processus métier à travers différentes activités.
- Diagrammes d’Etat-transition : montre les états d’un objet et les transitions ente ces états en réponse à des évènements.
CONCLUSION PARTIELLE
Ce chapitre état basé sur les définitions des différents concepts clés utilisés dans notre travail pour la meilleure compréhension du sujet aux lecteurs.
CHAPITRE II. ANALYSE PREALABLE
II.1. ETUDE DE L’EXISTANT
II.1.1. Historique
L’institut supérieur pédagogique de Masi-manimba est le résultat d’un long processus. Il est né en 2001, sous les pensées d’une extension de l’institut supérieur pédagogique de Kikwit à Masi-manimba, impulsée par le chef de travaux MUTUNGU de l’ISP/ Kikwit en ce jour à Masi en qualité de l’officiel de L’AFDL en 1997.
Ensuite, certains fils du terrain, en l’occurrence de Monsieur KAPINI Colon, WANGA – WANGA Joachim, KATSHOKO Nkongu, MUBELO Ndengande, WANGA Corneille, et KUKEMBILA sont descendus à Kikwit en Mai 1999, pour inciter l’implantation d’une extension à Masi-manimba. C’est ainsi que la tutelle (ministre de l’E.S.U) a diligenté une commission experte du ministère de tutelle, en une procéder à une étude de faisabilité. Au terme de cette descente, la décision N ° CAS – ISP / PR / 018 / 2001 du 21/09/2001 portant autorisation d’ouverture de postes d’extension de l’Isp/Kikwit à Masi-manimba.
Cette autorisation se suivra par l’ouverture solennelle le15 octobre 2001 sous les auspices du Directeur général, le professeur ordinaire Pierre Célestin LEMBA NGUSALA.
Du point de vue finance, l’extension qui venait de voir le jour, pour son fonctionnement, le déplacement, la restauration … étaient soutenus en grande partie par le comité de base. Concernant le logement des enseignants visiteurs, le citoyen Cléophas KAMITATU MASAMBA avait cédé quelques chambres de son hôtel Relais pour les enseignants visiteurs et les autorités de l’extension de Masi-manimba.
II.1.2. Situation géographique
L’institut supérieur pédagogique (ISP) en sigle se situe sur l’avenue : ISP, N°01, Quartier Mingongo. Il est borné :
- A l’Est, par l’institut Milodi ;
- A l’ouest par l’hôpital général de référence de Masi-manimba ;
- Au Nord, par la route nationale N°1 ;
- Au sud par l’institut Kutomisa.
Il est implanté dans la commune rurale de Masi-manimba, territoire de Masi-manimba, province du Kwilu en République Démocratique du Congo.
II.1.3. Identité L’institut supérieur pédagogique de Masi-Manimba
L’institut supérieur pédagogique de Masi-manimba bénéficie d’une personnalité juridique propre à la suite de l’arrêté N° CABMIN/MINESU/230/2006 du 26 juin 2006, portant autonomisation et prise en charge par le trésor public.
En nous référant aux instructions académiques de l’E.S.U, l’ISP/Masi fonctionne avec des organes bien définis dont les attributions sont expressément définies afin d’éviter toute usurpation de pouvoir.
Ces organes sont :
- Le Directeur général ;
- Le secrétaire général académique ;
- Le secrétaire général Administratif ;
- Administrateur de Budget.
Chaque organe fonctionne de manière autonome mais collabore avec les autres organes en vue de garder l’harmonie dans le fonctionnement de l’établissement.
II.1.4. Filières organisées
L’ISP/Masi-manimba organise près de 3 sections regroupent 12 options et une EDAP ou filières regroupées autour de 3 sections. Il existe actuellement : (LMD et L2 PADEM).
- Section lettres et sciences humaines :
- L’anglais culture africaine ;
- Français langues africaines ;
- Français latin ;
- Histoire et sciences sociales ;
- Gestion et Administration des institutions scolaires et pour ;
- Orientation scolaire et professionnelle.
- Section sciences exactes : Biologie chimie ;Physique mathématique ;Géographie et gestion de l’environnement.
- Section Technique :
- Informatique de gestion ;
- Production et santé ;
- Phytotechnique et défense des cultures (PDC) ;
- Science commerciale et administrative (SC).
- La section d’Ecole d’Application (EDAP)
- Secondaire : 7éme EB et 8éme EB
- 1ére à 3éme humanités informatique de gestion ;
- 1ére à 3éme humanités sciences
- 1ére à 3éme humanités pédagogique.
Soit quatre sections et 14 options au total.
II.1.5. L’organigramme de l’ISP-MASI
L’organigramme de l’institut supérieur pédagogique de Masi-manimba est celui conféré à tout Etablissements de l’enseignement supérieur et universitaire à vocation pédagogique c’est – à – dire qui forme des cadres (qualifiés) de l’enseignement secondaire.
- L’organisation structuro-fonctionnement du service d’inscription
- Organigramme du service concerné [4]
Source : Service scolarité
II.1.6. Etudes des documents manuels utilisés
Les documents sont :
- Liste des étudiants inscrits par promotions ;
- Bulletin d’inscription.
- CAHIER DE LISTE DES ETUDIANTS INSCRITS PAR PROMOTION
Tableau II.1 : cahier de liste des étudiants inscrits par promotion
| N° | Noms & post-noms | Sexe | Section | Promotion |
Commentaire : est un outil administratif dans établissement universitaires.
Il joue plusieurs rôles clés pour assurer une gestion efficace et structurée des étudiants. Il permet de regrouper les étudiants par année académique ou promotion, compte le nombre des étudiants inscrit par promotion.
- BULLETIN D’INSCRIPTION
| REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGOMINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET UNIVERSITAIREINSTITUT SUPERIEUR PEDAGOGIQUE DE MASI-MANIMBA ISP/MASI Direction des Services académiqueBULLETIN D’INSCRIPTIONN.B : tout bulletin contenant de faux renseignements ne sera pas pris en considération.ANNNEE ACADEMIQUE : 20……………./2 0……….IDENTITENOM : ………………………………………………………………………. POST-NOM ET PRENOM : ………………………………………………………………………..Lieu et date de Naissance : ……………………………………………………………………….. …Sexe : …………………………………………………………………………………………………Etat-Civil : ………………………………………………………………………………Nationalité : …………………………………………………………………………………………………Nom du Père et da mère ……………………………………………………………………….. …Province d’Origine des parents : ……………………district ………………territoire …………….Etudes faitesNom de l’école secondaire fréquentées ……………………………………………………………Implantation : …………………………………………………………..……………………………….Section suivie aux humanités : ………………………………………………………………………………Certificat d’Examen d’Etat : …………………………………………………………..Année d’obtention du diplôme d’Etat…………………………………………………………..Numéro du diplôme d’Etat : …………………………………………………………..Les finalistes de l’années encours ne remplirent pas les points 14 et 15.OCCUPATIONS APRES LES HUMANITES Activités Professionnelles : …………………………………………………………..Etudes post secondaires entreprises : Années Académique Etablissement Année d’études Section/option Résultat Choix formulaires : tout candidat doit faire deux choix : Premier choix : section …………………………………………………………..Option : …………………………………………………………..Premier choix : section …………………………………………………………..Option : …………………………………………………………..Je certifie sur mon honneur que ces renseignements ci-dessus sont sincères et exactFait à Masi-Manimba, le …./……/ 20 …… |
Commentaire : son rôle de suivre et documenter les inscriptions des étudiants dans une institution d’enseignement.
II.1.7. Etude des ressources de traitement des informations
L’étude de moyens de traitement des informations constitue l’étape essentielle d’étude des matérielles utilisés pour le traitement des informations. Au cours de cette analyse nous tenons compte de trois moyens de traitement de l’information qui sont :
- Ressources humaines ;
- Ressources matérielles ;
- Ressources financières.
- Ressources humaines
Par moyens humains, il est question des ressources en personnel qui concourt à la réalisation des tâches qui leur sont confié dans un domaine donné.
A cet effet, la gestion d’inscription au sein de l’institut supérieur pédagogique de Masi-manimba est assurée par la service de la scolarité repris dans le tableau ci-dessous :
- Fiche d’analyse des moyens humains.
1. Tableau II.2. Fiche d’analyse des Moyens humains
| ANALYSTE : Socrate MABINGILA PROJET : conception et réalisation d’une application web pour la gestion des inscriptions des étudiants d’une institution supérieur l’ISP-MASI APPLICATION : Fiche analytique de postes de travail DATE : 7 Janvier 2025 | |||||
| N° | NOM DE POSTE | NOMBRE DE PERSONNE | NIVEAU D’ETUDE | SPECIALITE | ANCIENNETE |
| 1 | Guidance | 1 | Graduée | 2ans | |
| 2 | Charge d’inscription | 1 | Gradue | 5ans | |
| 3 | Scolarité | 1 | Gradue | ns | |
- Moyens Matériels
Par moyens matériels nous faisons allusions aux outils de travail que les moyens emploient dans la réalisation des tâches de la gestion, qui sont :
- Table de bureau
- Agrafeuse
- Stylo
- Encre Correcteur
- Marker
- Calculatrice
- Farde chemise
- Papier duplicateur
- Etagère de bureau
- Cachet
II.1.8. Narration
Au sein du département d’inscription de l’université, un nouveau candidat se présente pour s’inscrire. Il est accueilli chaleureusement par le personnel du département, qui l’accompagne tout au long du processus d’inscription.
Le candidat est d’abord invité à remplir un formulaire d’inscription, où il doit fournir des informations personnelles et académiques.
Le chargé d’inscription est là pour l’aider et répondre à toutes ses questions. Une fois le formulaire rempli, le candidat doit fournir des documents nécessaires, tels que des diplômes ou des certificats, pour prouver ses qualifications. L’agent d’inscription vérifie ces documents et s’assure qu’ils sont en règle.
Ensuite, le candidat doit choisir ses cours et ses programmes d’études. Le personnel du département l’aide à naviguer dans les différentes options disponibles et à choisir ceux qui correspondent le mieux à ses intérêts et à ses objectifs.
2. Tableau II. 3 : Diagramme d’activité existant
II.2. CRITIQUE DU SYSTEME EXISTANTS
II.2.1. Points forts du système actuel (manuel)
Bien que rudimentaire, le système actuel de gestion des inscriptions présente quelques avantages :
- Faible coût initial : Il ne nécessite pas d’équipements technologiques complexes ni de formation spécialisée.
- Accessibilité immédiate : Les dossiers papier peuvent être manipulés facilement sans outil informatique.
- Simplicité d’utilisation : Le personnel n’a pas besoin de compétences techniques avancées pour utiliser le système papier.
II.2.2. Points faibles du système existant
Cependant, ce système présente de nombreux inconvénients majeurs :
- Lenteur des procédures : Les processus d’inscription sont longs, nécessitant un traitement manuel de chaque dossier.
- Risque élevé d’erreurs : Les erreurs de saisie ou de traitement sont fréquentes.
- Problème de stockage et d’archivage : Les documents physiques occupent beaucoup d’espace et sont vulnérables à l’usure, à l’humidité ou à la perte.
- Manque de traçabilité : Il est difficile de suivre l’évolution d’un dossier étudiant.
- Difficulté de consultation des données : La recherche d’informations est laborieuse.
- Aucune sécurité : N’importe qui peut accéder aux dossiers physiques sans authentification.
II.2.3. Les solutions existantes : manuelle vs informatique
| Table II.4. Les solutions existantes entre manuelle et informatique |
II.3. Choix de solution
Après avoir analysé les deux types de solutions, il apparaît clairement que la solution informatique est la plus adaptée au contexte actuel de l’ISP/Masi-Manimba.
· Pourquoi opter pour une solution informatique ?
- Elle décentralise les données dans une base sécurisée ;
- Elle offre une interface intuitive pour les étudiants et les agents administratifs ;
- Elle réduit considérablement les délais d’inscription ;
- Elle permet l’archivage électronique et la consultation rapide des dossiers.
CHAPITRE III. CONCEPTION ET IMPLEMENTATION DU NOUVEAU SYSTEME
III.1. CONCEPTION DU NOUVEAU SYSTEME
Après traitement des grandes lignes pour la phase de spécification de besoin, nous allons cette fois mettre un accent sur l’une des phases très importante dans le cycle de vie d’un projet qui est la conception.
Cette section a pour but de définir la solution conceptuelle de notre travail, il consistera à reproduire les différents besoins cités précédemment sous forme des diagrammes UML.
III.2. Spécifications des besoins du nouveau système[5]
a) Besoins fonctionnels (ce que le système doit faire)
- Inscription des étudiants en ligne (avec formulaire sécurisé) ;
- Création, modification et consultation des dossiers étudiants ;
- Gestion des promotions et filières ;
- Authentification des utilisateurs (administrateurs et étudiants) ;
- Recherche rapide d’un dossier via critères multiples (matricule, nom, etc.);
- Génération de fiches et rapports d’inscription en format PDF ;
- Notification automatique (email ou affichage) après validation de l’inscription ;
- Sauvegarde automatique des données.
b) Besoins non fonctionnels (qualité du système)
- Simplicité d’utilisation : Interface intuitive, facile à prendre en main ;
- Sécurité des données : Utilisation de protocoles HTTPS, rôles d’utilisateurs, mot de passe chiffré ;
- Performance : Réponses rapides même avec un grand volume d’inscriptions ;
- Accessibilité : Système disponible 24h/24, accessible depuis un smartphone ou un ordinateur ;
- Maintenabilité : Le système doit être facilement mis à jour ;
- Évolutivité : Capable d’intégrer de nouvelles fonctionnalités (paiement en ligne, messagerie interne, etc.) ;
- Compatibilité : Fonctionne avec les principaux navigateurs (Chrome, Firefox, etc.). C’est l’étape qui permet à l’informaticien de faire l’analyse de la situation du monde réel. Cette action consiste à déterminer les objectifs du système à concevoir et à identifier les éléments qui seront pris en compte dans celui-ci.
L’analyse se fait avec trois éléments indispensables qui sont :
- La démarche : elle est le processus qui permet d’effectuer le travail de modélisation, de description et de réalisation du système d’information.
- Les modèles : les concepts normalisés se présentant sous forme de schéma pour une représentation simple de la réalité et la facilitation du raisonnement. Ils permettent de construire et d’aménager le système d’information.
- Les outils : il s’agit ici de la technique utilisée pour la conception et l’analyse d’un système d’information, du support papier et logiciel employé pour conserver une trace du travail.
III.3. MODELISATION
Un modèle est une représentation simplifiée de la réalité. Pour arriver à la forme directement utilisable par un SGBD.
III.3.1. Langage de modélisation
Pour la modélisation de notre système, nous avons porté notre choix sur l’UML.
Les points importants que nous allons aborder pour UML sont :
III.3.2. Diagramme de cas d’utilisation
Les diagrammes de cas d’utilisation sont des diagrammes UML utilisés pour donner une vision globale du comportement fonctionnel d’un système logiciel.il nous permet de comprendre l’interaction entre le système et l’acteur (intervenant extérieur du système). C’est-à-dire toutes les fonctionnalités doit fournir le système. Il permet aussi de délimiter le système.
a) Identification des acteurs
| ACTEURS | CAS D’UTILISATION DU SYSTEME |
| Administrateur | Consulter à la liste des inscrisAjouter un inscrisModifier un inscris Supprimer un inscrisValider une inscriptionSupprimer une inscriptionGérer les comptes utilisateurs |
| Etudiant | S’inscrireAccéder à la plateformeSuivre une inscription |
| Tableau II. 1:Identification des acteurs et cas d’utilisation |
Dans ce projet il y aura une plateforme III.4. Représentation du Diagramme de cas d’utilisation
source : Astah-professional (AGL)
Figure III. 1: Représentation du DCU
III.5. Description textuelle des cas d’utilisation
- Cas d’utilisation : S’inscrire sur la plateforme
| Élément | Description |
| Nom | S’inscrire sur la plateforme |
| Acteurs | Étudiant |
| Scénario nominal | 1. L’étudiant accède à la plateforme. 2. Il clique sur « S’inscrire ». 3. Il remplit le formulaire d’inscription. 4. Le système valide et enregistre les données. |
| Scénario alternatif | 3a. Données incomplètes ou invalides → Le système affiche un message d’erreur et demande une correction. |
| Précondition | La plateforme est accessible. |
| Post-condition | Un nouveau compte étudiant est créé et enregistré dans le système. |
2. Cas d’utilisation : Valider une inscription
| Élément | Description |
| Nom | Valider une inscription |
| Acteurs | Agent de l’administration |
| Scénario nominal | 1. L’agent consulte la liste des inscriptions en attente. 2. Il sélectionne une inscription. 3. Il clique sur « Valider ». 4. Le système confirme et met à jour le statut. |
| Scénario alternatif | 3a. L’inscription est incomplète → L’agent rejette ou demande des modifications. |
| Précondition | Une inscription soumise existe et est en attente de validation. |
| Post-condition | L’inscription est validée et l’étudiant a accès aux services. |
3. Cas d’utilisation : Modifier un inscrit
| Élément | Description |
| Nom | Modifier un inscrit |
| Acteurs | Agent de l’administration |
| Scénario nominal | 1. L’agent recherche un inscrit dans la liste. 2. Il clique sur « Modifier ». 3. Il met à jour les informations. 4. Le système enregistre les modifications. |
| Scénario alternatif | 3a. Données invalides → Le système bloque la modification et affiche une erreur. |
| Préc ondition | L’inscrit existe dans le système. |
| Post-condition | Les informations de l’inscrit sont mises à jour. |
4. Cas d’utilisation : Supprimer une inscription
| Élément | Description |
| Nom | Supprimer une inscription |
| Acteurs | Agent de l’administration |
| Scénario nominal | 1. L’agent consulte la liste des inscrits. 2. Il sélectionne une inscription. 3. Il clique sur « Supprimer ». 4. Le système demande confirmation. 5. L’agent confirme et l’inscription est supprimée. |
| Scénario alternatif | 5a. L’agent annule → La suppression est abandonnée. |
| Précondition | L’inscription existe dans le système. |
| Post-condition | L’inscription est supprimée définitivement. |
| Tableau II. 2: Cas d’inscrire sur la plateforme |
Cas d’utilisation : Gérer les comptes utilisateurs
| Élément | Description |
| Nom | Gérer les comptes utilisateurs |
| Acteurs | Agent de l’administration |
| Scénario nominal | 1. L’agent accède à la gestion des comptes. 2. Il choisit d’ajouter, modifier ou supprimer un compte. 3. Le système exécute l’action et confirme. |
| Scénario alternatif | 3a. Action non autorisée → Le système refuse et notifie l’agent. |
| Précondition | L’agent a les droits d’administration. |
| Post-condition | Les comptes utilisateurs sont mis à jour selon l’action choisie. |
III.6. Le cycle de développement en V
De nos jours, la méthodologie adoptée dans l’analyse et la conception des systèmes représente un choix stratégique pour le bureau d’études afin de mener à terme les projets tout en respectant les délais annoncés au client et avec la qualité demandée.
Vu l’évolution des besoins des utilisateurs finaux, les applications d’entreprise deviennent de plus en plus complexes et difficiles à concevoir et à développer.
Pour la conception, le développement et la réalisation de notre application, nous avons opté pour l’application du processus de développement en V qui demeure actuellement le cycle de vie le plus connu et certainement le plus convenable aux projets complexes. Ce processus nous a accompagné du début de projet jusqu’à l’implémentation.
Son principe est qu’avec toute décomposition doit être décrite la recomposition, et que toute description d’un composant doit être accompagnée de test qui permettront de s’assurer qu’il correspond à sa description. Ceci rend explicite la préparation des dernières phases (validation-vérification) par les premières (construction du l’application) et on sait progressivement si on s’approche de ce que le client désire.
III.6.1. Caractéristiques de la méthode en V
- Structure en V : Le modèle est représenté sous forme de V, où le côté gauche représente les phases de développement (conception, codage) et le côté droit représente les phases de validation (tests, vérifications).
- Phases de développement :
- Analyse des besoins : Identification des besoins des utilisateurs.
- Conception fonctionnelle : Définition des fonctionnalités du système conformément aux besoins.
- Conception technique : Découpage du système en modules et définition de l’architecture technique.
- Implémentation : Codage et développement réel du logiciel.
- Phases de validation :
- Tests d’acceptation : Vérification que le système répond aux besoins initiaux.
- Tests système : Validation du système complet en vérifiant que les différents modules interagissent correctement.
- Tests d’intégration : Vérification du bon fonctionnement des modules entre eux.
- Tests unitaires : Validation de chaque composant individuel.
- Avantages de la méthode en V
- Clarté et rigueur : La structure en V favorise une compréhension claire des relations entre développement et validation MASAMBA E(2025 : Pg23).
- Détection précoce des défauts : Les phases de test sont intégrées tout au long du processus, ce qui permet de détecter et de corriger les problèmes plus tôt.
- Documentation exhaustive : Chaque phase produit de la documentation, ce qui est utile pour la maintenance et la mise à jour future.
- Inconvénients [6]
- Rigidité : Le modèle en V peut être moins flexible face aux changements de besoins ou aux ajustements pendant le développement.
- Difficulté pour les projets très complexes : Pour des projets plus dynamiques ou innovants, d’autres modèles agiles peuvent être plus appropriés.
En résumé, la méthode en V est un modèle structuré qui facilite le développement et la validation de logiciels, surtout dans des contextes où la fiabilité et la documentation sont primordiales.
Figure III. 2 : Structure d’un cycle de développement en v
III.7. CONCEPTION DETAILLEE
C’est ici où l’on génère le plus de volume d’information ; en tant que concepteurs, nous allons élaborer le modèle de conception qui va donner une image « prêt à coder » de notre système.
Cette étape se fera par étape afin d’aboutir à un système fonctionnel reflétant une réalité physique.
1. Diagramme de déploiement
Le diagramme de déploiement est une vue statique qui sert à représenter l’utilisation de l’infrastructure physique par le système et la manière dont les composants du système sont répartis ainsi que leurs relations entre eux.
Figure III. 3: Diagramme de déploiement
2. Diagrammes de séquences
Un diagramme de séquence est un diagramme d’interaction dont le but est de décrire comment les objets collaborent au cours du temps et quelles responsabilités ils assument. Il décrit un scénario d’un cas d’utilisation.
Un Diagramme de Séquence est une forme de diagramme d’interaction, ce qui montre que les objets comme des lignes de sauvetage réduisant la page. Interactions représentées au fil du temps sont dessinées comme des connecteurs de message de la source Ligne de Vie à la Ligne de Vie ciblent.
Les diagrammes de séquence sont bons à montrer les objets qui communiquent avec d’autres objets. Et quels sont les messages déclencher ces communications.
III.7.1. Quelques définitions
- Ligne de vie : représentation de l’existence d’un élément participant dans un diagramme de séquence. Cela peut être un acteur ou le système en modélisation d’exigences, des objets logiciels en conception préliminaire ou conception détaillée.
- Message : élément de communication unidirectionnel entre objets qui déclenche une activité.
- Dans l’objet destinataire : La réception d’un message provoque un événement dans l’objet.
- Récepteur : La flèche pointillée représente un retour au sens UML. Cela signifie que le message en question est le résultat direct du message précédent.
- Message synchrone : l’objet émetteur se bloque en attendant la réponse de l’objet récepteur du message.
- Message asynchrone : l’objet émetteur n’attend pas la réponse de l’objet récepteur du message et continue son activité.
3. Présentation du diagramme de Séquence
- S’authentifier Administrateur
| Figure III.4 : s’authentifier administrateur |
- Supprimer un étudiant
| Figure III.5 : suppression un étudiant |
Ajouter étudiant
| Figure III.6 : Ajouter un étudiant |
III.7.3. Diagramme de classe
III.7.3.1. Définition
Un diagramme de classes UML décrit les structures des objets et des informations utilisées par votre application, à la fois en interne et en communication avec ses utilisateurs. Il décrit les informations sans référence à une implémentation particulière. Ses classes et relations peuvent être implémentées de différentes manière.
4. Représentation du diagramme de classe d’analyse
Figure III. 7 : Diagramme de classe d’analyse
III.4. IMPLEMENTATION DU NOUVEAU SYSTEME
III.4.1. Choix technologique
III.4.1.1. HTML[7]
HyperText Mark up Langage généralement abrégé HTML est un langage de balisage conçu pour présenter les pages web. C’est un langage permettant d’écrire de l’hypertexte, d’où son nom.HTML permet également de structurer sémantiquement et mettre en forme le contenu de la page, d’inclure des ressources multimédias dont des images , des vidéos , et des programmes informatiques .
il permet de créer des documents interopérables avec des équipements très variés de manière conforme aux exigences de l’accessibilité du web .il est souvent utilisé conjointement avec le langage de programmation JavaScript et des feuilles de style en cascade (CSS).
III.4.1.2. CSS
Les feuilles de style en cascade généralement appelées CSS de l’anglais Cascading Style Sheets, forment un langage informatique qui décrit la présentation des documents html et xml. Au milieu des années 1990, CSS devient couramment utilisé dans la conception de sites web et bien pris en charge par les navigateurs web dans les années 2000.
III.4.1.3. PHP[8]
PHP (Hypertext Preprocessor ou Personnal Home Page) est un langage de scripts généraliste et Open source, spécialement conçu pour le développement d’application web. Il peut être intégré facilement au HTML.
Il est aussi un langage interprété (un langage de script) exécuté du côté serveur et non du côté client (un script écrit en Javascript ou une applet Java s’exécute sur votre ordinateur…). La syntaxe du langage provient de celles du langage C, du Perl et de Java. Ses principaux atouts sont :
- Une grande communauté de développeurs partageant des centaines de milliers d’exemples de script PHP ;
- La simplicité d’écriture de scripts ;
- La simplicité d’interfaçage avec des bases de données (de nombreux SGBD sont supportés, mais le plus utilisé avec ce langage est MySQL, un SGBD gratuit disponible sur de nombreuses plateformes : Unix, Linux, Windows, MacOs X, Solaris, etc…) ;
- L’intégration au sein de nombreux serveurs web (Apache, Microsoft IIS, etc.).
III.4.1.4. JAVASCRIPT
Javascript est un langage incorporé dans un document HTML. Historiquement il s’agit même du premier langage de script pour le web. Javascript est un langage de programmation qui permet d’apporter des améliorations au langage HTML en lui permettant d’exécuter des commandes du coté client, c’est-à-dire au niveau du navigateur et non du serveur web.
Ainsi le langage Javascript est fortement dépendant du navigateur appelant la page web dans laquelle le script est incorporé, mais en contrepartie il ne nécessite pas de compilateur, contrairement au langage Java, avec lequel il a longtemps été confondu.
III.4.1.5. Choix d’architecture de l’application (architecture client-serveur)
L’environnement client-serveur désigne un mode de communication à travers un réseau entre plusieurs programmes ou logiciels : l’un, qualifié de client, envoie des requêtes ; l’autre ou les autres, qualifiés de serveurs, attendent les requêtes des clients et y répondent. Par extension, le client désigne également l’ordinateur sur lequel est exécuté le logiciel client, et le serveur, l’ordinateur sur lequel est exécuté le logiciel serveur.
En général, les serveurs sont des ordinateurs dédiés au logiciel serveur qu’ils abritent, et dotés de capacités supérieures à celles des ordinateurs personnels en ce qui concerne la puissance de calcul, les entrées-sorties et les connexions réseau. Les clients sont souvent des ordinateurs personnels ou des appareils individuels (téléphone, tablette), mais pas systématiquement. Un serveur peut répondre aux requêtes d’un grand nombre de clients.
Il existe une grande variété de logiciels serveurs et de logiciels clients en fonction des besoins à servir : un serveur web publie des pages web demandées par des navigateurs web ; un serveur de messagerie électronique envoie des mails à des clients de messagerie ;
un serveur de fichiers permet de stocker et consulter des fichiers sur le réseau ; un serveur de données à communiquer des données stockées dans une base de données.
III.4.1.6. Framework et Bibliothèque
Un Framework permet de se concentrer sur la valeur ajoutée réelle du produit développé. Les fondations nécessaires à une application web étant laissées à la responsabilité d’une communauté compétente, il devient possible de travailler sur ce qui n’existe pas encore, autrement dit d’innover, de créer quelque chose de nouveau.
Voici quelques Frameworks que nous avons utilisés citées ci-dessous :
III.4.1.6.1. BOOSTRAP
BOOSTRAP est une collection d’outils utiles à la création du design (graphisme, animation et interactions avec la page dans le navigateur, etc.) De sites et d’applications web. C’est un ensemble qui contient des codes HTML et CSS, des formulaires, boutons, outils de navigation et autres éléments interactifs, ainsi que des extensions Javascript en option. C’est l’un des projets les plus populaires sur la plate-forme de gestion de développement GitHub.
III.4.1.6.2. Environnement logiciel
III.4.1.6.2.1. SUBLIME TEXT
Sublime Text est un éditeur de code extensible développé par Microsoft pour Windows, linux et MacOs.
Il est un éditeur de code source qui peut être utilisé avec une variété de langages de programmations, notamment java, Javascript, etc. il est basé sur d’électron, qui est utilisé pour développer les applications web.
III.4.1.6.2.2. Système de gestion de base de données (SGBD)
Le système de gestion de base de données est un ensemble de services (applications logiciels) permettant de gérer les bases de données, c’est-à-dire :
- Permettre l’accès aux données de façon simple
- Autoriser un accès aux informations à de multiples utilisateurs.
- Manipuler les données présentées dans la base de données (insertion, suppression, modification).
Parmi les SGBD on peut citer :
MySQL qui lui aussi est un système de gestion de base de donnée qui sert stocker et d’organiser les données.
III.4.1.6.2.3. Hébergeur Web
Nitro hosting est un service d’hébergement web qui met l’accent sur des performances rapides et optimisées. Ce terme peut être utilisé par différentes entreprises d’hébergement pour signaler qu’elles offrent des serveurs puissants, une bande passante accrue, ainsi que des technologies avancées comme le caching, des serveurs SSD, ou un réseau de diffusion de contenu (CDN) pour améliorer la vitesse de chargement des sites web.
III.5. Technique GANTT de déploiement
III.5.1. Technique GANTT
Figure III. 8: Technique GANTT
Le projet est divisé en 5 tâches principales :
- Analyse :
Etude préalables, récoltes des données.
- Conception des diagrammes
Modélisation de notre système d’information
- Implémentation (Réalisation)
Réalisation du nouveau système avec les technologies web et le choix du SGBD.
- Déploiement
Mise en production du logiciel.
- Formation des utilisateurs
Apprentissage des fonctionnalités du logiciel aux utilisateurs finals.
- Budget d’implémentation
Le présent cahier des charges décrit les exigences du projet.
Tableau III.4: Budget d’implémentation
| N° | Désignation | Quantité | Prix Unitaire($) | Prix Total ($) |
| 1 | Hébergement | 1 | 100 | 100 |
| 2 | PC – Admin | 1 | 200 | 200 |
| 3 | Certificat SSL | 1 | 50 | 50 |
| 4 | Main d’œuvre | 2 | 125 | 250 |
| TOTAL | 600 | |||
Le projet doit être terminé dans un délai de 21 jours. Le budget du projet est de 600USD.
- Responsabilités
Le projet sera dirigé par un chef de projet. Le chef de projet sera responsable de la planification, de la coordination et du suivi du projet.
Les tâches suivantes seront réalisées par les équipes suivantes :
- Équipe d’évaluation du système actuel : responsable de l’évaluation du système actuel et de l’identification des besoins et des exigences du nouveau système.
- Équipe de conception du nouveau système : responsable de la conception du nouveau système.
- Équipe d’acquisition du matériel et des logiciels : responsable de l’acquisition du matériel et des logiciels nécessaires au nouveau système.
- Équipe d’installation du nouveau système : responsable de l’installation du nouveau système.
- Équipe de test du nouveau système : responsable du test du nouveau système.
- Suivi et contrôle
Le projet sera suivi et contrôlé par un comité de pilotage. Le comité de pilotage se réunira tout le week-end pour examiner l’avancement du projet et prendre les mesures correctives nécessaires.
CHAP IV. APPLICATION
IV.1. Partie Front-Office
IV.1.1. Page pour formulaire d’inscription
Figure IV.1. Formulaire d’inscription
Code source pour formulaire d’inscription étudiant
<!DOCTYPE html>
<html lang= »fr »>
<head>
<meta charset= »UTF-8″>
<title>Inscription Étudiant – ISP/Masi-Manimba</title>
<meta name= »viewport » content= »width=device-width, initial-scale=1″>
<link href= »https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/css/bootstrap.min.css » rel= »stylesheet »>
<link href= »https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap-icons@1.10.5/font/bootstrap-icons.css » rel= »stylesheet »>
<style>
body {
font-family: ‘Segoe UI’, sans-serif;
background: #f4f6f9;
margin: 0;
}
header {
background-color: #002147;
color: white;
padding: 30px 0;
text-align: center;
box-shadow: 0 2px 8px rgba(0,0,0,0.1);
}
header h1 {
font-size: 2rem;
IV.1.2. Page de fiche d’inscription
Figure IV.2. Fiche d’inscription
Code source pour Fiche préinscription
<!DOCTYPE html>
<html lang= »fr »>
<head>
<meta charset= »UTF-8″>
<title>Fiche de Préinscription</title>
<link href= »https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/css/bootstrap.min.css » rel= »stylesheet »>
<style>
body {
padding: 40px;
font-family: ‘Segoe UI’, sans-serif;
background-color: #f7f7f7;
}
.fiche {
background-color: #fff;
padding: 30px;
border-radius: 10px;
box-shadow: 0 4px 20px rgba(0,0,0,0.1);
max-width: 800px;
margin: auto;
}
.fiche h2 {
text-align: center;
margin-bottom: 30px;
color: #002147;
}
.btn-print {
display: block;
Partie Back-Office
IV.1.3. Page authentification
Figure IV.3. Page authentification
Code source pour Page authentification
<div class= »login-container »>
<div class= »login-title »>
ISP / Masi-Manimba<br> Connexion – Admin
</div>
<form method= »post » action= » »>
<label class= »form-label »>Nom d’utilisateur</label>
<input type= »text » name= »nom » placeholder= »Ex: isp2025-01″ class= »form-control » required>
<label class= »form-label »>Mot de passe</label>
<input type= »password » name= »password » placeholder= »******** » class= »form-control » required>
<button type= »submit » class= »btn btn-danger » name= »formconnect »>Se connecter</button>
<a href= »inscription.php »>Créer un compte</a>
</form>
</div>
</body>
</html>
IV.1.4. Page de Tableau de bord
| Socrate |
Figure IV.4. page tableau de bord
Code source pour tableau de bord
<h4 class= »text-white mb-4 text-center »>GESTION DES INSCRIPTIONS</h4>
<ul class= »nav nav-pills flex-column »>
<li>
<a href= »tableau-de-bord.php » class= »nav-link active »>
<i class= »bi bi-house-door »></i> Accueil
</a>
</li>
<li>
<a href= »etudiant.php » class= »nav-link « >
<i class= »bi bi-people »></i> Etudiant Inscris
</a>
</li>
</ul>
<a class= »nav-link » href= »logout.php »>
<i class= »bi bi-box-arrow-right »></i> Déconnexion (divin)
</a>
</div>
</div>
<div class= »content »>
<h1 class= »mb-3″>Bienvenue Socrate 👋</h1>
<p class= »text-muted »>Tableau de bord de gestion des inscriptions</p>
<!– Cartes de statistiques –>
<div class= »row g-4″>
<div class= »col-md-4″>
<div class= »card text-center shadow-sm »>
<div class= »card-header »>👥 Etudiant</div>
<div class= »card-body »>
<p class= »text-muted »>Etudiants enregistrés</p>
| Figure IV.5. Liste des étudiants |
III.5.5. Page de la liste des étud
Code source pour liste des étudiants inscrits
<div class= »main-content »>
<h3 class= »mb-4″>Liste des Etudiants Inscris</h3>
<div class= »card mb-4″>
<div class= »card-header »>Recherche & Actions</div>
<div class= »card-body »>
<form method= »get » class= »row g-2″>
<div class= »col-md-4″>
<input type= »text » name= »mot1″ class= »form-control » placeholder= »Matricule… » value= » »>
</div>
<div class= »col-auto »>
<button type= »submit » class= »btn btn-success btn-icon »><i class= »bi bi-search »></i> Rechercher</button>
</div>
<div class= »col-auto »>
<a href= »ajout-Etudiant.php » class= »btn btn-primary btn-icon »><i class= »bi bi-plus-circle »></i> Ajouter</a>
</div>
<div class= »col-auto »>
<a href= »imprimer.php » class= »btn btn-danger btn-icon »><i class= »bi bi-printer »></i> Imprimer</a>
</div>
</form>
</div>
</div>
III.6. CONCLUSION
Dans ce chapitre, nous avons présenté l’application développée en précisant son objectif principal, à savoir : faciliter et moderniser le processus d’inscription des étudiants au sein de l’ISP/MANIMBA à travers une plateforme web accessible. Nous avons également mis en évidence les fonctionnalités clés de l’application, ainsi que ses utilisateurs principaux, notamment les étudiants, les agents administratifs et les responsables académiques.
Par ailleurs, la modélisation du système a permis de représenter, de manière formelle et structurée, les différents cas d’utilisation, les interactions entre les acteurs et le système, ainsi que la logique interne à travers les diagrammes UML.
Cette étape a été essentielle pour mieux comprendre le fonctionnement attendu du système avant son implémentation, tout en garantissant une conception cohérente et adaptée aux besoins identifiés.
Ces bases posées, nous allons désormais passer à la phase de conception technique et de mise en œuvre de l’application.
CONCLUSION GENERALE
L’évolution rapide des technologies de l’information et de la communication a profondément transformé les modes de gestion dans tous les secteurs, y compris celui de l’enseignement supérieur. Dans un contexte où la modernisation des services administratifs devient une exigence incontournable, ce travail s’est inscrit dans la dynamique de digitalisation des procédures académiques au sein de l’Institut Supérieur Pédagogique de Masi-Manimba.
Partant d’un constat d’inefficacité du système traditionnel de gestion des inscriptions, caractérisé par une lenteur administrative, des erreurs fréquentes et une mauvaise coordination des services, nous avons proposé une solution numérique adaptée : « conception et réalisation d’une application web pour la gestion des inscriptions des étudiants d’une institution supérieure ».
À travers l’approche méthodologique adoptée, nous avons d’abord analysé les besoins du système existant, identifié les limites majeures, puis défini les spécifications fonctionnelles et techniques nécessaires au bon fonctionnement de la nouvelle plateforme. La modélisation, réalisée à l’aide d’outils UML, a permis de structurer et de planifier les fonctionnalités du système. Enfin, l’implémentation du site web a été réalisée en tenant compte des critères essentiels de sécurité, d’accessibilité, de performance et d’interopérabilité.
Cette solution informatique constitue une réponse concrète aux problématiques identifiées : elle permet la centralisation des données, la réduction du temps de traitement des dossiers, la limitation des erreurs humaines et l’amélioration de la communication entre les différents services concernés (inscription, finances, scolarité, etc.).
Sur le plan technique, cette plateforme représente une avancée significative pour l’ISP/Masi-Manimba, en lui offrant un outil moderne, flexible et évolutif, capable de s’adapter à de futurs besoins tels que l’ajout de modules (paiement en ligne, suivi académique, génération automatique d’attestations, etc.).
Sur le plan académique, ce travail nous a permis de mettre en pratique nos compétences en développement web, en conception de bases de données et en analyse des systèmes d’information, tout en contribuant à une solution à fort impact social.
Nous restons conscients que toute œuvre humaine est perfectible. Ainsi, nous recommandons aux responsables de l’ISP/Masi-Manimba de :
- Poursuivre la modernisation des autres services académiques et administratifs,
- Prévoir une formation du personnel à l’utilisation du nouveau système,
- Et envisager une phase de maintenance et d’évolution continue du site pour garantir sa durabilité.
En définitive, ce projet constitue un exemple concret de l’apport de l’informatique dans l’amélioration de la gouvernance académique, et pose les bases d’un processus d’inscription plus efficace, plus transparent et résolument tourné vers l’avenir.
BIBLIOGRAPHIE
I. Ouvrages
- Tanenbaum, A. S., & Wetherall, D. J. (2011). Computer Networks (5th Edition). Pearson Education.
- Kurose, J. F., & Ross, K. W. (2017). Computer Networking: A Top-Down Approach (7th Edition). Pearson.
→ Utile pour comprendre les protocoles HTTP/HTTPS, client-serveur, etc. - Fowler, M. (2004). UML Distilled: A Brief Guide to the Standard Object Modeling Language (3rd Edition). Addison-Wesley.
- Pressman, R. S. (2010). Software Engineering: A Practitioner’s Approach (7th Edition). McGraw-Hill
- Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2016). Management Information Systems: Managing the Digital Firm (14th Edition). Pearson.
- Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2011). Fundamentals of Database Systems (6th Edition). Addison-Wesley.
II. Webographie (sources en ligne fiables)
- Site officiel de l’UML
https://uml-diagrams.org/ - OpenClassrooms – Développement web
https://openclassrooms.com/fr/courses/1946386 - MDN Web Docs (Mozilla Developer Network)
https://developer.mozilla.org/fr/
W3Schools
https://www.w3schools.com/
https://digital.gov/
TABLE DES MATIERES
Epigraphe ……………………………………………………………………………………………………i
Im memoriam ………………………………………………………………………………………………ii
Dédicace ……………………………………………………………………………………………………..iii
Remerciement ………………………………………………………………………………………………iv
Figure …………………………………………………………………………………………………………v
Tableau ………………………………………………………………………………………………………
INTRODUCTION GENERALE……………………………………………………………….1
1…… PRESENTATION DU SUJET.. ……5
2. PROBLEMATIQUE………………………………………………………………………….5
3. HYPOTHESE…………………………………………………………………………………6
4. CHOIX ET INTERET DU SUJET………………………………………………………..6
5. METHODOLOGIE DE TRAVAIL………………………………………………………….7
6. TECHNIQUE UTILISEES …………………………………………………………………7
7. DÉLIMITATION DE L’ÉTUDE …………………8
7.1. DELIMITATION DANS L’ESPACE.. 8
7.2. DELIMITATION DANS LE TEMPS. 8
8. OBJECTIFS DE L’ÉTUDE…………………………………………………………………8
10. SUBDIVISION DU TRAVAIL …………………………………………………………9
CHAPITRE I. CONCEPTS DE BASE 10
I.2. L’INFRASTRUCTURE RESEAU AU SERVICE DU WEB.. 10
I.2.2. Le Web et le réseau : une relation étroite. 10
I.2.3. LES COMPOSANTS RESEAUX ESSENTIELS AU SITE WEB.. 11
I.3.1. Définition du Web et Internet 12
I.3.4. NOTION DES PROTOCOLES ET PORTS. 15
I.3.5. Pages web, site web et serveur web. 15
I.5. NOTIONS DE BASE DES DONNEES 16
I.5.1. Critères d’une base de données relationnelle. 17
I.5.3. Utilité d’une base de données. 17
I.5.4. Module de la base de données. 18
I.6. SYSTEME DE GESTION DE BASE DE DONNEES « SGBD » 20
CHAPITRE II. ANALYSE PREALABLE. 25
II.1.2. Situation géographique. 25
II.1.3. Identité L’institut supérieur pédagogique de Masi-Manimba. 26
II.1.4. Filières organisées. 26
II.1.5. L’organigramme de l’ISP-MASI 27
II.1.6. Etudes des documents manuels utilisés 28
II.1.7. Etude des ressources de traitement des informations. 30
II.2. CRITIQUE DU SYSTEME EXISTANTS ……………………………………………32
II.2.1. Points forts du système actuel (manuel) 32
II.2.2. Points faibles du système existant 33
II.2.3. Les solutions existantes : manuelle vs informatique. 33
· Pourquoi opter pour une solution informatique ?. 34
CHAPITRE III. CONCEPTION ET IMPLEMENTATION DU NOUVEAU SYSTEME …35
III.1. CONCEPTION DU NOUVEAU SYSTEME………………………………….. 35
III.2. Spécifications des besoins du nouveau système. 35
a) Besoins fonctionnels (ce que le système doit faire) 35
b) Besoins non fonctionnels (qualité du système) 35
III.3. MODELISATION ………………………………………………………………………36
III.3.1. Langage de modélisation. 36
III.3.2. Diagramme de cas d’utilisation. 36
a) Identification des acteurs. 37
III.4. Représentation du Diagramme de cas d’utilisation. 38
III.5. Description textuelle des cas d’utilisation. 39
III.6. Le cycle de développement en V………………………………………………….42
III.6.1. Caractéristiques de la méthode en V.. 43
III.7. CONCEPTION DETAILLE…………………………………………………………….44
III.7.1. Quelques définitions. 45
Ajouterétudiant…………………………….…………………………………………………48
III.7.3. Diagramme de classe. 48
III.4. IMPLEMENTATION DU NOUVEAU SYSTEME ……………….49
III.4.1. Choix technologique. 49
III.5. Technique GANTT de déploiement 53
IV.1. Partie Front-Office……………………………………………………………………55
IV.1.1. Page pour formulaire d’inscription. 55
IV.1.4. Page de Tableau de bord. 59
III.6. CONCLUSIO …………………………………………………………………………….62
I. Ouvrages…………………………………………………………………………………65
II. Webographie (sources en ligne fiables)………………………………………….65
[1] MASAMBA E. note de cours Programmation Web, L1 CSI/PADEM, ISP-MASI, 2023-2024, inedit
4 Codeur, hébergeur web, https://www.codeur.com/blog/hebergeur-image/, consulté le 26/01/2025
[2] STEPHENS R.,Conception de base de données, Campus Press, Paris, 2001, p.56.
[3] MASAMBA, Notes des cours de gestion de projet, L2 IG/Padem, ISP-MASI, 2024-2025, inédit
[4] Source direction de général de l’ISP –MASI,25/11/2025 , 10H30
[5] MASAMBA E . note de cours UML, L2 CSI/PADEM, ISP-MASI, 2024-2025 inédit
[6] MASAMBA E. Note de cours gestion de Projet L2 CSI/Padem, ISP-MAS, 2024-2025
[7] MASAMBA E. note de cours développement Web L1 CSI/PADEM, ISP-MASI 2023-2024, inédit
[8] http://www.php.net/manual/fr consulté le 26/01/2025, 21H30

 Naviguez vers congovirtuel
Naviguez vers congovirtuel Naviguez vers Kinkiesse
Naviguez vers Kinkiesse